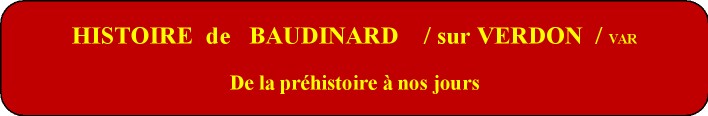
Cette presentation a été realisée d'aprés un manuscrit donné, il y a plus de 50 ans, par celui qui signait:
Fredo Mathéron, Lou Felibre dei péd-terrous.
Il souhaitait
diffuser sa connaissance à ses amis de Baudinard et à
tous ceux interessés par son histoire, ce qui s'est fait, jusqu'à
nos jour, par de multiples et divers moyens de copie. Aujourdhui, le progrés
techniques nous permet de le mettre à disposition de tous sur le
web.
Nous rendons donc hommage à sa mémoire et à son travail
en le publiant ci aprés.
Chapitre Premier : La Préhistoire
La colline Montagne de l'Espiguière, Chapelle N-D. de Liesse, Signal de l'Aigle, Signal de Piégut, Chapelle N-D. de
Par contre dans les terrains situés entre Baudinard et Artignosc, « calcaires travertineux » dénotant l'existence ancienne d'eaux ruisselant en cascades, on a trouvé quelques mollusques tels que Hélyx, Lymnées, Phanorbes qui vivaient à l'époque tertiaire.
Cette Epoque tertiaire est marquée par l'existence de grands lacs d'eau douce.
Il pénétrait dans le Var par Aiguines, Bauduen, Montmeyan jusqu'à Aups, Salernes et Quinson. Les eaux du lac venaient affleurer l'emplacement occupé aujourd'hui par les plus basses maisons de Baudinard.
L'Epoque Quaternaire vit l'apparition de l’ homme des cavernes.
Pendant la période paléolithique,
Les hommes qui vivaient à cette époque ne se nourrissaient que de fruits sauvages et du produit de la chasse, ils ne connaissaient, ni l'agriculture, ni la navigation la. plus élémentaire, ni la domestication des animaux.
L'Epoque néolithique (âge de la pierre polie) qui succède à l'Epoque paléolithique, à apporté avec elle une civilisation dont nous parlerons plus longuement dans le Chapitre suivant.. Elle a laissé des traces un peu plus accentuées dans la région et à Baudinard même.
Des fouilles récentes faites dans les Barres, par Henri Lambert en 1945 et par nous-mêmes en 1948, ont permis de découvrir de nombreux habitats néolithiques inconnus jusqu'alors.
Voici d'abord l'aspect général, d'après Martel:
31ème canyon de Baudinard, séparé du grand canon d'Aiguines par la large vallée des Salles.
De Fontaine l'Evêque au petit barrage de Quinson:
- Longueur:
- Profondeur : 100 à
- Pente: 5,3 pour mille.
Entrée magnifique, bateau nécessaire pour la partie amont ( en réalité, c'est pour la partie aval, à cause du regonfle occasionné par le Barrage de Quinson), milieu bien visible étant traversé par deux ponts.
Le grandiose recommence à l'entrée de ce nouveau défilé, superbe pour qui ne connait pas le grand Canon.
La Barre
C'est un typique exemple d'abaissement de niveau d'un cours d'eau, par l'approfondissement de son lit dans le calcaire fissuré.
Cette affirmation est corroborée par une fort singulière grotte à 4 étages qui débouche par plusieurs fenêtres sur la falaise gauche du Canon de Baudinard à 30 ou
Après les grandes pluies elle joue le rôle d'un affluent souterrain, barbacane du plateau. On peut descendre ce Canon en canoë La partie moyenne est une jolie rue d'eau toute droite sur
Ajoutons à cela:
a) En 1898, avec 3 amis, nous avons remonté une longue galerie partant de la grotte de l'Eglise et après 2 heures de marche souvent pénible et parfois rampante, nous avons fait demi-tour, faute de lumière sans avoir atteint l'extrémité de cette fente.
b) Sous la direction de M. HENSELINE, un essai de descente a été fait à l'aven. d'Arbitelle, très étroit à l’ouverture: .trou ovale de
c) Un 3ème, pont existe entre .les deux signalés ci-dessus, le pont de St-Laurent ou d'Artignosc et juste à l'issue du défilé, au Barrage de Quinson, une passerelle est construite en amont, du pont de Quinson, permettant de voir de plus près la sortie des Barres.
d) Le terme "Canon' est un mot de géographe, inconnu dans le pays; les naturels disent toujours les Barres,
Du point de vue touristique 2 grottes sont particulièrement visitées la grotte dite des pastels, à cause des couleurs qui s'y reflètent, et celle de l'Église.
Cette dernière représente vaguement une nef, avec bénitier, chaire et tribune.
Entre ces deux grottes, un éperon rocheux coupe le sentier: c'est le Marrit Pas;
Un petit ressaut dans la paroi verticale, à peine suffisamment large pour poser un seul pied, forme marche d'escalier. Le passage est dangereux l'à pic est d'une 20 taine de m. au dessus;de l'eau mais une chaîne fixée au rocher donnait toute sécurité.
Elle avait été posée par des excursionnistes à la fin du XIX ème, enlevée par les maquisards pendant la guerre 1939-1944 ( les mêmes causes amènent les mêmes effets, voir plus loin les Grandes Invasions), elle a été remplacée en 1948 par un câble en acier.
Les grottes qui ont été fouillées se trouvent au-dessus du sentier ( mais il s'en trouve d'autres encore indemnes de toute investigation, elles sont toutes sensiblement exposées au Nord, mais très abritées du fait de la profondeur des gorges.
Mobilier trouvé par LAMBERT ( 8 grottes) et nous-même( 2 grottes) dans les habitats néolithiques des Barres, au demeurant fort pauvres:
1°- Industrie lithique: Silex divers
-Pointes de flèche,
-Lames et lamelles, de, 0,020 à 0,052,
-Petites pointes,
-Tranchet de 0,040, Perçoirs de 0,030,
-Burins d'angle de 0,035, etc..
-Galets calcaires, Gros broyeurs,
-Enclume, Aiguisoirs, Lissoirs, etc..
2°- Industrie osseuse :
-Poinçon â l'extrémité finement polie de 0,058, moitié de l'épiphyse conservée par la préhension,
-Autre poinçon finement poli et appointé de 0,044,
3•-. Ossements
-Ossements d'animaux assez nombreux, très brisés souvent indéterminables: molaires d'equus, oiseaux- dont un de grande taille, srofa.
4° Céramique :
Plus de 10 K, de tessons révélant une poterie d'usage, assez grossière, exécutée sans tour, provenant de vases de diverses dimensions, ayant de 2 à
Très peu de morceaux sont décorés; plusieurs: anses en téton et tubulaire; quelques tessons; sont peignés, un autre strié; l'un porte un décor en chevrons allongés rompus à 3 sillons; un fragment de couvercle plat avec anse, etc. 2 fusaïoles.
5•- Divers :
-Débris de verre, 0,002 d'épaisseur, irisé,
-Autres débris de verre plus mince (0,001) concaves, provenant d'un tout petit récipient,
-Un fragment d'aiguisoir, en grès,
-Un fragment de bracelet en schiste, de section sublosangique, de diamètre primitif de 0,060 environ,
-Probablement une dent, recouverte d'un enduit brillant et coloré, ayant peut-être servi d'amulette,
-Un morceau de verre colorié de 0,048 de long, à section ovale de 0,005 de diamètre, recouvert d'une espèce de vernis, etc.., etc..
Arrêtons nous un peu plus longuement à
Il appuie son opinion, en dehors d'une tradition orale recueillie auprès des plus vieux habitants de la région(?), sur les trouvailles faites dans
- a) Un fragment de vase peint, polychrome, de style géométrique, pièce actuellement unique, tout au moins pour
.
- b) Vers le fond: de la galerie supérieure située le plus à l'Ouest un sondage a procuré une concrétisation stalagmitique " en grappe" de 0,09 sur 0,09 (sorte de poupée de loess) , qui parait avoir été accommodé, une retouche d'un mamelon, fait une sorte de bec; et latéralement, un oeil à dessin concentrique à 2 sillons parait avoir été gravé après léger polissage. Une tête d'oiseau, vu de profil, est ainsi figurée; la représentation de cet oiseau a un sens culturel net.
- c) Enfin une pièce importante: c'est une dallette en calcaire de l'étage de:0 20 sur.0,10 et 0,06, pesant 1K,540 profondément,gravée sur une face après polissage partiel.
En résumé. Conclut H. LAMBERT, cette caverne, dont l'exploration systématique reste à faire, révèle déjà une occupation, protohistorique complexe, avec habitat, fonderie probable, sépulture et lieu, cultuel.
Mais Georges de Manteyer parlant de ce dernier monument (la. dallette ) et se basant sur lui est beaucoup plus affirmatif et n'hésites pas à la rattacher au culte: Egyptien de la. "mort voisine de la vie renaissante" qui se pratiquait sous
On voit tout l'intérêt qu'il y aurait à compléter ces fouilles et à procéder à des travaux méthodiques, tant dans les Grottes de la rive du Var, que dans celles des Basses Alpes, qui, à ma connaissance, sont encore inviolées ( 1948 ).
On ne saura probablement jamais si les Ligures furent un peuple autochtone de
On a cru pendant longtemps que les celto Ligures venaient des Hauts Plateaux de l'Asie, quelques auteurs affirment actuellement que leur berceau fut l'Europe Centrale et même Nordique, d'où ils furent chassés par le froid.
Ces nouveaux venus apportaient l'usage de la pierre polie, ils connaissaient quelques rudiments d'agriculture, s'aventuraient le long des rivages sur des radeaux et des troncs d’arbre creux, utilisaient une poterie rudimentaire faite sans tour et cuite au soleil et ils savaient domestiquer les animaux.
Ils vivaient à proximité des cavernes et avaient le culte de leurs morts: ils les ensevelissaient dans les grottes et les cavernes et si celles-ci manquaient, ils construisaient des "tumuli" et dressaient pour les chefs ces tombeaux formés de gros blocs de pierre que nous désignons aujourd'hui sous le nom de menhir et de dolmen.
Il existe quelques uns, de ces mégalithes dans la région; le plus connu est le dolmen de Draguignan, "
Ampus en possède 2, un à
Figanières, en avait un à St-Nast, découvert il y a quelques années par M Honoré et brisé stupidement peu après,
St-Laurent, dans les Basses-Alpes a aussi un dolmen.
Deux menhirs sont connus, l'un dans la commune d'Ampus, à Mourjai et le 2° dans celle de Cabasse, à Campdimy " La peiro plantado".
Nous: avons trouvé' à Baudinard, au quartier de
Ces blocs caractéristiques ont été amenés car on. ne rencontre que du tuff dans le quartier. La pierre. Tabulaire cassée en deux morceaux inégaux,
mesure approximativement 4m. 50. de long,
d'épaisseur. Elle est à plat ,sur le sol; 4 blocs massifs
avoisinants pouvaient en être ,les supports. Le temps nous a fait défaut pour procéder à des sondages même superficiels qui auraient pu confirmer notre opinion.
Les Ligures étaient de petite. taille, leur corps. était maigre, car ils se nourrissaient mal et peinaient beaucoup. C'étaient des paysans farouches, acharnés au travail de la glèbe: ils se créaient des champs à la hache, en faisant reculer. la forêt. sous leurs aspects frêles, ils étaient d'une étonnante vigueur; ils avaient des muscles puissants et leur système nerveux était à l'épreuve de toute fatigue
Grands chasseurs, c'étaient des athlètes de chétive mine, qui unissaient à la souple vigueur : l'adresse, l'agilité, l'endurance.
Ces hommes rudes avaient des femmes dignes d'eux: elles travaillaient la terre sans relâche,et la maternité n'interrompait que pour quelques heures leur vie de labeur obstiné'.
D'un particularisme farouche, les Ligures restaient invinciblement attaches à leurs Dieux, à leurs traditions à leurs coutumes, à leurs habitudes.
Ces peuplades, bien qu'hospitalières, n'acceptaient aucune intervention étrangère ayant en vue de les asservir. Elles étaient par dessus tout attachées à leur terrain et à leur indépendance.,
Le peu de goût que les Ligures avaient à entrer en relation avec les étrangers dont les desseins étaient imprécis, la défiance qui les rendait prudents, réservés et quelque fois facétieux, a été interprété par les auteurs anciens dans le sens d'une obstination inconcevable, d'une résistance illégitime et d'une mauvaise humeur caractérisée.
Les Druides et le Culte du Gui sur le chêne rouvre étaient essentiellement gaulois; les Ligures adoraient les forces. immuables:
Les Dieux des Eaux sources, fleuves, mers , de
Ils usaient du troc pour leur commerce et ne battirent jamais monnaie; ils ne semblent pas avoir utilisé l'alphabet; leur langue était le Provençal actuel, compte tenu des changements qui se sont fait jour au cours des siècles et des apports qui sont venus l'enrichir.
Les Ligures avaient construit de nombreux "Oppida" ( ou castellas) sur des points caractéristiques, mais ils ne les habitaient pas en permanence: ils ne s'y réfugiaient avec leurs troupeaux qu'en cas de menace d'un ennemi; le reste du temps, ils n'y laissaient que des guetteurs qui assuraient la surveillance de la région.
Les "0ppida" qui couronnent les montagnes du Var présentent tous les mêmes caractères.: ils sont bâtis sur des collines escarpées; ils consistent en une enceinte de murs en pierres sèches, de 4 à
Cela se comprends fort bien : les oppida ou castellas devaient remplir deux conditions :
a/ être assez haut perchés afin que les guetteurs puissent surveiller le plus d'espace possible;
b/ être d'un abord difficile pour faciliter leur défense en cas d'attaque.
Les travaux de divers érudits ont fait connaître de nombreux castellas dans le Var et dans la région qui nous intéresse, à Aiguines, Ampus, Artignosc, Moissac,.Montmeyan, Salernes, Sillans, Tourtour, Vérignon etc....
A cette liste nous, allons ajouter un nom dont aucun érudit spécialiste n'a parlé: le Castellas, à Baudinard
Sur le Plan Directeur, entre
Au Nord de
Le Castellas est situé au sommet du mamelon, il a la forme d'un cercle régulier et ne présente pas de solution de continuité. Le cordon de pierres, de petit appareil, atteint par endroits
Au sud, point de raccord avec la colline N-D, se trouvait un redan, probablement pour protéger l'entrée; le tas de pierres présente à cet endroit un énorme renflement à l'extérieur. On peut voir, dans la partie Ouest, deux petits pans de mur encore debouts.
Le diamètre de l'enceinte est de
Le castellas domine admirablement la source de Sorps- Le SORPIUS des Romains- la large vallée des Salles et par sa position élevée, juste au sommet de l'angle droit formé par le Verdon il commande l'entrée des Barres de Baudinard.
La belle source de Sorps aujourd'hui Fontaine l’évêque fut sûrement dans l'antiquité l'objet d'une grande vénération de la part des Ligures: il est normal qu'un castellas ait été construit à proximité afin que les habitants puissent s'y réfugier en cas d'alerte.
Il nous faut mentionner encore l'existence de deux pierres à sacrifices, exactement semblables et se trouvant l'une à Barbabelle et l'autre à Valmogne.
Celle de Barbabelle est un bloc de calcaire massif, mal équarri, mesurant
Au milieu de la: parie supérieure se trouve un trou régulier de forme rectangulaire, aux angles arrondis et dont les deux faces latérales sont élargies en leur. milieu pour former un cercle parfait., Largeur de l'ouverture dans sa partie étroite,.0 m. 13; longueur:
La pierre de Valmogne ( ou Vaumougne), identique en, tous points à celle de Barbabelle, est constituée par Un bloc calcaire un peu moins massif, légérement plus allongé et plus régulier;: dimensions:
0, 58 et 0, 52 d'épaisseur. Un des coins a été un peu ébréché sans arriver à entamer la cavité qui mesure: largeur de la partie étroite:
De même que celle de Barbabelle, cette pierre ne comporte pas de trou d'écoulement et la tradition orale conservée veut qu'elles aient servi pour des sacrifices. humains.
Il ne nous reste plus qu'à rechercher à quelle tribu appartenaient les Ligures de Baudinard.
Il est hors de doute qu'ils étaient Salyens. Deux tribus peuvent prétendre à la domination sur la région: les Albici et les Verrucini; toutes les deux faisaient partie des Salyens.
Les Albici, dont parle Jules César dans ses Commentaires, habitaient la région d'Albiosc ( sud des Basses Alpes ) et Riez était leur capitale. Contrairement à ce que dit Papon, ils ne semblent pas avoir débordé le Verdon sur le Var actuel.
Les Verrucini occupaient la région de Vérignon qui était la capitale de la tribu. Il est vraisemblable que le territoire qui forme aujourd'hui la commune de Baudinard était compris dans la tribu des Verrucini.
Les Verrucini sont peu connus, dans l'histoire romaine qui ne fait que les nommer, sans rapporter aucune action qui les distingue.
Ils avaient comme voisins:
Au N-0, de l'autre coté du Verdon, les Albici, de Riez.
Au N-E, les Vergunni, de Vergons, sur le Haut Verdon, qui descendaient jusqu'à Moustiers.
A l'Est les Suetri ( ou Sueltri ) de Castellane, qui débordaient le Var jusqu'à Seillans et peut-être même jusqu'à Draguignan.
Au Sud, les Ligannes ( ou Ligaunes ) occupaient tout le bassin de Florièyes: Ampus, Tourtour, Flayosc, Lorgues et peut-être, Salernes et Entrecasteaux.
Enfin, à l'Ouest, une tribu Salyenne dont on ignore le nom et qui était peut-être tout simplement
Chapitre III : Les Romains et les Grandes Invasions
a) La CONQUÊTE.
Les Romains, alliés des Marseillais, vinrent à leur secours lorsque ceux-ci furent attaqués par les Ligures, et de 124 à 121 av. J-C, ils conquirent toute
La tribu des Verrucini avec Baudinard était au nombre des tribus vaincus elle se trouvait à l'extrémité du territoire conquis et au contact immédiat des tribus restées indépendantes.
Pendant les années qui suivirent, les Romains organisérent le pays qu'ils venaient de soumettre qui fût rattaché à
Ils réalisèrent ce miracle d'unir la centralisation étatiste de l'Empire avec l'unité d'autonomie laissée aux peuples vaincus. Sous condition de satisfaire aux impôts et aux prestations, de ne pas troubler le pays et de ne pas comploter contre Rome, les sujets jouissaient des institutions qui correspondaient à leur caractère, à leurs traditions, au développement de leur bien être local et à la libre conduite de leurs affaires locales.
Les Provençaux en particulier s' adaptèrent si bien à ce nouvel état de chose, que leur pays, mérita bientôt de s'appeler'
Nous avons dit qu'une grosse tache de dissidence subsistait entre Gap au Nord est Draguignan et Vence au sud, César entreprit de résorber cet îlot en l'An 14 av. J-C , et y réussit en deux ans
Les Romains avaient établi un système défensif à la pointe S-O de la dissidence dans le triangle les arcs, st Mementaire et Trans. .
D' autre part, et depuis Jules César un camp était établi en permanence au N-E de l'ancien territoire des Verucini, sur un vaste plateau qui s’appelle encore d’ailleurs Le CAMP de JULES = CAMP - JUERS.
Ces deux systèmes défensifs permirent aux romains d’attaquer les ligures par le nord ou ils pouvaient utiliser la grande route venant de Turin
Auguste avait projeté de faire une route stratégique Riez – Frejus pour le ravitaillement de ses troupes, mais ne pouvant traverser la nartuby dont la rive gauche était tenue par les ligures indépendant, les romains furent obligés d’infléchir la route vers le sud , sur forum –voconti et se contenter de faire cette voie, un chemin de rocade.
En fait cet embranchement ne fut achevé que sous Tibère lorsque le calme fut rétabli.
b) L’OCCUPATION
Parmi les grands changements occasionnées par l'occupation romaine un des plus importants fût l'amélioration du système routier.
La 1 ère et semble t-il l'unique route connue avant l'arrivée des Romains est celle dénommée via herculae qui fut probablement tracée et construite par les Phéniciens. En dehors de cette voie, il n'existait que des sentiers plus ou moins larges et dans leur ensemble, tés mal entretenus.
Les Romains qui avaient besoin de moyens de communications rapides, tant pour déplacer leurs armés que pour les ravitailler et, après la conquête pour administrer le pays, construisirent un réseau routier remarquable.
Un embranchement de
Nous avons vu à quelle occasion cet embranchement fût projeté et pour quelle raison le tracé primitif fut modifié. La partie qui n'avait put être construite, le fût après la fin de la guerre, ce qui fait que d'Anteis- en venant de Riez- , la route rejoignait
Voyons son itinéraire entre Anteis et Riez, Il n'a d'ailleurs pas donné lieu à discussion contrairement à certaines stations de la voie aurelienne comme Forum-Voconii par exemple que les auteurs ont cru retrouver dans une dizaines de localités et qui a été définitivement fixé au Hameau de Vidauban, dénommé Chateauneuf.
Au delà d’Anteis (Lentier), la voie montait à Ampus, se dirigeait sur Verignon, descendait à Bauduen et passait a Sorpius (fontaine l'évêque) après Sorps , elle venait traverser le verdon ,juste au début des barres de Baudinard, après le confluent de Sorps avec le verdon, sur un pont dont il reste encore la culée de la rive gauche. Cette culée se trouve à quelques mètres à peine de territoire Baudinard, de la, la voie se dirigeait sur Riez en montant par de courts lacets taillés dans le roc, l’arête à pente très forte de la rive droite de la rivière.
Quand a faire passer par la les chariots le plus lourdement chargés (transportant les colonnes du temple de Riez venant de Pennafort) comme l’on écrit entre autre, Garcin et Feraud c’est une autre paire de manches.
Cela ne présentait pas de difficultés sérieuses, dit Feraud voir ! si les colonnes ont traversées le Verdon sur le front de Sorps, il a fallu les monter à bras d’homme et ce fut alors réellement un travail de romain !
mais il était matériellement impossible, sur cette partie de
Si les . colonnes sont venues des carrières de Pennafort, nous croyons plutôt qu'elles ont traversé
De nombreuses pierres milliaires. ont été trouvées certaines sont encore en place- dans la parti. du. Parcours qui nous intéresse. Il n'y en a pas moins de six dans les deux communes Bauduen et de Verignon, 2 à Bauduen , 4 à Verignon.
Baudinard était desservi directement par un chemin dont il existe encore une centaine de mètres (oratoire Ste Catherine sur la route d’Aups) ancien colombier seigneurial qu’on appelle encore « Camin Roumian »
Il venait probablement d'Aups, par Moissac et rejoignait Riez par Montpezat, en traversant le Verdon sur le Pont Sylvestre, pont très ancien ( la tradition le qualifie de Romain) d'une seule arche et d'une belle hardiesse, au dessus des Barres de Beaudinard.
Les arts et l'industrie se développèrent particulièrement pendant l'occupation romaine: la poterie, la verrerie, la métallurgie firent de grands progrès, en art, la sculpture et la mosaïque furent à l'honneur.
A Baudinard de nombreux objets ont été trouvés surtout près de l'Abbaye de Valmogne et de la ferme de Barbabelle; mon père avait rassemblé une 30 taines de pièces romaines au petit musée de l'Ecole communale: on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Il aurait été intéressant de savoir à quelle époque elles avaient été frappées.
C/ LES GRANDES INVASIONS.
Essayons de deviner ce qui s'est passé à Baudinard pendant les Grandes Invasions.
Pendant toute cette période de troubles, la région de Baudinard a subi au maximum une seule fois l'invasion des barbares: les Wisigoths en 470, et encore il n'est pas sur du tout, lorsque ceux-ci ravagèrent Riez qu'ils aient débordé le Verdon sur sa rive gauche; mais c'est possible une vieille tradition veut qu'ils aient détruit le Pont de Sorps.
Ceci ne signifie nullement que les précautions nécessaires n'étaient pas prises chaque fois qu'un danger se précisait. Mais les habitants de Baudinard avaient une cachette à peu près introuvable: et en tous cas imprenable où ils se réfugiaient en vitesse chaque fois que l'alarme était donnée, celle dont nous avons parlé dans le 1 -er ,Chapitre: les Grottes dans les Barres du Verdon.
Nous. avons signalé le "Marrit Pas", là, un homme décidé pouvait tenir en échec toute une armée. Les indigènes réfugiés dans les Grottes au-dessous du "Marrit Pas" étaient complètement en sécurité et ont pu traverser cette longue période de troubles sans encombres, tout au moins pour eux sinon pour leurs récoltes sur pied et leurs habitations.
Par un étrange retour des choses, le même phénomène. s'est produit à nouveau, lors de l'invasion de 1942 - 1944. Le maquis de cette région des Alpes fut d'une activité considérable.
Bien qu'il soit contraire à l'habitude de placer l'occupation sarrazine parmi les grandes invasions, nous allons le faire tout de même, pour donner plus de cohésion à ce petit livre. Quel fut le sort de Baudinard pendant cette occupation qui dura juste un siècle ?
Vraisemblablement le même que pendant les grandes invasions: si les Sarrasins sont venus, les Barres du Verdon auront une fois de plus sauvé la population de la destruction.
Deuxième Partie:
Chapitre Premier: L'Abbaye de Valmogne.
A quel moment s'est effectuée l'implantation
du Christianisme dans le Diocèse de Riez?
Riez, placé au carrefour de plusieurs
grandes Voies romaines dut connaître assez tôt la nouvelle
religion transmise par les usagers de la. route, surtout les soldats.
Les premiers habitants qui embrassèrent
la religion furent rarement des clandestins comme partout ailleurs
jusqu'à la conversion de Constantin.
Mais l'origine de l'Eglise de Riez est
très
obscure et il est impossible d'assurer quelque chose de positif sur l'époque
où le christianisme commença à s'y établir.
On ne connaît aucun de ses Evêques
avant St- Maxime ( s'il y en a eu) ni par l'histoire, ni par la tradition.
Bartel à bien donné quelques prédécesseurs
à Maxime, mais ils sont tous de son invention.
Maxime était né à Chateauredon,
qui fait partie du Diocèse de Riez et avait été le
2 ième Abbé de Lérîns. C'est sous son Episcopat
que se réunît en 438, le 1 er Concile de Riez; 13 Evêques
y furent présents.
On peut donc conclure que le christianisme
a fait son apparition dans le Comté de Riez au V° Siècle
et s'est répandu sensiblement vers la même époque
mais assez lentement dans les villages avoisinants.
La superfiçie du. Diocèse n'
a presque pas varié depuis sa création jusqu'à. la. Révolution.
Ainsi en 1115, sous l'Evêque Augier,
ses limites allaient des confins, de St Julien le Montagnier jusqu'aux
limites du territoire. de Rougon, et depuis les confîns de Moissac jusqu’a
ceux de Châteauredon. II comprenait. 52 paroisses, à la révolution
le nombre de paroisses est de 61 mais sur les 9 de différence , 5
proviennent de prieurés ruraux démembré
de paroisses existant au. XII Siècle et seulement 4
paroisses nouvelles: Levens, St Martin d'Alignosc, Taillas et Trevens.
Les moines contribuèrent beaucoup
à l’établissement et au développement de
la religion chrétienne
Dès le V em Siècle la
vie monacale était en grand honneur en Provence.
Les V et VI Siècles ont vu créer: Lérins( .405),
St Victor(551) –(certains auteurs disent même
(410)
Montmajour (530),
les îles d’Hyères (fin du V em. Siècle),
Moustiers(433), etc………
Après, le VI em siècle il. n'y a plus de fondation de 'Monastères
en Provence jusqu' après le départ des Sarrasins;
La :Verne (1151)
,
Le Thoronet (créé d'abord, à florieyes) (1136)
Valmoissine (1120)
Silvacane (1.147),
Ste-Catherine de Sorps (1255),
Sénanque (1148),
C'est donc vraisemblablement à la fin du V em Siècle ou au commencement du VI°, que quelques moines vinrent se fixer à Baudinard et y fondèrent l'Abbaye de Valmogne ( ou Vaumogne), qui apparaîtra dans les Chartes en 990.
Constatons d'abord un fait curieux, les Historiens qui ont étudié le Diocèse de Riez, Bartel, Fisquet, Feraud, Albanès, etc..,ou bien ont ignoré complètement l'existence de cette Abbaye, ou bien ont cité les Chartes où elle figure, soit sans la situer, soit en la situant....... où elle ne se trouvait pas.
Feraud dans ses Souvenirs religieux de Hte Provence récapitule tous les monastères, Abbayes, Prieurés appartenant à St-Victor, Lérins, Montmajour, Boscodon, etc..., et les couvents de tous les Ordres du Diocèse de Riez, Valmogne n'est pas cité. L'érudit Albanés ne connaît pas davantage cette Abbaye et Moris, dans le Cartulaire de Lérins, confond valmogne avec Vaux-des-Meuniers, près de Quinson.
Pourtant nous trouvons cette Abbaye de Valmogne citée plusieurs fois dans le Cartulaire de Lérins, et le bâtiment devenu ferme existe encore actuellement. Il se trouve à environ
Voyons de plus prés ce qui en subsiste, la cour attenante au bâtiment et le précédant, le déborde à l'Est de
Le portique d'entrée s'ouvre au Sud, sensiblement au milieu du mur d'enceinte; il a
Le mur de son enceinte qui a
La défense de l’abbaye se complétait par un fort ainsi que le prouve uns pièce de comptabilité Indiquant qu 'on a dépensé
La bâtiment mesure
La façade est percée régulièrement de trois portes de style roman, les deux extérieurs ont
Tout le rez-de-chaussée a été si profondément remanié qu’on ne saurait aujourd'hui reconnaître les diverses destinations des salles il ne comporte plus que des bergeries, écuries et remises, dont tous les plafonds sont voûtés.
De
Le 1 er étage a subi aussi de nombreuse transformations?
Une partie, située au coin S-E, surpasse de quelques mètres tout le corps de bâtiment, mais elle a été elle même surbaissé, elle constitue une salle assez curieuse. On y accède par une ouverture béante qui a été percée dans le mur Sud, mais à
L'ouverture primitive actuellement bouchée tenait toute la largeur de la pièce elle avait la forme d'une voûte romane dont le haut est décapité par le .toit ; la même voûte ce retrouve sur la face opposée et dans les 2 murs N et S. à 0m.50 du sol ; des pierres en saillie forment comme un banc étroit.
Le mur extérieur est soutenu au N. par 2 contreforts légers, et, à sa rencontre avec 1' abside, se trouve un morceau de mur long de
A quel ordre appartenaient les Moines de Valmogne, lors de sa fondation? Ce furent probablement des Bénédictins, mais jusqu'à présent aucun document n'est venu le confirmer; toutefois après le don de leur Église à Lérins il n'y a plus de doute.
Arrivons aux actes authentiques, le 1er connu est la chartes n° 210 du cartulaire de lerins, daté de 990.
Les historiens l’ont passablement déformé pour ne pas dire plus
En fait, que dit-elle ?
En 990, Almérade, par la grâce de Dieu, évêque de Riez, concède à l'Abbé Garnier et à St Honnorat l’ Eglise St Pierre, à proximité de Riez, et Ste Marie Vallis impuris et Ste Marie Muniensis sous la condition qu'en reconnaissance de cette donation, les Moines de Lérins payeront chaque année un cens de 3 sous à l'Eglise St Maxime de Riez.
Il n'y a pas de doute pour St Pierre près de Riez, ni pour Ste Marie" Vallis muniensis" qui est Ste Marie de Valmogne à Baudinard, mais St Marie" Vallis Impuris" a mis les auteurs dans l'embarras. Nous ne les suivrons pas, pour rester dans notre sujet.
Valmogne apparaît dans une 2• Charte du cartulaire de lerins, en 1096.
Le Chanoine Bouisson, qui ignore la charte de 990 est par contre le seul auteur faisant état de celle de 1096. « la chapelle de Valmogne écrit-il appartenait à l'Abbaye de Lérins, dans une propriété qui. était elle même
une Abbaye.
Elle avait été donnée en 1096 à St Honnorat par Blacas et sa femme Beatrix et ses enfants sous le titre de « domus sanctae mariae de vallie munie » devenu Valmogne , conjointement avec Baudinard et Albiosc.
C' est déformer, un texte a plaisir.
"Nous avons appris grâce aux témoignages
de l’écriture divine et grâce aux lois romaines que,
si quelqu'un a donné quelque chose qui lui appartient ou a rendu
a autrui des biens qu’il retenait injustement, il confirme cela
par un document écrit au moyen de témoignages et les
nouveaux hommes de loi n’y peuvent rien changer.
C’est pourquoi
moi blacas ,ma femme beatrix et nos fils laissons, cédons
et donnons la maison de sainte marie de valmogne avec toutes ses dépendances
à dieu et a la bienheureuse marie et a st Honnorat et aux moines
servant dieu a cet endroit, tant future que présente, entre les
mains d’augier évêque de riez , afin que le dieu de
miséricorde daigne nous donner le pardon de nos péchés.
de même moi guillelme épouse de guillaume
augier et mes fils laissons, cédons et donnons la maison dont on
a parlé plus haut et la maison de saint pierre d’albiosc
, avec ses hommes et tout ce qui lui appartient a dieu, a sa mère
et a st honorat entre les mains de l’évêque ci-dessus
nommé , aux moines de lerins présents et futurs, de façon
a obtenir le pardon de nos péchés et dorénavant nous
n’effacerons rien de ce texte
Et si quelque chose d’imprévisible,arrivait, nous promettons de tout arranger par un
arbitrage de l'évêque et des Moines.
De même ,
moi adelais femme de guillaume de moustier , avec mes fils, je cède
la maison de st saturnin a dieu et a st honorat et a tous les moines,
dans les mains de l’évêque ci-dessus nommé,
de façon que je reçoive le pardon de mes fautes."
Ainsi Blacas n'a donné qu'une
partie de la maison et non l'Église, déjà donnée
en 990 il n'y est nullement question de Baudinard, et ce n'est pas Blacas
qui a donné St Pierre d'Albiosc.
Cette donation est d'ailleurs bien dans
la règle du jeu les Evêques ne pouvaient donner directement
aux Moines que les églises ;c'étaient
des laïques qui servaient d'intermédiaire pour offrir les
terres de l'Evêché qui avoisinaient ces Églises.
A cette même date 1096 (Charte 219), l'Evêque Augier donne à Lérins
l'église St Jacques de Baudinard "aux moines qui gouvernent
déjà l'Eglise de Valmogne"
4° Charte en 1113 ( 214 de Lérins). C'est une récapitulation
et une confirmation des possessions de Lérins dans le Diocèse
de Riez par Augier, Evêque du Diocèse. Dans le nombre figure
Ste Marie de Valmogne. {Pour ces 2 Chartes 214 et 219, voir le chapitre
suivant)
Valmogne apparaît encore 2
fois dans l'Histoires
-a) le 6 Mars 1256 (Charte 44 de Lérins)
échange entre l'Abbaye de Lerins et le Monastère de Ste-Catherine
de Sorps reçoit les églises de Valmogne et de Baudinard
et donne à lérins le prieuré d’artignosc.
-.b) en 1612 l’évêque
de Riez Charles de St-Sixt rachète et unit à la mense épiscopale.
le domaine de Valmôgne, ancien Monastère
aliéné, possédé alors par des laïques.
A quel moment les Moines ont-ils quitté
leur Abbaye et pour quels motifs ?
On ne peut rien affirmer. C'est probablement
au XV em siècle que les Moines quittèrent l'Abbaye de
valmogne ; les derniers vinrent vraisemblablement se retirer
à « clastro » ,
ou ils assurèrent le service de l’église paroissiale
de Baudinard comme nous le verrons dans le chapitre suivant
Mais déjà à cette
date, leur tache était accomplies
-
Ils avaient répandu la fois
-
ils avaient défriché le sol et Contribué à
réunir les habitants en communauté
Ils avaient maintenu dans une période,
particulièrement troublée, un certain degré
de civilisation.
Chapitre II : l'Église paroissiale.
Nous avons vu :
- que le territoire de Baudinard était
habité depuis la plus haute antiquité ;
- qu'il l'était pendant l'occupation
romaine ;
- que l'Abbaye de Valmogne, probablement
fondée au VI ° siècle, était citée dans
une Charte de 990, ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas eu d'interruption
dans son existence.
D'autre part, le "Castrum de Beldisnar"
apparaît dans l'Histoire en 1096. Alors, tout naturellement une
question se pose : Y a t-il eu une solution de continuité dans
l'habitat de Baudinard ?
Il est malheureusement impossible de répondre
avec certitude à cette question; aucune preuve n'existe et la tradition
est muette mais les faits :
- que les invasions successives
, y compris celle des sarrasins n’ont pas amené la
destruction complète de la cité.
- que l'Abbaye de Valmogne a traversé
ces siècles sans grand dommage apparent.
- que Baudinard est déjà
"Castrum" en 1096, ce qui laisse supposer de longues années- sinon
de tranquillité tout au moins d'existence; nous font pencher à
croire que, malgré toutes les vicissitudes possibles, Baudinard
n'a pas été détruit pendant cette période
troublée, au sujet de laquelle - nous ne saurons trop insister
nous ignorons tout.
Quoi qu'il en soit la 1 ère Église
de Baudinard fut
Voici les caractéristiques actuelles de l'Église :
Baudinard étant bâti sur flanc d'un mamelon dominé, par les ruines du château féodal, on accède à l'Église- depuis une placette , par un escalier en pierres, qui compte 11 marches; 2 marches ,séparent la nef du choeur l'arrière de l'Église se trouve sur le même plan que le sol.
De part et d'autre de la montée d'escalier s'élèvent des maisons qui encadrent la façade de l'Église jusqu'à mi-hauteur; celles du, N-0 empiètent sur la façade, cachant presque toute la base du clocher; celles du S-E arrivent juste à l’angle de l'Église et s'adossent contre le mur est dans toute sa longueur.
L'Église est orientée S-S-O. La porte d'entrée, de style roman, .acte au milieu du corps de bâtisse, est désaxée par rapport à la montée d’escalier à cause des maisons qui mordent sur la partie S-O de la façade.
Au-dessus de la porte et bien dans son axe s'ouvre une fenêtre en ogive avec un vitrail représentant
Ces deux styles superposés nous donneraient la date de construction de l'Église, si nous ne la connaissions approximativement par
La porte est encadrée à l'intérieur par un tambour qui fût construit en 1755, avec une somme d'argent versée par l'Évêque " pour manque de service du Secondaire ".
L'Église proprement dite forme un rectangle arrondi à une extrémité par l'abside et mesure
La voûte d'une hauteur de
La chaire, très simple, date de 1.723; elle fut construite avec un don de
Dans le mur Ouest, 3 grandes baies romanes, séparées par 2 piliers de
Cette nef e
Entre l'autel de la chapelle et les deux marche d'escalier est creusé le tombeau des Sabran. La dalle qui ne fait pas saillie sur le sol, porte cette inscription (en 4 lignes) Tombeau- de la famille- Sabran Baudinard.
Au N. de mette chapelle se trouve la sacristie actuelle qu'un couloir sépare du choeur; ce couloir est fermé par une porte s'ouvrant sur le Cimetière; c'est en 1682 que
La vieille sacristie, très petite, forme hernie à l'extérieur du mur Ouest de la bâtisse; on y pénètre depuis la chapelle des Seigneurs, la porte d'entrée se trouve juste avant les deux marches d'escalier.
La décoration de l'Église est très sobre; 4 ou 5 tableaux du XVIII Siècle représentent des sujets religieux, rien d'original ou présentant un intérêt artistique quelconque; une statue de le Ste Vierge, en bois doré, donnée en 1706 " pour
D'autre part voici l'inventaire d'une prise en charge des ornements de l'Église faite en 1718 :" un ciboire d'argent, un soleil d'argent, un reliquaire de St Blaise, en argent ( qu'est-il devenu ?), une grosse croix ornée de quelques plaques d'argent, un ferrat pour l'eau bénite, une lampe de laiton, un fer à hostie, 2 chapes, 10 chasubles, 4 aubes, etc...
On connaît peu les Chapelles, de l'Église avant
2 messes y fût fondée en 1680 par Elzéar de Sabran, moyennant
Il y a actuellement 5 Chapelles latérales dans l'Église: 3 adossée au mur Est : St Blaise, St Joseph, Sacré-Coeur de Jésus.; 2,-.au mur- 0. de
L'Église n'a pas. subi de grandes réparations depuis le XVI° Siècle Les comtes trésoraires ne signalent que de très petites sommes affectées à l'entretien de l'Église; les 2 plus importantes réparations furent la remise en état de la toiture en 1677 ( 567 tuiles) et le carrelage du sol de l'Église, en 1727 .
Le clocher, carré, bas, .trapu, :massif,, s'élève .au dessus du coin S-0 de la bâtisse. Il. est surmonte, d'un toit provençal, à 4 pentes; et, présente 3 ouvertures, dont une béante., Sa. porte fut seconstruite en pierres de taille en 1751; elle s'ouvre dans le mur S. de
Le clocher a sûrement subi une Importante réparation depuis
Les vieilles cloches furent enlevées sous la. Révolution; le clocher abrite actuellement 2 cloches: la grande, à .l'Est, a été fondue en 1833; sur la petite, au Sud, os lit cette inscription « j’ai reçu le baptême le 9 Septembre, M. le Conte de Sabran-Pontevés est mon parrain et Mme Girard est ma marraine. Je porte le nom du pieux Archange Michel. A Paris 1877. (Cette cloche provient de
Pour en terminer avec les cloches, disons encore que celle qui sonne les heures de l'horloge est une cloche rituelle. Elle porte en relief: d'un coté, un crucifix, de l'autre,
Le cimetière s’étendait à l'Ouest de l'Église, entre celle-ci et le chemin de Riez, surplombant ce dernier d'assez haut; les terres étalent retenues par un grand mur de soutènement qui nécessita à maintes reprises de coûteux frais d'entretien. Lorsque la route de Riez fût élargie à la fin du XIX° siècle, elle emprunta la plus grande partie du vieux cimetière déjà remplacé à cette époque par la cimetière actuel.
La 1 ère maison claustrale se trouvait tout contre l'Église c'était la battisse qui cache la base du clocher en 1689, on la reconstruit (coût:
Mais le logement s'avérait insuffisant, aussi une grande décision fut prise en 1755 : le Conseil général de
La maison est achetés et les travaux commencent; l’année suivante les Consuls empruntent
Dans le même but, un 2ème emprunt de
des impositions du quartier de Novembre, afin de payer les frais de construction de la maison claustrale,faute d'avoir pu trouver à emprunter ".
Employer le produit des impôts pour faire construire un presbytère, voilà qui en dit long sur les moeurs de l'Ancien régime !!
Et le nouveau presbytère s'acheva.... Nous n'avons pas trouve le montant total des sommes dépensées pour cette construction, mais voici quelques chiffres :
- achat de la maison
- 1 tiers 408
- 2ème tiers 608
- 1/2 des boiseries 285
- solde du prix fait 395 " 594
-un marteau pour, la porte 6 "
- réparation des saisons voisines démolies 46
____________________________________________________
Total
Quand à l’ancienne claustrale, elle subit pour
En 1868, la façade du nouveau presbytère menaçant ruine, on la refit en la ramenant sur le plan d'alignement (recul de
Après cette revue des bâtiments servant au culte ou en dépendant continuons l'histoire de
Un fait est certain: ce furent les moines de Valmogne qui assurèrent le service religieux de la nouvelle église une chose le démontre péremptoirement le presbytère bien qu'ayant été déplacé et actuellement désaffecte s'appelle encore «clastro". Or ce mot provençal servait à désigner l'habitation des prêtres au service des paroisses, alors qu'ils appartenaient à un ordre religieux. Après sécularisation de ce clergé, on continu à appeler "clastro" ce que nous désignons par presbytère. On verra plus loin que les Moines de Lérins continuèrent le service après l'acte de donation de 1096.
Vers la fin du XI° Siècle et pendent le XII°, sous voyons le clergé séculier faire des dons importants aux grands monastères: Lérins, St Victor, Montajour, etc...
Dais
Quels étaient les motifs de toutes ces donations ?
Revoyons un peu
"Tous ceux qui ont acquis un pouvoir et qui ont de nombreux sujets et qui semblent avoir beaucoup de biens s'appliquent à gérer de leur mieux leurs nombreuses possessions et qui s'acquittent avec, soin de tout, veulent augmenter et améliorer leurs biens par tous les moyens. SI les hommes s'occupent ainsi de leurs affaires, bien mieux encore ceux qui régissent l'Église de Dieu doivent s'occuper de leurs biens de façon à toujours veiller sur elle et à améliorer son état temporel. Ainsi, moi Augier Évêque de Riez, constatant que l' église St Jacques, dans le Castrum de Beldisnar", est sans ministre, je la confie à Dieu et è
condition que ces Moines qui gouvernent déjà l'Eglise de Valmogne, gardent à jamais l'Eglise dans toute son intégrité. Nous avons cédé l'Eglise de St-Jacques avec les décimes et les dons qui lui reviennent de droit. Moi, Augier, Evêque de Riez et Pierre, Prévot, et Raymond, et Marc avec tous les autres Chanoines. Nous anathématisons et maudissons tous ceux qui voudront s'opposer à cette donation ou l'affaiblir."
Ainsi le manque de ministre fût une des causes des donations, mais il y en eut d'autres qui sont en dehors de notre sujet.
Il nous faut ici rectifier une erreur. en effet Nous lisons successivement:
-"La paroisse de Baudinard dédiée à St Michel Archange est desservie par un curé...etc. " ( Achard )
-L'Eglise de Baudinard est dédiée à St Michel Archange...etc." ( Noyon )
-L'Eglise paroissiale de Baudinard était dédiée à Michel l'Archange. En
Noyon et Bouisson ont copié Achard sans vérifier. Or, nous venons de voir qu'à l'origine l'Eglise était dédiée à St Jacques, mais dès 1599 ( les archives communales ne commencent qu'en 1591 ) , nous trouvons N-D expressément désignée comme patronne du lieu. Il est fort possible que les Moines de Lérins aient procédé a ce changement lorsqu'ils abandonnèrent N-D de Valmogne.
En tous cas, St Michel l'Archange n'a jamais été patron, ni titulaire de l'Église paroissiale.
Que restait-il au Vicaire comme bénéfices de la cure?
Nous possédons dans les archives départementales des Bouches du Rhône, une déclaration faite par le vicaire de Baudinard en 1674, en réponse à une demande du Roi :
" Déclaration par Et. Peygner, Vicaire du lieu Beaudinar Diocèse de Riez, donnée par devant le greffe de
" Dit que
"Consiste encore à la 1/2 du disme du vin pouvant rendre 24 coupes et la coupe est de 26 pots, se vendant 1 sol le pot, à raison du vintain."
"Consiste encore au tiers des amandes qui peut valoir 4 à 5 sous, à la raison susdite (vintain )
"Consiste encore au dixme du chanvre et légumes qui peut rendre de 6 à
" Il n'y à aucun domaine dépendant de ladite Vicairie que la maison clostrale où j'habite."
" En conséquence de ladite Vicairie, je paye tontes les années 7 à sous d'obédience. Je suis obligé d'entretenir un clerc et fournir l'huile de la lampe qui brûle ordinairement devant le St Sacrement, je suis obligé de fournir le linge des autels, pain et vin, et linge pour le divin office."
"Et pour affirmer la vérité de tout ce qui est dessus, me suis signé, Beaudinar, le 10 Février 1674: Peygner, Vicaire."
Voici d'autre part, la déclaration faite par le curé Mégy, en 1790:
Recettes: Revenus
"Clérmatines" 65 "
Messes de fondation 7 " 10 sous
autres fondations 1 " 9 "
Charges: Décimes 49 " 10 sous
Fournitures 80 "
Le 6 Mars
Ainsi dans l'extrait cité ci-dessus, Bouisson affirme que l'Abbaye de Lérins possède l'Église de Beaudinard juste au moment où venant de la céder, ce n'est plus exact!
Donc en
la vie religieuse de Baudinard continue son cours à travers les Siècles sans incidents notables. ( voir dans
Les visites pastorales étaient peu fréquentes. Dans le Cahier de doléances que les États de Provence firent parvenir aux États Généraux du Royaume, en 1587, figure le voeu suivant: inviter les Evêques à faire la visite pastorale de leurs Diocèses.
Nous ne parlerons pas des divers Propres qui se sont succédés dans le Paroisse: ils étaient obligatoires pour tout le Diocèse et ne présentent par conséquent aucun intérêt particulier.
( D'ailleurs dans le village, nous avons donné intégralement le Calendrier perpétuel de
mais l'historien impartial se doit bien d'insister sur le caractère profond du sentiment religieux et de la foi de nos aïeux. On verra dans
Voici par ailleurs et à ce sujet quelques délibérations et comptes trésoreries parmi les plus probants:
- 1599 - Secours aux pauvres à l'occasion de la procession qui doit aller à Moutiers " en dévotion ".
- 1752 - Délibéré de faire une neuvaine à N-D de
-1789 - Extrait de délibération du Conseil permanent condamnant divers jeunes gens à
il s'y mêlait même parfois un rien de superstition
- 1785 -( et plusieurs autres fois) Pour faire sonner la cloche de N-D de
- 1686 - Versé à N. Vicaire de Baudinard pour l'adjuration des vers
l'Archevêque d'Aix avait été obligé par ses ouailles à procéder lui même à pareille cérémonie et le Parement avait ouvert un procès contre ces indésirables.
Actuellement la Paroisse fait partie du Diocèse de Fréjus et Toulon
Archiprêtre de Brignoles et doyenné d'Aups.
Ajoutons enfin, pour être complets, qu'il n'y avait à Baudinard, ni juif, ni protestant et que les obsèques civile& étaient une infime exception.
CHAPITRE III : Chapelles, Oratoires, Croix.
Chapelle N-D de
Nous commençons l'étude
des Chapelles rurales par N-D de
La légende dit:
" une mère
excédée de voir la discorde régner entre ses 3 filles,
les sépara et les plaça au sommet de 3 collines éloignées:
ainsi dit-elle vous vous regarderez, mais vous ne vous disputerez plus "
Ces 3 filles sont N-D de Puimoisson, N-D de Beauvoir à Moustiers
et N-D de
Ce sanctuaire est situé à
De ce belvédère de
- Parmi les localités : Sorps, Bauduen,
Aiguines, Ste-Croix, Riez, Moustiers, Puimoisson, Montpezat, St-Laurent,
Artignosc, Villeneuve, St Julien le Montagnier, St-Pierre, Fox-Emphoux,
- Comme montagnes: au S-E la vue est limitée
par la longue colline qui se dirige vers les Espiguièaes, mais dans
les autres directions, on voit : Le Pain de Munitions, le Bessillon,
On s'y rend de Baudinard par le Château,, son
esplanade, puis après le grand lacet du début pour atteindre
la ligne de faite de la colline, on une large allée rectiligne qui
suit la crête, à travers une belle belle chênaie.
Ce chemin était autrefois bordé
par 14 stations avec niches et croix, sur leur emplacement, il ne demeure
que quelques tas de pierres. Au bout de l'allée, à droite
en arrivant à
-1599: Vote de 30 sous à l'ermite de N-D, pour faire une porte à
-1608: Charge aux Consuls d'emprunter 30 écus pour les employer à la finition de
-1610: Vote d'un capage pour achever la chapelle N-D.
L'ancien autel a été démoli en 1862 et remplacé par l'autel actuel en marbre. Le décor de
- Sur l'autel, une Vierge en bois, portant l'enfant Jésus;
- Sur le mur Ouest, une grande fresque très naïve;
- Sur le mur Est est accroché un grand tableau sur toile,représentant l'Assomption, daté de 1643 ( ou 1648 );
- Et de nombreux ex-votos.
Le Chanoine Bouisson a écrit qu'en 1706, on fit don à
Sous les dalles, à l'Est de l'autel se trouve un tombeau; nous avons relevé dans les registres de catholicité qu'on y a enterré, au XVII è et au XVIII-èm Siècle, un Vicaire, deux ermites et Toussaint de Sabran, décédé à lège de 7 ans,en 1699, fils du Seigneur Jean-François de Sabran et d'Élisabeth de Glandeves, sa femme.
La cloche date de 1756; elle fût baptisée le 4 Avril " Baptême d'une cloche sanctifiée et consacrée en l'honneur de Ste-Thérèse. Parrain Joseph Jules de Sabran, Seigneur de Baudinard,Montblanc, Villevieille et autres places, lieutenant des Maréchaux de France; marraines Thérèse d'Arlatan, Dame de ce lieu. "Cette cloche. reçut la bénédiction 2 jours plus tard, le 6 Avril, Cette cérémonie est relatée presque dans les mêmes termes que pour le baptême " Bénédiction de la cloche de N-D, en l'honneur de Ste Thérèse... "( le reste sans changement )
Sur l'Esplanade devant
Le logement de l'ermite te trouvait sur le coté Est de
Une de ses charges est de sonner la cloche, en cas d'orages "Accord de
Ces dernières étaient assez fréquentes. C'est ainsi qu'en 1706, Nicolas de Sabran, Capitaine de vaisseau, frère du Seigneur, fit un don
de
Le lendemain jour de l'assomption, à 9 h, une grande procession reprenait le chemin de
, comprenant tambours, commissaires de
la fête,
"joyo"( prix des courses et des jeux suspendus. au gaïardiet"), prétres
de la localité et des paroisses, voisines et une très nombreuse
affluence. Une grange messe était chantée à l'issue
de laquelle tout le monde. revenait au village,
après; avoir cassé la croûte et vidé quelques
bouteilles. Le procession fut interdite à partir de 1904.
Chapelle
st-Michel.
St Michel, prieuré avec chapellerrie
servait de prébende à un Chanoine d'Aups, co-décimateur.
Cette prébende resta l'apanage de la famille Thadey de 1599 à
En 1704, Thadey s'engage à assurer le service de 10 messes à partit du 1 er Juillet à
qui seront distribuées en aumônes.
A une 100 ainnes de m de
se trouve une imposante ruine carrée,
dont il ne reste que des pans de murs, avec au milieu un espèce de
calvaire qui ne servait peut-être qu'à soutenir l'angle central
des 4 pièces. On ns sait rien sur cette ruine qui fût sûrement
une dépendance du Prieuré ainsi que la ferme qui possédé encore
son colombier.
Chapelle
St Jean
Aujourd'hui désaffectée, elle est orientée au S-E. C'est un sanctuaire sans caractère, tout petit, rectangulaire(
les fidèles y venaient en procession, le jour de,
blé. ( Nous avons rappelé longuement cette coutume dans le village.)
Le sol de
Chapelle St-Elzéar?
Cette petite chapelle romane de
On ne sait rien sur elle sinon qu'un vieux tableau représentant St Elzéar et Ste Delphine y figura longtemps ( il fut enlevé au XX è Siècle par le propriétaire de la ferme) au-dessus de l'autel massif. Une fresque marque l'emplacement qu'il occupait: 2 vases de fleurs, un de chaque coté, avec au dessus une couronne et 2 branches d'ormeau; sur chacune des 2 parois courent des filets reliant 3 colonnes, le tout très simple et sans aucun caractère artistique.
On peut signaler encore un occlus fermé seulement de 2 pierres dont la plus basse constitue tout le dessus de la porte, la dépassant largement des deux cotés.
Chapelle Ste Catherine.
En 1696, le Conseil de
On ignore tout de cette Chapelle et de son emplacement; on ne sait même pas si elle fût construite.
Chapelle N.D des Grâces à
Une pièce, non datée, des Archives communales indique que
On ne sait rien de cette Chapelle, même pas l'endroit exact où elle était située.
Chapelle St Jacques.
Le Chanoine Bouisson a écrit "au quartier de St Jaume sa se trouvait
Tout. cela est faux ,
1113 est la date de confirmation de cette donation
Il n'est nulle part question d'une Chapelle. au quartier St jaume.
Lorsque l' Église paroissiale fut dédie . à N-D, il est probable qu'une Chapelle de cette église resta , consacrée à Jacques, cette chapelle avait une chapellerie ainsi qu'il ressort d'une lettre conservée dans les Archives dans laquelle Mme Roux, Vve Bourges, demande l'extrait du cadastre des biens de
ORATOIRES
Disséminés à travers la campagne, on les rencontre le long des routes et des chemins, aux carrefours, en bordure de colline, à 1a sortie et même au milieu des villages. Un grand nombre jalonnent un itinéraire, principalement la voie conduisant à une Chapelle, lieu de pèlerinage .
Ces édicules sont d'origine païenne et ils étaient dédiés à une divinité unique le dieu Priape; lors de l'établissement du Christianisme les Oratoires furent maintenus, nais transformés pour servir le nouveau culte et placés sous le vocable de N-D et des Saints de la nouvelle religion.
Les oratoires sont très nombreux en Provence, en ruines ou restaures,on en rencontre dans toutes les localités (Rians détient le record varois avec 17 oratoires érigés sur son territoire).
Voici ceux de Baudinard:
Oratoire Ste Catherine.
Il est situé sur des rochers 'bordant la route qui se dirige vers Aups, à l'embranchement de l'ancien " camin roumian" dont nous avons parlé. Il est très ancien et on lui a donné' le vocable de St Catherine en souvenir du Monastère de Sorps.
Il fût restauré en 1892, par des ouvriers travaillant à la rectification de la route, en reconnaissance de ce que les travaux s'étaient terminés sans accident.
Il est construit en moellons avec niche à arc surbaissé, grille, plaque et croix. Il porte cette inscription
A Ste Catherine. Hommage reconnaissant Baudinard 1892
Oratoire Sant-Espero.
Il se trouve sur un raccourci qui coupe-le
grand lacet de la montée à N-D de
Pregas per noutre.
dont le sens peut-être interprété de diverses façons.
Oratoire St Etienne.
il s'élève à l'extrémité et à droite de la vallée qui aboutit à
Il fût construit en mémoire de ses trois filles défuntes a écrit M.Henselinq. Nous ignorons où ce renseignement a été puisé, mais nous n'avons rencontre aucun Etienne dans notre généalogie des Sabran Baudinard.
Oratoire St Michel.
Il se dresse sur l'aire, tout à côté de la ferme St Michel. Il a été dédiés, en 1940, par les soins de Mme Jauffret, pour la protection des soldats de baudinard pendant la guerre. Il est carré; niche renfermant St-Michel; croix en fer surmontant le tout. Il présente une particularité curieuse
curieuse, actuellement invisible: à l'Oratoire même, gravé dans le ciment on pouvait lire
Baudinard
5/8 1940
Une plaque en marbre recouvre cette inscription et porte:
St Michel
Protéges-nous
Baudinard 1939
ce qui la vieillit d'un an.
Oratoire de Barbabelle
( ce qu'il en reste en 2005 )
Il a été élevé
en 1941, auprès de la ferme de ce nom, par Mme Constant, propriétaire
de la ferme, en souvenir familial. Il est construit en briques, carrés,
sans socle, toiture à 2 pentes, avec niche et croix de fer au sommet.
Il est dédié à St Maurice.
Croix dominant le village.
Sur le chemin de N-D, lorsqu'on grimpe
pour arriver sur le faite de le colline, avant de prendre l'allée rectiligne,
et juste dans l'axe de la grand rue de Baudinard, côté Aups,
se trouve une croix placée au sommet d'un tronc de pyramide, assis
lui-même sur un socle. Sur celui-ci
on lit:
SPES UNICA
1934
".
Croix de St
Jean.
C'est une croix de mission dressée
en 1859, sur le bord de la route auprès des aires de St Jean; elle
comporte un soubassement et un socle en pierres de taille, surmonté
d'une assez grande croix en fer; elle à été réparée
en 1948.
Vieille croix
en bois.
Elle se trouve à
Disons tout de suite que Sorps - du latin
"Sugère" , l'ancien Sorpius des
Romains, plus tard Pont de Corps (ou Font de Corps), Souas en Provencal,
aujourd'hui Fontaine-l'Évêque, ne se trouve pas situé
sur le territoire de Baudinard; il en est distant de quelques centaines
de mètres et fait partie de
La célèbre source est la
résurgence des infiltrations absorbées par le Plan de Canjuers
et aussi les pertes de l'Artuby:
La source s'échappe bouillonnante
et écumeuse d'une grotte basse et profonde, située à
5 ou
La source naît eau milieu d'une végétation
luxuriante- arbres et arbustes touffus et entremêlés, actionne,
par une petite dérivation, le moulin à farine, passe sous
un ponceau et après un cours sinueux et paisible d'une longueur
inférieure à
L'embranchement de
C'est le,12
Octobre 1256, que Foulque de Caille,Eveque de Riez, fonda, à Corps
le Monastère de Ste-Catherine.Le village de Corps relevait de
L'Abbaye comprenait 100 religieuses soumises
à la règle de St Augustin sous le titre de Ste Catherine,vierge
et martyre, Foulque la fonda parce qu'il n'existait aucune Abbaye dans
le Diocèse de Riez.
La clôture la plus sévère
y était,gardée de telle sorte que ni l'Evêque fondateur,
ni ses successeurs ne pouvaient entrer dans le Monastère sans être
revêtus des ornements sacerdotaux ou du moins du surplis, de la
chape, de la mitre et de la crosse.
Le fondateur donna à perpétuité
à l'Abbaye et à
à titre de dotation, les Églises de St-Jurs, de
Fontcastellân, de Montpezat, d'Artignosc et de Moissac, tout en
se réservant pour lui et pour ses successeurs, les droits de visite,
de procuration, de correction et les impôts ou quêtes dans
les Églises de St-Juers et de Montpezat, quand il en sera fait
dans les autres Églises du Diocèse... Foulque enfin donna
la 1/19° partie du blé qui lui revenait dans l'Église
de Vaumeilh et les 8/9° que lui payait l'Église de montmeyan.
Le monastére pouvait de plus accepter et acquérir sans l'assentiment
de l'Évêque, tout ce que voudraient lui donner ou vendre
les autres Seigneurs de Ste-Croix, de Montpezat, de bauduen.
En cette année 1256 eut lieu lu
transaction dont nous avons parlé : le Monastère de Lérins
donne à Ste Catherine les Églises de Baudinard et de Valmogne
et reçoit en échange le Prieuré d'Artignosc. (
Charte h° 44 )
En 1257, Charles d'Anjou et Béatrix,
sa femme, firent abandon des censes royales de Montagnac, Ste Croix, montpezat
et St Laurent en faveur de Ste Catherine.
Le 27 août 1258, Foulque confirma
la donation faite au monastère de Corps, par Hugues de Bédouin
ou de Bauduen, Prieur d'Anégrand, de l'Église St André
de Orbellis et de St-Barthélémy, à Boudent. Bouche
dit que c'était une donation sans grande valeur: St André
d'Orbellis, Était à cette époque désert et
abandonné et les biens de l'Église St Barthélemy
étaient dans la même situation.
En même temps que le monastère
de Ste Catherine, Foulque de Caille fonda
A côté de ces deux établissements,
L’Evêque fit construire une maison hospitalière pour
les pauvre& pélerins qui se rendaient à St Jacques de
Compostelle, par l'ancienne Voie romaine. Le service de l'Hôpital
était assuré par des frères convers.
L'ensemble de ces 3 constructions coûta
30.000 livrets tournois. Les Rois d'Angleterre, de Portugal et le Comte
Raymond Bérangèr avaient fait présent à Foulque
de cette somme par estime personnelle.
En 1262, 7 ans après la fondation,
Foulque promulgua les statuts définitifs de Ste Catherine. Ils
prévoyaient :
- l'observance de la règle de St
Augustin;
- l'habit blanc et la face voilée;
- la réglementation de la nourriture
de
- la fixation de la somme à donner
pour le vestiaire de chaque religieuse;
- la quantité de denrées
à fournir en nature etc..
Mais l'Évêque ne perdit pas
de vue le Monastère et ses bienfaits continuèrent: par acte
du 3 Juin 1265, il déclara concéder à perpétuité
à Dame Habile, ( c'était la 1ère
Abbesse du Monastère), à Dame Marie Foulque, sous Prieure,
à Dame Raymond de St-Trophime, sacristine, à Dom
Pierre Dupont, Prévôt et à
l'Abbaye de Ste Catherine de sorps, les justices et les biens qu'il s'
était précédemment réservés dans la
donation du lieu de Ste Croix, et en 1269, il donna encore à l'Abbaye
divers manuscrits, des meubles et de la vaisselle d'argent et de vermeil.
Les successeurs de Foulque furent moins
bienveillants envers Ste Catherine et l'un d’entre eux Mathieu 1er
de puppic eût avec l'Abbaye des demeleés qui
furent tranchés par une sentence arbitrale qui rétablit
l'Abbaye dans tous ses droits. ( 1280)
La 2ième Abbesse du Monastère
fût Cécile de Puget, qui fit venir auprès d'elle sa
nièce, Delphine de Signes, fille de Guillaume de Signes, des Vicomtes
de Marseille, co-seigneur d'Ollioules et d'Évenos, et de Delphine
de Barras, fille du seigneur de St Estève et de Louise de Puget,
Dame de Puymichel. Delphine est née en 1283 ou 1284, à
Puymichel; elle avait un frère, Guillaume, Seigneur de Puymichel
et une soeur , Alsacie.
C'est ainsi dans l'Eglise de l'Abbaye de
Ste Catherine de sorps que, d'après la tradition, Delphine vit
pour la 1ère fois celui qui allait devenir et son époux
et un grand Saint Elzéar de Sabran.
Certains auteurs ont prétendu qu’elzeard
était venu à Sorps pour y rencontrer sa cousine Ste Roseline
de Villeneuve ( dont la mère était
une Sabran), mais ce s'est pas exact: d'après Albanés Ste-Roseline
a vécu environ 1 an à Ste Catherine, es 1319-1320; or à
cette date le mariage d'Elzear et de Delphisne avait déjà
été célébré. D'Autre part, il n'est
pas sûr du tout qu'Elzear soit venu à sorps, tout au moins
avant son mariage.
Elzéar, de la noble et vieille famille
provençale des Sabra,, alliée aux Comtes de Forcalquier,
Comte d'Arian, Baron d'Ansouis, de
Delphine, Dame de Puymichel, possédant
8 places et de nombreux fiefs: nobles, était considérée
comme le plus grand parti de
" Le 4ième jour des noces,
écrit Nostradamus, on amena La demoiselle Delphine à son
mari pour accomplir et consumer cette hyménée, au Chateau
d'Ansouis, mais elle qui avait contractée un plus sublime mariage
avec son dieu, fondant en larmes, avec une voix plaintive et plus douce
que celles d'un ange qui semblait bien donner quelques rayons divins à
sa naturelle beauté, déclara à son époux qu'on
l'avait forcée à ces noces mondaines et qu'elle avait fait
vœu de perpétuelle virginité. Ces saintes paroles touchèrent
si tendrement le coeur de st Elzéar déjà porté
à quelque sainteté pareille, par le souffle de l'Esprit
Sainct, qu'il s'abstint non seulement de la toucher, et fit de ce point
mesmne un même voeu de continence et de chasteté...
Au moyen de quoi vivant avec sa chère et saincte espouse, usant
de mesme logis, mesme chambre, mesme table et mesme lict, ils gardèrent
entièrement la chasteté"
Nostradamus nous a ainsi donné la
version de l'Historien qui prend parfois quelques licences avec la vérité;
d'après MMe de Forbin, autrement exacte, la chose ne fut pas aussi
simple que veut bien le dire le neveu du grand prophète et si Elzéar
respecta toujours la chasteté de son épouse, il ne prononça
lui méme ce voeu de chasteté que plusieurs années
après le mariage.
Quelques années après son
mariages, Elzéar fut désigné comme Gouverneur de
Charles, duc de Calabre, fils aîné du roi Robert puis à
la mort de son grand père père Hermengaud, Elzéar
le remplaça dans ses fonctions de grand Justicier du Royaume de
Naples. Les 2 époux furent alors obligés de mener une vie
mondaine à
En 1307 date le la mort de son père,
Elzear est de passage Toulon; il se rend dans le royaume de Naples prendre
possession du Comté d'Ariano et en recevoir l'investiture des mains
du Roi Charles II. Nous le retrouvons à Toulon en 1317. Il y fait
son testament le 18 Juillet par devant maître cornille, notaire,
en présence de 7 témoins. Sa femme est avec lui, ils allaient
de nouveau à Naples, appelés par le Roi Robert qui envoya
Elzêar en ambassade à
Après une vie exemplaire, Elzéar
mourût le 27 Septembre 1323. Il rendit le dernier soupir sous l'habit
religieux de St François, parce s'il s'était fait recevoir
du tiers ordre et voulût être enterré dans leur Eglise
d'Apt.
Urbain V le mît au rang des saints.
le 16 Avril 1369, mais la bulle de canonisation
ne fût publiée que le 5 Janvier 1371,
Delphine, veuve de St-Elzéar devait
lui survivre 37 ans. Elle fut humble et charitable. Elle se dépouilla
de tous ses biens en faveur des pauvres et de l'Église et mourût
en 1360. Elle n'a point été mise solennellement au rang
des Saints. Le Pape Urbain V mourût alors qu'il procédait
à sa canonisation et, après sa mort, les troubles de
Les beaux jours du monastère ne
devaient durer qu'environ 150 ans. Par suite du mauvais climat, cause
de nombreuses maladies ,le nombre des religieuses
était tombé de 100 à 4, les Chanoines étaient
allés s'établir à St-Juers, ne laissant qu'un seul
prêtre, lorsque sous l'épiscopat de l'Évêque
Michel de Bouliers, une bulle du Pape supprima les 2 maisons ( Eugène
IV, 4 Octobre 1435).
Michel de Bouliers pour essayer de sauver
le Monastère adjugea à
Le 6 Octobre 1499, le jeune Évêque
Antoine Lascaris de Tende fit unir à son siège, par décision
papale, le Prieuré régulier de St Catherine de Sorps, acte
qu'Albanés juge assez sévèrement.
Enfin en 1678, le Christ de l'Abbaye de
Ste-Catherine fut porté à l'Eglise paroissiale de
Bauduen. Il ne reste plus aujourd'hui de toute cette gloire qu'un pan
de mur de
Mais avant cette dernière date,
Sorps fut le témoin d'un autre événement qui devait
changer le nom de cette célèbre source.
En
1631, Louis Doni d'Attichy devint, à 30 ans, Évêque
de Riez. il était timide, la ville lui
était déjà une prison et la solitude un paradis.
Pour
bien mettre en pratique ses sentiments et vivre dans la solitude qu'il
aimait tant, il fit construire à Sorps une belle maison de campagne.
Commencées en 1632,
Le maison était très petite, mais elle contenait
des logements suffisants pour l'Evêque, sa famille et des hôtes.
Elle
était entourés de viviers construits
de telle sorte que des truites délicieuses pouvaient s'introduire
dans le bassin mais ne pouvaient plus en sortir.
Les abords du château n'étaient
que jardins fleuris et prairies verdoyantes. Mais de toutes les beautés
et de tous les charmes de cette résidence, le plus rare était
la source même, la source aux eaux diaphanes, pures comme un miroir,
fraîche en été, tièdes en hiver. Bref, un véritable
paradis terrestre.
Les successeurs de doni d'Attichy n'affichèrent
pas pour la solitude la même ferveur que lui, la villa fut peu et
mal. entretenue et un beau jour une crue du Verdon qui en connaît
de terribles, l'emporta dans ses eaux boueuses. Il ne reste plus aujourd
hui qu'un pan de mur et 2 ponceaux et peut-être les platanes géants,
de ce qui fut autrefois le lieu de prédilection de l'Evêque
et aussi le nouveau nom de la source: Fontaine l'Evêque.
A l'heure actuelle, Fontaine l'Evêque
est un but d'excursion très couru ( on ne comprend pas pourquoi
le circuit officiel des Gorges du Verdon ne l'a pas englobé dans
son itinéraire), et, aussi le rendez-vous de la jeunesse des environs
le 3° jour des fêtes patronales de Bauduen et de Baudinard,
( voir mon ouvrage sur lessivage" ou j'en parle longuement) et souhaitons
que malgré tous les projets conçus, la belle source restera,
toujours dans son état actuel pour la plus grande joie des amateurs
d'art et de la nature dans ses grandioses manifestations.
Troisième Partie : Les Seigneurs
Chapitre Premier:
Les Blacas-Baudinard
Contrairement à la tradition et
l'opinion admise, les Blacas ne furent pas les premiers Seigneurs de
Baudinard.
Guillaume II de Blacas, petit-fils du
Grand Blacas, qui, d'après les auteurs - Artefeuil, du Roure,
etc.. est la tige des Blacas-Baudinard,
n'apparaît qu'une seule fois dans l'histoire, et en 1261, dans
le testament de sa cousine germaine Sibylle, Dame de Toulon. Dans
cet unique document, ce Blacas est dit "Guillaume de Baudinard" sans
qu'il soit specifié " Seigneur de Baudinard".
Or, il n'est pas le premier Blacas de
Baudînard; nous verrons plus loin qu'un frère du Grand
Blacas, figure sous la dénomination de Raymond de Baudinard, dans une: Charte de 1205-07;
signalons que tout comme guillaume en 1261, il n'y est pas désigne
comme Seigneur de Baudinard
Mais avant eux, il a existé des
Seigneurs de Baudinard:
-a) Dans:
- b) En 1134, Foulque de Caille, Évêque de Riez, confirme aux Hospitaliers de St Jean la donation de l'Église paroissiale de Puimoisson et en 1155, Pierre Géraud, successeur de Foulque de Caille à l'Évêché de Riez, confirme à nouveau cette donation. Ces 2 Chartes sont dressées en présence de Guillaume de Baudinard et de Maînfroid, Hospitalier; en faveur de qui la donation était faite. ( Ce Guillaume ne peut pas être le Guillaume de Blacas dont nous avons parlé et se-disant tige des Blacas-baudinard, ce dernier vivra environ 100 ans plus tard. )
- c) Et surtout Pons Albert et son frère Guy de Baudinard, désignés dans plusieurs actes comme Seigneurs de Baudinard:
1° ) En 1206, donation par Pons Albert et Guy de Baudinard, Seigneurs de Baudinard à guillaume de
2° ) Charte de 1223: Pons Albert, Seigneur de Baudinard (il n'y est pas question de Guy, qui est peut-être mort à cette date) donne à Guillaume de Moissac, précepteur des templiers de St Maurice des terres sises, à Pont d'Isle et Collonges ( sceau conservé).
3° ) Grasset indique comme membre de
St Vincent, c'était une dépendance de St Maurice qui consistait en un vaste domaine de 100 charges de semence en labourage, avec bois, prés, bâtiment et juridiction entière et tirait son origine d'une donation de Pons Albert, Seigneur de Baudinard et Coutelas, en 1223.
Et de ce que Baudinard t'appartenait pas encore aux Blacas à cette époque nous avons deux autres preuves:
a/ Dans une Charte de 1235, Bertrand et boniface de Blacas, fils du Grand blacas et de leur mère Laure, concèdent aux Hospitaliers de Puimoisson, des droits de dépaissance dans toutes leurs terres sises à Aups, Moissac, Tourtour, Fabrègues et Fox-Amrphoux. On voit qu'il n'y est pas question de Baudinard.( Notons au passage que le Boniface dont il est parlé dans cette charte et le père de guillaume soi-disant tige des Blacas Baudinard)
De cette même année 1235 nous possédons les statuts de Rayonnd-Berenger V, pour la ville de Frejus. Dans le Chapitre des cavalcades, les impositions se trouvent rassemblés par seigneurie, et nous trouvons:
"Beldinar et coutellars", un Chevalier; et plus loin:
" Almis( Aups), et tortor( tourtour) et Fabrègue et Moissaco et Valli de fos , 3 chevaliers.
Comment les B1acas sont-ils devenus seigneurs de Baudinard? On ne le sait pas . Voici toutefois une hypothèse vraisemblable: la fille( ou la sour) de Pons Albert se serait mariée avec Raymond de Blacas, frère du Grand guerrier, et héritière de son père (ou de son frère) aurait apporté en dot à son mari,
Ce Raymond de B1acas, que nous croyons tige des Blacas Baudinard figure ainsi que nous l'avons dit, dans une Charte de 1206-07: Confirmation par Alphonse II, en faveur du monastère de N-D du Thoronet ou de Floryèges, de la donation faite par Blacas de Blacas et son frère Raymond de Baudinard, de la 1/2 du Château du Château de Verignon.
Raymond est encore vivant et 1231; dans une vente de son frère le Grand Blacas et Laure , femme de ce dernier, aux Hospitaliers de St Jean il est dit: l'acte est passé au Château d'Aups, dans la maison de Raymond
Raymond eut une fille, Guillelme ou Guillemette, mariée avec Guy de Fos, Seigneur d'Hyéres et probablement un fils, Albert I re de Blacas.( Nous disons probablement parce que cette filiation n'est pas confirmée par un document). Albert 1er est le 1° de Blacas qui apparaît dans un acte conservé, comme Seigneur de Baudinard.
D'Albert 1er, nous avons:
-1° ) Une fille, Mabille, mariée avec Guillaume de Méllis, Il existe aux archives départementales du Var, un acte de donation de Guillaume de Mellis à Albert de Blacas, de tous les biens qui lui avaient été, donnés par Mabille de Blacas, son épouse, fille du susdit Albert, Seigneur de Baudinard, d'Aiguines et d'Espinausse.. ( 1244)
-2° ) Un fils, Jean qui teste. en 1300, instituant son fils Albert (II) héritier général et universel( testament conserve).
Albert II de Blacas eut au moins 2 fils: Albert (III) et Bertrand ici, nous rejoignons le Baron du Roure qui croit, sans preuves- qu' Albert qu'il dénomme I re et Bertrand sont les fils de Guillaume, soi disant tige des Blacas-Baudinard. Or il existe. aux Archives départementales du Var, une transaction entre
Bertrand se marie et 1322 ver Huguette des Baux, dite Baucette qui eut une grande renommée et fut chantée par de nombreux troubadours dont Pierre Roger.
Albert III de Blacas dit le Gros, Seigneur de Baudinard et d'Aiguines, se marie avec Iseulde de Justas, Dame en partie de Levins
Il existe une transaction passée entre Noble Albert de Blacas, Iseude de Blacas, son épouse, Dame en partie de Levens et les Consuls de Levens) et Dame en-partie d'Aiguines( dans son testament, elle se dit Noble Dame Iseude, Dame d'Aiguines, mariée à Albert de Blacas, Seigneur de Baudinard).
Il eurent de nombreux enfants:
1 ) Guillaume, Seigneur de Baudinard et d'Aiguines, qui suit.
2 ) Blacas de Blacas , hérite de son cousin en 1361 et meurt sans postérité
3 ) Constance, mariée en 1330, avec Boniface VIII de Castellane Quittances de diverses sommes données à compte de la dot de constance de Blacas, faites à Noble Albert de Blacas, son père, par Noble Boniface de Castellane, son mari (1336-1355) ( Arch. du Var). Elle teste en faveur de sa nièce, Alasacie.
4 ) Pons, mort sans postérité.
5 ) Etiennette, se marie avec Reynes de Vintimille, Seigneur de
6 ) Mételine, mariée avec Guillaume d'Enduze de
7 ) marguerite de Blacas.
8 ) Cécile de Blacas
9 ) Iseude de Blacas
10 ) Béatrix de Blacas
11 ) Mabille de Blacas
Ces quatre dernières soeurs furent religieuses à
Guillaume de Blacas de Baudinard et d'Aiguine
se marie en 1321 , avec cecile de villeneuve.
Raymond seigneur d'ampus . Au moment de leur
mariage les parents de guillaume albert III de Blacas et iseude de justas
firent par ecrit la promesse de le faire leur heritier universel
.Le père est mort "ab intestat"
mais la mère a tenue sa promesse (Testament- conserve).
On possède aussi,,une reconnaissance
de dot de Cécile de Villeneuve de l'année 1336 .
De cette union sont nés
1) Blacasson de Blacas, mort avant-1333.
2) Poncet mort jeune
3) Boniface, mort
."ab intestat"
4 )Albert IV de Blacas
, qui suit
5)Alsacie, de Blacas mariée avec
florent de castellane, seigneur d'andon. Le contrat est signé
à Baudinard en 1363, "
infra fortalicium " et le mariage est célébré
à Baudinard ,le 19 mai 1364, toujours 'infra fortalicium' alsacie
hérite de la tante Constance et fait une donation et une renonciation de
droits. en faveur de son frère Albert.
6)Mabile de Blasa,
7) Iseude de Blacas, mariée avec
Louis de Moustiers. Seigneur de Blacas Blacas ventavo et morte avant
le 10 Septembre 1400.( Des quittances de
diverses sommes données à compte de la dot d'iseude de
Blacas, faites à cecile de Blacas sa mère et à
Albert de Blacas son frère, Seigneur de Baudinard et d'aiguines,
par Noble Louis de Moustiers, Seigneur de Ventavon, son mari,
de 1356 à 1370, existent aux Arch. dép.
du Var. )
8 ) Métheline de Blacas, morte " ab intestat".
9 ) Baussette.
10) Cécile.
11) Philippine.
Ces trois dernières soeurs, ignorées
de du Roure, apparaissent dans une transaction avec Albert de Blacas,
leur frère, en 1375.
Albert IX de Blacas, Seigneur de Baudinard,
dtAiguines et co-seigneur d'Aups se marie vers 1350 avec Catherine Gantelmi,
fille de Gantelmi de Baudinard et de Baucie des Baux. acquiert
la, terre de Bras, écrit du Roure; c'est le Bras d' Asse qu'il
s'agit. Mais il avait d'autres fiefs dans les Basses Alpes. Nous avons
vu que son aïeul étaiIlt déjà Seigneur d'Espinouse;
Albert IV eût des terres et des droits à Bras d'Asse, Espinousse,
St-Jeannet, Thohard, Bellegarde et Estoublon.
En 1346, une grande assemblée
des Seigneurs et des Communautés se réunit à Aix,
pour protester contre la, nomination faite par
En 1373, B. Fabre, des Salles, prête
hommage à, son seigneur: Noble Blacas de Baudinard, seigneur
d'Espinouse, d'Aups et de St Jeannet. ( document
conservé )
De 1' année 1368, on a un
acte de cession de 60 florins d'ors à prendre sur Albert IV de
Blacas,seigneur des baudinard et d'aiguines fait par noble rosselin
de fos, seigneur de bormes au profit d'adhemar de vonta évêque
de lucon. ( Nous, avons vu qu'une tante d'Albert IV metheline s'était
mariée ave guillaume d'andouze de
A La mort de
Les partisans de Charles de Dures, sous
1e commandement ,d'Albert IV de Blacas Sr
de Baudinard, voulurent soumettre la ville, Paillerols un des
2 quartiers de Moustier fûts pris et incendié; l'autre
quartier, les Baumettes résista et, Albert IV se retirât
sans l'avoir pris ,La ville n'eût pas de chance: en 1383, louis
de Triant chef du partie angevin, attaque Moustiers à son
tour et prend la ville d'assaut.
Sous le règne de- Marie de, Blois,
mère de louis II d'Anjou, la pacification se fit peu à
peu; les Blacas et les Sabran étaient déjà ralliés.
En 1390, Catherine Gantelmi, dame~de
Baudinard donne quittance du restant de la dot de sa mère,
feue Baucie de Baux et par le privilège, du 8 Décembre
1394,
dans leurs fiefs. ainsi qu'une
rente de 100 sous coronats,pour les récompenser de leur fidélité
et des pertes, qu'elles avent subi au siège de St Martin de
On ignore la date de la mort d'Albert
IV, mais d'après les termes de la donation ci-dessus, il était
mort en 1394 puisqu'elle ne vise que sa femme et sa fille déjà
mariée à cette date, pourtant il existe use donation du
couvent de
En tous cas. Albert de Blacas est mort
avant sa femme, Après son décès, Catherine Gantelmi
vécut en mauvaise intelligence avec sa belle-mère et fut
l'origine du procès que dut soutenir son gendre contre la famille
de Castellane, au sujet de l'hoirie des Blacas (procès fort long
et dont on ne connaît pas l'issue. )
De l'union Albert IV de Blasa- Catherine
Gantelmi ne naquît qu'une fille Baucette de Blacas, Dame de Baudînard,
d'Aiguines, Chantereine, St Julien, etc..
qui se maria en 1389, avec Elzéar de Sabran, Seigneur
d'Ansouîs et lui apportaient en dot tous ses biens faisant
ainsi passer Baudînard dans la maison de Sabran qui le gardera
jusqu'à
Vois les armes des Blasas
" D'argent, à la comette à
16 rais,de gueules. Tenant: 2 sauvages appuyés
sur leur massue, cimier 1 chêne ( le
Blacas provençal) Devise: " Pro Deo, Pro Rege". Cri: Vaillance."
L' écu qui ne comportait à l'origine qua "un Jeune,
chêne( le Blacas provençal.) et
peut-être un lion, aurait du être modifié à
la suite de l'apparition ,au cours d'une bataille, d'une espèce
d'auréole au dessus de la tête de Blacas signe qui amena,
la victoire.
Chapitre II
: Les Sabran-Baudinard
La noble famille de Sabran était
une des plus anciennes est des plus célèbres de Provence;
elle était alliée aux Comtes de Forcalquier et a compté
parmi ses membres nombre de grands personnages dont un des plus éminents
avait été St-Elzéar; la mère de Ste Roseline
de Villeneuve était Sibylle de Sabran, fille d'Elzéar
de Sabran, Comte de Forcalquier.
Armes des Sabran: de gueules, à
un lion d'argent; supports: 2 lions d'or; cimier, un lion naissant d'argent,
devise: "Noli irritare Leonem" ; sobriquet du Roi René: simplicité
des Sabran ou plus exactement simplesse des Sabran; jeton des Sabran:
au recto, un écu avec 3 fleurs de lys, posées 2 et
au verso, un écu avec le lion des Sabran.
Jean de Sabran, Baron d'Ansouis, père
d'Elzéar, avait épousé Isoarde de Roquefeuil, Dame
de Puyloubier, des Vicomtes de Marseille. Dans une convention passée
à Naples le 17 Février 1375, il est qualifié de
Grand Chambellan de
Elzéar de Sabran est en Italie,
en 1382, avec son oncle Louis , de Sabran, tous les 2 gentilhommes de
la suite de Louis 1 er d'Anjou venu secourir
Nous avons dit à la fin du Cbapitre
précédent qu'elzear de sabran d'ansouis se maria
en 1389, avec Baussette de Blacas, dernière
rejeton de la lignée des Blacas Baudinard.
Voici quelques traces de l'activité
d'Elzéar de Sabran:
-
1390- Raymond de, Turenne
et ses bandes ravageaient 1a Provence. Des États furent tenus
à Aix afin de prendre des mesures énergiques pour
lutter contre lui , Elzeard y est délégué
comme député de la noblesse.
- 1393- Actes de reconnaissance de biens à
Bras par divers habitants du lieu, en faveur d'elzeard de sabran co-seigneur
de bras.
- 1409 Elzeard use de son droit de prelation
à levens en qualité de Majeur Seigneur de Levens.
- 1412.
Les 2 époux, Elzéar et Baucette, pretent hommage pour
pour partie de la seigneurie de Montpezat.
L'Assemblée générale
des états de Provence, reunis a aix à la mort du Roi Louis II décide d' envoyer des
ambassadeurs auprès du roi et de la Reine, pour obtenir
la réduction: des fouages la reine accepta qu'il fut procédé,
au "recursus" des fouages .Des délégués, furent.
chargés d'exécuter cette réduction.Elzéar
de Sabran est du nombre.
Elzear et baucette euren 3 fils.
- Albert, marié avec E1éonore
de Tornello, qui devait continuer la lignée des barons d'Ansouis, mais n'ayant eu
qu'une fille qui se maria avec Jean de castillon c'est son cadet.
-
Louis qui le remplaça comme
seigneur d*Ansouis.
- Jean de Sabran, qui, héritier
de mère Bauçette, par donation de tous ses biens, devint
la tige effective (1435) des sabran baudinard
Nous avons vu qu'en 1394,
Le 31 Juillet 1443, Jean de Sabran fait
hommage de sa terre de "Beaudinar" au Roi René.
Voici quelques traces de l'activité
de Jean, puisées dans les Arch. dés. du Var ( 1452- 1460 )
- Bail de ses droits à Levens
en faveur de Pierre Ferrier de Moustiers et Jean de Castellane,
co-seigneurs.
- Actes de reconnaissance de biens, à
Bras, par divers habitants du lieu.
- Extrait de l'acte de vente de
- Jean de Sabran est gentilhomme de la
suite du Duc de Calabre,fils du roi René,
lorsque le Duc essaya de s'emparer de Naples, en 1458, à la mort
d'Alphonse l'usurpateur.
Marié avec Yolande de St Marcel , Jean de Sabran n'eut qu'un fils Pierre qui se maria
avec Françoise de Vintimille.
Le 9 Avril 1487
les États de Provence se réunirent à Aix,
avec comme ordre du jour, la réunion de
Pierre vendit tous les droits qu'il
possédait à levens,à
Pierre de Matheron seigneur de peruse pour 7000 florins; vers la même
date il a des démêlés avec les habitants de Moustiers
au sujet de pacages sur le territoire d'Aiguines .
Le Roi René, le juge de la cour
royale de Moustier ,Raymond de Glandeves,conseiller
et chambellan du roi louis XII, intervinrent dans le procès qui
se termina par une transaction en 1536.
En 1503 Pierre achetât a son cousin
helien de Sabran tous les droits que les sabran possedaient dans le
royaume de naples et notamment
la baronie de calabre et les comtés
d'Arian et d'Apici.
En réalité depuis 1435
date du départ des francais de naples, la maison d'Arian etait
détruite, mais pierre avait de l'ambition et comptait bien récupérer
les terres napolitaines (30 seigneuries) qui avaient été
données en 1292 à Hernengaud de Sabran
, le père de St Elzear par le roi Charles-II
Lorsque Francois 1° était
au camp de Pavie, pierre de sabran seigneur de Baudinard qui regardait
apparemment la conquête de l'Italie comme inévitable, lui
présenta une requête pour le supplier de lui faire rendre
les duchés,comtés et baronnies au nombre de 30 seigneuries
tant de ville que terres et châteaux, que ses ancêtres avaient
possèdes dans le royaume de Naples, soit en récompense
de leurs services , soit en paiement des sommes qu'ils avaient prêtes
aux comte de Provence, rois de Sicile;le suppliant
Représentais au roi qu'il apostrophait
en lui donnant du cher sire, double sire et sacré majesté,
que ses ancêtres n'avaient été dépouillés
de toutes ces possessions par la maison d'Aragon qui s'empara du royaume
de Naples qu'a cause de leur attachement a la maison de France et d'Anjou
pour laquelle ils avaient toujours combattu, François 1°
touché de la justice de ces demandes fit droit à
la requête et écrivit le 11 Janvier 1525
au Duc d'Albane qu'il destinait à être Vice-roi de Naples
de mettre en possession des susdites terres "son cousin" le Duc d'Arian,
c'est ainsi qu'il appelait Pierre de Sabran. Mais la défaite
mémorable de Pavie ruina pour toujours ses affaires en Italie
et renversa entièrement les espérances du suppliant".
Pierre de Sabran fit son testament en
1508, mais il étais encore vivant
en 1536.
On lui connait au moins 3 enfantes
Louis, qui suit, et 2 filles, mariées
l'une avec un Villeneuve-Trans et l'autre avec un Sabran-Ansouis.
Louis de Sabran Comte d'Arian et d'Apici,
seigneur de Baudinard et d'Aiguines, s'est marié deux fois:
1/ en 1524, avec Toinette
de Gamaches, dont il eût 2 enfants: Antoine, qui suit, et
Blanche mariée avec André de Gautier, seigneur temporel
de Senez.
2/ avec Antoinette de Chevrières,
le 27 Octobre 1527. De cette deuxième union naquirent 5 enfants:
- Claude, auteur des seigneurs de Sabran-Aiguines,
marié le 13 Juin 1577, avec Sibylle de Castellane, fille d'Alexis,
seigneur de Salernes,
- Delphine, mariée avec Thomas
de Ferrier, seigneur de Corps.
-Louise, mariée le 16 Février
1556, avec Louis de Blacas Vérignon " Le 16 Octobre 1574, la
villa d'Aups, sans défense, fut attaquée et, prise par
les huguenots. commandés pas le baron
d'Allemagne et d'Estoublon. Il y eut environ 120 victimes. Parmi les
prisonniers, figurait blacas de Vérignon. C'est,dans sa maison que les soldats trouvèrent, une
30 aines de partisans, tous allaient être tués sauf blacas,
mais Noble louise de Sabran après avoir prié, lesdits:
hérétiques à mains jointes, voulait garder la vie
auxdits prisonniers t ne pouvant
ce obtenir les pria de ne les vouloir tuer ny, en
sa maison ny en sa présence,ce qui fut accordé:
, En exécution de ce, mirent à attacher lesdits prisonniers
de3 en, 3, de 4 en4, Ainsi les sortant le long d'une rue
qui descend à la ville, avec leurs estorcs les allèrent
poignant et étant au bout d'icelle ou il y a 4 coins,là
inhumainement et cruellement les meurtrirent,et en cette façon
ils en firent
mourir 18 et ils auraient
fait mourir le reste en cette façon, mais il y en eu quelques uns qui se jetèrent dans un pigeonnier
qui est joignant ladite maison et de là se sauvèrent
5 ou 6 autres autres furent sauvés par le seigneur, de
Vérignona disant qu'ils étaient ses serviteurs et domestiques
Puis les hérétiques ne
trouvant plus rien pour piller ,voyant que
l'heure se faisait, tard, doutant estre surpris
attachèrent le reste des
prisonniers y mêlant au nombre, ledit sieur de verignon
et reprenant iceux avec leurs larcins,tous vidèrent
promptement la villes.
Les 18 tués restèrent couchés
les uns sur les autres dans le milieu de la rue de l'horloge et le sang
coula jusqu'a la grand rue.
Un monument expiatoire fut construit
sur la façade de la maison , c'est
une niche renfermant une statue de la vierge que l'on dénomme
la vierge du Massacre.
Toutes les années on fit une Grande
procession lors de l'anniversaire de ces événements ,
il y vint tellement de monde que cela donna l'idée aux consuls
de demander au roi Henri III , l'établissement d'une foire
ce jour la et ils l'obtinrent. On l'appelle la foire du Massacre et
elle se tient le lundi, après le 9 Octobre
Pour ne plus être surpris par une
nouvelle agressions imprévue, tous les chefs de famille et les
personne& valides de 25 à 30 ans
formèrent une milice de 4 Cie sous la direction des Consuls.
La troupe s'exerçait 2_fois par mois et se rassemblait dans les
circonstances solennelles et surtout le 15 Août, alors principale
fêtes ce fût l' origine de la
bravade.
- Françoise, mariée avec
Guillaume de Malsaine.
- Suzanne, mariée avec Gaspard
de Villeneuve, seigneur d'Avaye.
Antoine de Sabran, baron de Baudinard,
sotte d'Adrian et d'Apici se maria avec Marguerite de le Garde,
des Seigneurs de Charbonnez( ou Chambonas),
en Languedoc, veuve de Guillaume d'Almérant.
En 1582,Antoine
passa une transaction avec sa soeur Blanche, au sujet de le succession
de leur père. Il dût mourir assez jeune et sa veuve lui
survécut longtemps.
Jean de Sabras, II du nom, baron de Baudinard,
prit, pour épouse, le 25 Octobre 1620, au Bar, demoiselle Marie
de Grasse, fille d'Annibal, comte du Bar et de Claire d'Alagonia; le
père donna b3000 livres de dot à sa fille et sa mère,
2000.
En 1620, Jean de Sabran-Baudinard est
député de la noblesse aux États tenus à
Marseille, et en 1626, il est Viguier de Marseille. Le 2 Novembre de
cette Même année, Jean s'en va " en cour" porter sou procès-verbal
contenant les causes qui ont empêché d'élire des
consuls le jour de St-Simon.
En 1641, il est en compétition
avec Laurent Munier, pour le posté de consul général
de France à Gènes; c'est son rival qui est désigné.
En 1646, il est présent à 1'assemblée dés
communautés de Lambesc et de 1654 à 1668, Jean est souvent
employé par le marquis de Régusse, président au
parlement ( dont le fils était seigneur
de Moissac) à qui il était tout dévoué.
Jean de Sabran fut pendant
longtemps procureur joint de la noblesse, mais nous n'
avons pas trouvé la date de sa prise de charge ,Il la
passa à son fils Elzéa en 1671 et mourut à Baudinard,
le 14 Décembre 1673, âge de 90 ans.
Jean et Marie ont eu au moins 5 enfants:
- Elzéar, qui suit.
- N ... mariée au commandeur
de Malté (? )
- N... mariée avec le père
de Sabran Grammont (?)
- Honoré, chevalier de St-Jean
de Jérusalem, en 1652 .
- Charles, chevalier dé St Jean
dé Jérusalem en 1688.
Elzéar de Sabran-Baudinard comte
d'Arian et d'apici meurt â Baudinard en 1709 agé
de 89 ans il s'était marié avec isabelle les actes
qui la toncernent portent indifféremment isabelle ou Elisabeth
de Cabanes de Viens. De ce mariage sont issue au moins 17 enfants
-1 Jean-François, qui suit.
-2 Nicola né vers 1657.son acte
de baptême figure sur le registre de Baudinard et, dit qu'il est
âgé de 10 ans et " qu'il a reçu l'eau sa naissance".
Chevalier de St Jean en 1674, il se marie avec Claire d'Asque.
en 1703, il commande le vaisseau la,
fortune" et en 1705, étant armé en guerre, il reprend
"la vierge de grâce" à un corsaire de Flessingue
{ Sur
l'acte de baptême de son fils aîné, Elzéar,
né en 1703, à Toulon et baptisé à Baudinard
en 1704, Nicolas est dit capitaine
d'un vaisseau de sa Majesté.) En 1709, il est en
procès avec la communauté de Bauduen, et il est déjà
mort en 1733, lors du mariage de sa fille.
-3 Balthazars(
1660-1712), chevalier de St Jean en 1676.
-4 Madeleine, née en 1661, mariée
en 1686 avec Jean-François
Berthet seigneur de la clue dont elle
eut 14 enfants.
-5 Elzéar, né en
1662 , chevaliers de Malte, en 1704.
-6 Louis, né en 1663, mort âgé
de 6 ans.
-7 Delphine, née en 1665.
-8 Gabrielle, née en 1667, mariée
en 1687 avec Joseph de Prés ( ou Pras),
avocat.
-9 Joseph, baptisé en 1668.
- 10 Hyacinthe née en 1669. _
- 11 Michel, né en 1670, chevalier
de St Jean en 1692. Dans un procès contre la, communauté
de Six-Fours, en, 1729, il est qualifié: Michel de sabran
de Baudinard, chevalier de St Jean de Jérusalem, lieutenant des
Arsenaux du Roi, capitaine d'une Cie franche de la marine, seigneur
des Embiers.
- 12 -Anne, née en 1672-.
- 13 Jean, né en 1673.
- 14 Pierre, né en 1675 et Chevalier
de St Jean eh 1692.
- 15-Clère, née en 1676,
se marie avec Jean-de `Barcillon
- 16-Jean Lambert,né
en 1678 et chevalier de St-Jean en 1694.
- 17 Ignace né en 1679
Elzéar de Sabran reçoit
de son père la charge de procureur joint de
Jean-François, seigneur de Baudinard
se marie en 1679 avec Isabeau de Glandeves (1660-1728), Dame de
Montblanc qui lui apporta en dot cette seigneurie. (Méme observation
pour isabeau que pour sa belles mère isabelle; les actes portent
indifféremment Isabeau, Isabelle, Elisabeth Elle mourut à
Baudinard, le 4-8 - 1728 et fut enterrée dans la tombe
de là chapelle des Sabran dans l'église paroissiale.
De ce mariage naquirent aussi 17 enfants;
- 1 Joseph Jules qui suit (1680-1781).
Nous n'avons pas trouvé son acte de baptême dans les registres
de Baudinard, mais il est né vers 1680. Jean-François,
son père, s'est marié en 1679, car au baptême d'Ignace,
frère de Jean-François, la, marraine est Isabeau de Glandeves
sa belle-soeur ( 1679); d'autre part le "cadet
de Joseph Jules est né en 1682;la naissance de Joseph Jules se
situe entre• 1680 et 1681 } Il vécut environ 100
ans. Nous n'avons,pas son acte de décès,
mais en 1781 lors d'une réunion d'assemblée de-la Noblesse
son fils commissaire du Roi- fut excusé "ayant perdu son
père et dans les comptes trésoraires de l'année
1780-1781 figure une dépense de 39 'livres" '1 sou 3,deniers,pour
le service solennel" de 'Joseph Jules de Sabran.
- 2 François Toussaint
, né en 1682, mort âgé de 7 ans et
enterré dans la tombe de la chapelle ND.
- 3 Delphine, née en 1684 et mariée
en 1714 avec André de Clarie de ponteves .
- 4 guillaume né 9 né en
1685.
- 5 nicolas auguste né en 1687
- 6 isabeau née en 1689
- 7 jean francois mort le 25 1 1690 agé d'environ 1 an
- 8 sylvestre bruno né en 1690
et mort agé de 10 jours
- 9 ildegarde née en 1692 et mariée
dans la famille de broglie
- 10 francois né en 1693 et chevalier
de st jean en 1709
-
11 Madeleine-Gabrielle, née en 1694.
- 12 Clère née en 1696.
- 13 Pierre-Bruno, né, en 1697
et chevalier de St-Jean en 1714.
- 14 Suzanne, née en 1698.
- 15 Charles, né en 1699.
- 16 Jacques-Balthazar, né en
1700.
- 17 Marie-Clothilde, née en 1705.
Jean-François avait succédé
à son père comme procureur joint de
Jean-François de Sabran mourût
le 4 Avril 1740, "âgé de 66 ans dit l'acte; mais il y a
erreur manifeste: son fils aîné, Joseph Jules
est né au plus nard en 1681, si Jean-François
n'avait eu que 66 ans 4 son décès, sa naissance remonterait
vers 1674 et il aurait été papa à 7 ans.
Joseph Jules marquis de Sabran-Baudinard,
se marie en 1731 avec Thérèse d'Arlatan, fille de Jean,
Baron de Lauris et de Marianne se Vénérosi.
De ce mariage on connait 3 enfants:
- 1 Jules César né en 1731,
qui suit.
- 2 Elzéar-Marie
,né en 1732.
- 3 Marguerite henriette qui se marie
le 11-4-1765 avec François d'Antoine, chevalier, conte de Belvédère,
seigneur de Rognes, en partie de Ponteves, chevalier, de St Louis, écuyer
de Mme Infante, gentilhomme de la chambre avec exercice. De son Altesse
royale Infant duc de parme , brigadier et
inspecteur général des troupes et milices, fils
d'elzear d'Antoine et de marie Anne de Blacas, d'Aups.
De son coté, Marguerite Henriette
de Sabran est dite fille de joseph jules de Sabrant
,des comtes de Forcalquier et d'Aran (sic) seigneur baron de Baudinard, Montblanc,Villevieille.,et autres
lieux, lieutenants des maréchaux de France dans les senechaussée
d'aix, Draguignan, Castellane et Digne et de Therese d'Arlatan,
en présence,
de jean Dauphin,bourgeois de la ville d'Aups, francois Delers d'Aix,
michel Constantin de Marseille et pierre Alegre, témoins.
On ne sait ce qu'il faut le plus admirer
: dans cet acte de mariage, des titres et qualités des
seigneurs ou la roture des témoins Joseph Jules n'a pas joué un grand rôle
politique dans les assemblées
de
Par contre il s'
occupa plus particulièrement de sa fortune .Son nom se
retrouve souvent dans les comptes trésoraires de la province, pour des achats et des cessions de rente,
des mutations de propriété,etc 1730 1735, 1732, 1740,
1758,1759,1766, 1767,1768 etc..
Dans l'état des pensions dues
par
Jules César de Sabran, fils de
Joseph Jules, se marie en 1759, avec Anne Gabrielle de Brémond.
Ils n'eurent qu'un fils Elzéar de Sabran-Baudinard, dernier du
nom, né Aix, rue Villeverte, en 1764.
Jules César est syndic de
En 1777, le comte Jules de Sabran-Baudinard
est député en cour, pour maintenir les droits constitutionnels
des provençaux; il revient de sa mission en 1779 et à
cette date, il est syndic de
En 1787 les gentilshommes durent présenter
leurs preuves de Noblesse pour être admis aux états ; voici
son article" de Sabran Jules César,des comtes de Forcalquier et d'Arian,chevalier, seigneur,
de Baudinard, Montblanc,:co-seigneur de Ponteves ,Ste-Catherine,
Roquette et Villevieills.
En. 1789, il est député
aux États Généraux de
D'après les mémoires de
la comtesse de Boigne, c'est Jules de Sabran qui proposa à Charles
X, alors comte d'Artois, exilé à Holirood, en Ecosses,
comme aumônier, l'abbé de Latil, qui devait devenir cardinal
archevêque de Reims et Pair de France.
Le fils de Jules César, Elzéar
Louis Zozime de Sabran-Baudinard, fut lieutenant général,
commandeur de l'ordre royal et militaire de St. Louis; Pair de France
le 17-8-1815; créé duc, héréditaire le 30-5-1825;
il mourut sans postérité le 22-1-1847.
Nous verrons dans la 4em partie de cet
ouvrage les rapports entre les seigneurs et la communauté, mais
nous ne terminerons pas ce chapitre sans dire un mot du château
féodal.
A quelle date a-t-il été
construit ? Nous ne possédons d'un château comme seul indice
l' amas de pierres qui rappellent qu'à
cet endroit s'élevait un château, il émerge un restant
de donjon que certaine auteurs désignent sous " le nom
de tour romaine" !!
On entre dans ce donjon par une porte
"Ogivale assez étroite" le style ogival n'ayant fait son
apparition en Provence qu'au XI° siècle, cette porte fixe
une limite à l'âge de la bâtisse.
Si l'on tient compte par ailleurs que
le" Castrum de beldisnar était fermé sur la route
d'Aups par un portail à 3 arcs également ogivaux{
on peut admettre que les remparts du village (roman et ogive),
l'église ( roman et ogive) et le château féodal
étaient Sensiblement contemporain et ont du être construits a la fin du XI° siècle
ou commencement du XII° .
il est très difficile aujourd'hui de se rendre
compte de l'importance de la bâtisse. Il subsiste, avec le donjon quelques pans de mur et d'énormes,
tas de pierres que la terre végétale envahit peu à
peu; des arbres ont poussé et il serait vain d'essayer de le
reconstituer par la pensée.
Le donjon est carré, massif; la
base a la forme d'un tronc de pyramide, au
sol l'épaisseur des murs est de 2m. 10; le vide intérieur
mesure 3m. 50, ce qui donne 7m. 70
°de longueur pour le coté, à l'extérieur La
porte ogivale, encadrée de belles pierres de taille ventrue n'est
pas située au milieu du coté et la largeur de son ouverture
n'est que de 0,75
Il existait de nombreux "croutoun" ( caveaux, cachots); dans l'esprit des habitants, c'étaient
des prison; (voir la 4° partie). En réalité ce n'étaient
que des caveaux à provision. Le plus grand qui démarre
de l'autre côté du chemin mesure
environ
Achards qui visita le château,
à la fin du XVIII• siècle parle de tables et de
cheminées, splendides construites, avec le "joli marbre que l'on
extrait de la région.
La château proprement dit venait
il toucher le village?
Il est difficile de l'affirmer, mais
nous ne le croyons pas.
Il se pourrait q'un portail ait fait
communiquer le château avec la partie d village qui borde la rue
du coté d'Aups et qui s'appelle d'ailleurs encore le Portalet.
Il s'y trouvais la une assez grosse dépendance du château
qui forme actuellement plusieurs maisons d'habitations. Trois grandes
portes 'cochères' au milieu des deux portes d'entrée
dont l'encadrement est en pierres de tailla donnent accès
à la rue
En fait, on ignore à peu près
tout. Les archives sont muettes à ce sujet et les livres aussi;
le souvenir s'est effacés trop d'intérêts divergents
ont amené l'oublie et nous constatons la même carence au
sujet da sa démolition: archivas, documents, tradition, tout
fait défaut.
A peine peut-on affirmer que la château fut démoli en 1793, par les habitants
du lieu sous la menace et avec l'aide de révolutionnaires venus
de Barjols. Mais y eut il réellement
menace ? On verra, dans la suite de cet ouvrage l'état d'esprit
des habitants envers le seigneur sous
Nous devons noter encore dans ce chapitre
trois histoires qui se racontent inlassablement au cours des longuets
veillées d'hiver et qui ne sont vraisemblablement que des légendas.
a ) Nous avons dit que la château comprenait un certain
nombre de "croutoun" qui d' après les narrateurs, étaient
tous bien entendu des prisons
Mais il arrivait que les prisons regorgeaient
de malfaiteurs et le seigneur , lassé
de les nourrir, allégeait ses charges en se débarrassant
des mauvaises têtes et voici comment
On faisait grimper les prisonniers au
sommet du donjon et de la haut ils étaient
invités à se précipiter dans le vide. Au_fond de
la tour , se trouvaient des couteaux places debout 1a pointe
en l'air sur lesquels les malheureux venaient s' aplatir, trouvant
ainsi une mort affreuse.
b ) un seigneur de Baudinard se promenant dans les environs
immédiats du château, se trouva nez a nez avec un manant
qui venait sans façon de mettre bas son pantalon et avait accompli
ce travail dont les Rois mêmes ne sont pas dispensés, le
seigneur furieux tira son épée et sous la menace, de la
lame effilée, obligea l'homme à manger ce qu'il venait
de faire. Pourtant, lorsque ce malheureux fou arriva à la 1/2
de ce repas peu ordinaire, le seigneur lui fit grâce du reste;
mais au moment où le châtelain remettait l'épée
au fourreau, l'homme sauta sur lui, lui enleva, son arme et l'obligea
à son tour à manger les restes.(
l'histoire ne dit pas. ce qu'il advint ensuite.)
c.) Au temps des guerres féodales,
le seigneur de Baudinard, attaqué à l'improviste par un
seigneur du voisinage, à la tête d'une nombreuse troupe,
craignit la prise de son château. Il eut alors une idée
géniale, il fit grimer sur le rempart toutes les femmes valides
et 1es fit placer les unes à coté des autres dans l'état
de nature, à 4 pattes et le dos tourné vers l'ennemi, montrant ainsi... le revers
de leur individu aux assaillants. Lorsque l'ennemi montant à
l'assaut vit ces étranges visages ils furent pris d'une panique
folle et se débandant, s'enfuit en disant qu'il ne voulait pas
se battre contre des Cyclopes !
Il est inutile de dire qu'on ne possède
sur ces 3 légendes aucune précision,ni de nom et qu'il est vraisemblable qu'elles ont été
arrangées sinon forgées de toutes pièces par un
esprit inventif.
Encore un mot avant de clore ce chapitre.
Dans l'inventaire du fonds Grimaldi-Regusse , Lavergne cite par deux fois en 1689 et en 1700
Gaspard, de Richaud, seigneur de baudinard et claire de Richaud,
fille du seigneur de Baudinard. Il y a vraisemblablement erreur de la
part de Lavergne nous n' avons rencontre
aucun Richaud, ni dans les archives, ni dans les documents, ni dans
la tradition.
1. Étymologie. Graphie. Armes.
a ) Étymologie. Les auteurs n'ont donné aucune étymologie du nom de Baudinard. Seul, de Manteyer a écrit: " En ce qui concerne le site de son origine, Bauduen et son diminutif (?) Baudinard, voisins à l'ouest du plan de Canjuers, bordant la rive gauche du Verdon et le nom de ces deux localités est, en somme, identique à celui de cette rivière, sous une forme dialectale différente où la consonne linguale intérieure s'atténue tandis que la labiale initiale est plus forte?"
Cela laisserait supposer une étymologie commune pour Baudinard, Bauduen et Verdon, sans que l'auteur donne une interprétation sur l'origins de ces mots, ni le sens de la racine unique qu'il semble affirmer. Nous devons toutefois constater que Bauduen- Bo-ouduen, en provençal et que déjà sous les romains, le Verdon avait le R le Gardo", que ni Be-oudina, en provençal, ni Bo-ouduen, n'ont jamais connu.
Faute de mieux, nous devons nous contenter de la tradition: Baudinard devrait son nom à ,un bon, un beau dinar que firent ensemble à cet endroit, les 3 seigneurs de Riez, d'Aups et de Moustiers.
b ) Graphie. Baudinarad en provençal: "Beùdina" (prononcez "Be-oudina") devrait s'écrire avec un E et il en fût ainsi jusqu'à la fin du XIX° siècle.
Mais, que, de variantes ! dans les chartes , les actes les auteurs nous avons rencontré: Belledinarius, Bellodisnari, Bellumdinacium, Bellodinari, Beldisnard, Beldinard, Beaudina, Beauldisnar, Beudinar, Bbeaudisnae, Beaudysnar, Beaudisner, Beaudinart, Beaudinat, Beldinar, Beaudiner, Beaudinar, Beaudinar, Beaudinard.
Dans un registre de catholicité de la commune, un seigneur du lieu a même signé, au bas d'un acte en lettre de 1 cm de haut Sabran-Bodinat !!!
Toutefois depuis la fin du XIX ° siècle, c'est l'orthographe Beaudinard qui a prévalu, elle n'a plus varié depuis.
c ) Armes. L'édit de 1696 mit toutes les communes dans l'obligation de faire enregistrer leurs armes dans l'armorial général de France.
Certaines communes possédaient des armoiries depuis le XIV° ou le XV° siècle, parmi les autres, beaucoup se contentèrent de prendre celles des seigneurs du lieu, ce fut le cas pour Baudinard.
Ces armes sont celles des Sabran, au chef des Blacas, à la seule différence que le lion des Baudinard est d'argent tandis qu'il est d'or dans l'écusson des Sabran.
Elles sont inscrites à l'armorial général de France, généralité d'Aix, Tome 1 f°913; Blasons, Tome 2 f°1584; droit d'enregistrement des armoiries, 20 livres .Il dut y avoir quelques frais à coté, car dans le compte trésoraire de 1697, la dépense est portée pour 31 livres .
- 2 Divisions administratives.
Depuis les Romains, et jusqu'au départ des Sarrasins, Baudinard est compris dans la civitas de Riez, et sous le Marquis de Provence, il fait partie de la Comté de Riez.
Raymond Bérangèr V établit les baillies, qui ne tenaient aucun compte des divisions antérieures: Baudinard est affecté à la baillie de Fréjus qui devient rapidement le balliage de Draguignan. Les statuts de la baillie de. Férus furent établis à Draguignan, les 7 et 12 Octobre 1235 Ils avaient êté jurés entre autres- mais le premier de tous- par le Grand Blacas.
Dans le Chapitre sur les Cavalcades ( la Cavalcade ou chevauchée était un service militaire d'une durée de 40 jours par an, du par le vassal à son Seigneur, nous trouvons le liste des impositions dues par, Baudinard et les localités voisines:
- "Beldinar et Coutellars", un chevalier sans cheval, armé.
- "Silans et Bastida et Pontevés et Bargéme et Artignosc", 3 chevaliers avec chevaux armés.
- "Aiguina et Saletis ( Les Salles )", un chevalier avec cheval armé.
- "Almis (Aups),et Tortor, et Fabrègue et Moissac et Valli de fos" 3 chevaliers avec chevaux armes.
- "Salernis et Vilocrosa", 3 chevaliers, avec chevaux armés.
- etc.. etc..
Baudinard ne fit plus partie du bailliage de Draguignan, peut-être en 1300, lors de la formation du bailliage de Moustiers (qui comprenait avec des communautés des Basses Alpes 1/10° de localités situées sur la rive gauche du Verdon, mais surement en 1322, lors de la creation du bailliage de Barjols par le roi Robert.
En effet dés l'année 1323, on lit dans le rationaire general des communautés de Provence: Claverie de Barjols: Beaudinard, albergue, échéance de Saint Michel 5 livres .
Beaudinard resta constamment dans le bailliage de Barjols, de sa creation en 1322 jusqu'à la révolution.
Dabs les ordonnances de Francois I° se trouve la division de la provence en bailliages et vigueries:"s'ensuyvent les noms des villes, chasteaux et places du pays de provencesubjects ressortissans au parlement d'Aix……le bailiage de Barjoux, Ponteves, Varages, Vinon, Ginasservio, St julia le montagnié, Fous, Anfous, la Verdiere , Quinsum, Castel-vert, Moyssac, Aups, Regusso, Beudinar, Artignosc, Verignon, Valmussino, Villonovo de Barie, Castel viel, Fabreguos, St Vincens, St Maurisi" soit au total 30 localités en 1540.
La coutume de se réunir en assemblée générale des habitants de la localité pour discuter des interets communs à tous remontait à la plus haute antiquité.
<>Il en fut de Beaudinard comme des autre communautés, chaque fois qu'une question importante survenait, le conseil général, composé de tous les chefs de famille, se rassemblait, en été sur la placette et en hiver, ou en cas de mauvais temps, dans l'Église, et prenait les décisions utiles. Cette coutume se transforma petit à petit en institution sans qu'on puisse préciser la date exacte de cette transformation.Nous allons voir le fonctionnement de l'administration communale d'après les archives tant locales que départementales.
Le Registre de délibérations communales le plus ancien qui nous est parvenu, amputé des 44 premiers feuillets, commence le 4 Octobre 1591. il existe aussi quelques coupures dans le cours des Siècles: de 1601 à 1606; de 1615 à 1654; de 1729 à 1737 et de 1760 à 1789.
Au début de l'année 1592, se trouve le résultat des élections communales, faites en conseil général; le conseil de la communauté ainsi élu comprend: 3 consuls,4 estimateurs et 11 conseillers.
- première Remarque.
Le conseil a été rassemblé régulièrement rituellement pourrait on dire et la délibération l'indique par une formule qui variera, très peu jusqu'à
En voici deux prises absolument au hasard:
- "l'an 1754 et le 10 du mois de Novembre, dans l' hôtel de ville de la communauté, le conseil général a été assemblé à la manière accoutumée après les cris faits par l'organe de Jean-Baptiste Sautel, valet de ville…….
- "L'an 1781 et le 10° jour du mois de Juin après-midi,le conseil de la communauté de ce lieu de Baudinard a été assemblé à la manière accoutumée dans l'Hôtel de ville de ce lieu après les cris faits par l'organe de François Bagarry,valet de ville .etc.
- deuxième Remarque.
"Les 2 délibérations dont nous venons de donner le préambule concernent 2 conseils tenus dans l'Hôtel de ville, mais en 1591, il n'existait pas encore de maison commune et le conseil se réunissait un peu n'importe ou: " au dernier de Chastront; "'au couvert de Terrasson"; "dessous ville"; sur la place de l'Eglise, etc..
La première modification dans la composition du conseil de 1655: "B. Terrasson, 1° Consul, maire". C'est la 1ère fois que le nom de Maire est donné au chef du conseil de la communauté, mais comme il manque les registres des délibérations de 1615 à 1654, nous ignorons la date exacte de cette novation. Par contre on sait que ce n'est qu'en 1692 que Louis XIV transforma les I ers Consuls en Maires pour un besoin de fiscalité.
Il est curieux de constater qu'à Baudinard cette dénomination était déjà en usage 40 ans avant l'édit de création. Nous avons cherché s'il existait des répercussions de l'Edit de Louis XIV,en 1692 et années suivantes. En 1709, le maire de Baudinard répondra au viguier de Barjols que la communautés de Baudinard n'a pas acquis l'Office de Maire. D'Un autre coté les comptes trésoraires ne mentionnent aucune dépense a ce sujet. Il existe aussi dans les archives une circulaire des procureurs du paye relative au remboursement des Offices municipaux, par une imposition à quotité de feu: rien ne permet de supposer que cette circulaire ait été appliquée.
En réponse à une enquête du Roi, en 1761, les consuls écrivent:
" A Beaudinard, il n'existe pas de règlement, chaque chef de famille les femmes exceptées, font partie du conseil général. Celui-ci élit le 1er Janvier de chaque années 2 consuls, 1 greffier, 4 estimateurs, 2 auditeurs des comptes, une sage-femme, 1 valet de ville, 1 bannier tel que le seigneur le propose au conseil, 1 chirurgien, 1 maître d'école, etc.."
Cette réponse n'était pas exacte, car on lit dans le registre des délibérations de 1688:
Vote du règlement de la communauté: le conseil se tiendra dans la maison commune projetée et provisoirement dans tel autre lieu que sera jugé à propos; il sera autorisé pas l'officier du seigneur; le 1er consul sera allivré au moins
En 1703, le 2° consul est tiré au sort, les 2 candidats ayant obtenu le même nombre de voix, et, en 1755,- on ne sait pour quelle cause le registre des délibérations porte l'état des personnes aptes à remplir les fonctions de consul avec demande à l'Intendant d'en désigner 2, ce qui fut fait, puisque la délibération suivante parle de l'installation pas N. Bousquet, subdélégué, de Joseph Bouges ; 1er consul et Jean Simon, 2° consul, et le compte trésosaire de l'année accuse une dépense de
Tour le monde ne peur pas faire partie du conseil: d'abord les femmes, qui ne sont mène pas admises: aux réunions du conseil général; de plus, un arrêt du Parlantent de 1758 interdit d'élire comme consuls ou officiers municipaux, les officiers royaux, ceux des seigneurs et les subdélégués de l'Intendant; enfin dans le registre de délibérations de l'année 1742 figure une protestation du préposé du seigneur contre l'élection du 1er consul " pour être parent et allié du 1er consul sortant", ce qui laisse supposer que plusieurs membres de la même famille ne pouvaient pas faire partie du même conseil ou de 2 conseils successifs.
Ces charges, aussi bien de consul que de tonnelier, sont prises au sérieux par les, titulaires. On ne tolère pas les défaillances; ceux qui n'assistent pas aux réunions du conseil sans excuse valable se font rappeler à l'ordre vertement. en 1600, on note une protestation des consuls" sur le refus du conseil de statuer sur la communication des procureurs de la communauté à Aix" ( on ignore quel était leur contenu) et en 1751, le procès-verbal donne acte aux consuls d'une convocation sans résultat. Il semble en effet dans cette 2° moitié du XVIII• siècle, que les conseillers se désintéressent un peu des affaires de la communauté: en 1752, le conseil délibère de faire enregistrer dans le livre des délibérations l' arrêt, du Parlement portant une amende de
Toutes ces charges, consul ou conseiller sont gratuites, les seuls frais rencontrés à leur nom consistent en remboursement de dépense& occasionnées pour le service de la communauté. Toutefois le compte trésorier de 1596 indique: " A Terrasson, gages de 6 mois" que avait servi de consul"
Etre consul ou simplement mandaté par la. communauté, ne va pas sans quelques aléas, en 1608, réclamation d'A. Guichard, au sujet de la détention de son père à Aix, depuis plusieurs mois pour affaires communales; en 1722, les procureurs du pays menacent de faire punir les consuls s'ils ne donnent pas suite à une délibération de l'assemblée des communautés; en 1749, en lit dans une lettre du subdélégué:" il est honteux que (vous vous) soyiez attirés la peine de la prison faute d'avoir eu attention à faire dresser ces états, ce qui est tout au plus l'affaire d'une heure:
Dans le conseil, les élus insistent peur que tout se passe au grand jour et régulièrement: il existe une grande suspicion envers et contre tous: désignation de A. Bourges, prêtre desservant de l'église,"por second pou conteuolleu les vacations et frontières" qui serait faites en présence de l'un des consuls" pou évicteu tous abus", aux gages de 3 écus( 1596); vérification des mandats" par ci devant faictz" et dont certains auraient été indûment délivrés; désormais on les délivrera en "plain conseil pour éviter tous abus" (1599); le ralivrement sera transcrit sur un registre" par ung forain pou éviter tous soupçon" (1600); défense aux consuls de faire exécuter aucune réparation autrement que par voie d'enchères (1717); etc.etc.
Il est vrai qu'on rencontre quelquefois des brebis galeuses: injonction, au besoin par voie de sommation, aux anciens consuls, trésoriers
et autres de rendre leurs comptes (1600); A.Bourges fait opposition au vote d'une taille de 32 sous par livre disant qu'il y a plusieurs trésoriers et consuls qui s'ont pas rendu leurs comptes et qu'il y a des"deubs et relliqua Deubs" à la communauté (1608), etc..
Es fait pendant toute l'année, c'est le conseil qui administre la communauté comme un bon père de famille: mission aux "consuls de pourvoir à toutes les affaires communales" et "y raporter en tous le melheur mesnage qu'ils poront".
Principales attributions du conseil:
- Rapports avec toutes les autorités;
- Entretien de tous les bâtiments, chemins, puits, etc..
- Vote et recouvrement des impôts;
- Engagement et poursuite des procès; - Emprunts;
- Nomination aux emplois non électifs; - Police en partie;
- etc.etc.
et ses droits et son pouvoir sont tels qu'il peut facilement devenir un tyran.
En tous cas, on voit combien les attributions des conseils des communautés étaient étendus et quelle autorité réelle était la leur. Il n'y a qu'à les comparer avec celles des conseils municipaux actuels pour se rendre compte que l'initiative et le pouvoir ne sont pas en faveur de ces derniers, il en faut beaucoup.
- 4 Justice.
Malgré les travaux de quelques érudits, il existe encore de nombreux préjugés sur la justice avant
C'est à François Ier que
- a) Deux cours souveraines et rivales: le Parlement créé en 1501 et la cour des comptes, aides et finances, créée en 1555, siégeant à AIX.
- b) Les sénéchaussées, établies en 1535, un grand sénéchal à Aix et 4 lieutenants à Draguignan, Forcalquier, Digne et Arles, D'autres lieutenants furent créées par la suite pour atteindre le chiffra de 12 en 1664. Baudinard fût sous la juridiction constante du sénéchal d'Aix.
c) Au-dessous des sénéchaussées existaient 26 judicatures royales réparties dans toute
Sous Louis XIV, un décret (1704) érigea des emplois de subdélégué - chargés de mission temporaire par l'intendant-" pour instruire, autant que faire se pourras de l'estat de chacune des paroisses et de toutes les affaires qui les concernent". Après une courte éclipse ces subdélégués devinrent bientôt les agents indispensables de l'administration provinciale. Il y en avait 62 dans
Baudinard fit partie de la subdélégation d'Aups avec Artignosc, Fabregues, Moissac, Régusse, sillans, Tourtour, Vérignon et Villeneuve Coutellas. Comme on le vit les subdélégations ne tenaient aucun compte des divisions administratives ou religieuses."
Bien entendu, en dehors,et en plus des tribunaux et des juges royaux, il existait la justice seigneuriale les juges bannetets qu'on retrouvait dans tous les fiefs.
C'est surtout sur cette justice seigneuriale que les préjugés persistent avec plus de force. Dans n'importe quelle ruine de château féodal, l'indigène attire votre attention sur les caveaux enfouis dans le sous-sol, ceci, c'étaient les prisons! Du temps des seigneurs on y enfermait les gens du pays, les ennemis du château! Or votre cicérone est excusable d'ignorer que tout au moins depuis l'Ordonnance d'Orléans de 1560, il était interdit aux seigneurs hauts justiciers de tenir les prisonniers sonores plus bas que le rez-de-chaussée.
Naturellement et obligatoirement, il existait une prison au château du seigneur, dans laquelle les rares prisonniers attendaient leur jugement c'est tout; car la peine de prison n'existait pas Entretenir des juges, avec tous les frais que cela comporte, était une charge,déjà très lourde pour le seigneur, à laquelle il se serait bien gardé d'ajouter la nourriture des prisonniers. C'est en tenant compte de cette considération qu'on comprend mieux pourquoi les jugements seigneuriaux étaient aussi rapidement rendus: il fallait nourrir les prévenus tant qu'ils n'avaient pas été jugés. Et nous pourrions citer des communautés; qui avaient exigés de leurs seigneurs, la construction d'une prison
Autre préjugé, encore plus tenace de très nombreuses personnes, croient à cette monstruosité légale d'une cour seigneuriale connaissant des procès personnels du seigneur, rien de semblable n'existait dans l'organisation judiciaire. Le seigneur justicier était, avec le clergé, justiciable, en première instance, des sénéchaussée et, en appel, du Parlement, une juridiction qu'il n'aimait guère et qui' le lui rendait, ayant été, instituée par la royauté contre la noblesse.
Et cela est si vrai que nous voyons fréquemment dans les délibérations des assemblées générales des communautés qui depuis 1639 avaient remplacé les états de Provence, que l'assemblée intervient pour soutenir les communautés dans leur procès contre les seigneurs. Ainsi en
A Baudinard, la royauté n'avait aucune juridiction: elle était toute entre les mains du seigneur "haute, moyenne, mère, mixte et impére", avec pouvoir d'instituer et destituer tous les officiers" comme l'écrit en 1684, un seigneur de Sabran dans le dénombrement de la terre et seigneurie de Baudinard; mais, car on ne saurait trop insister, sauf pour les causes concernant personnellement le seigneur.
- 5. Fonctions, emplois, salariés divers.
Bien que dans la réponse à l'enquête du Roi dont nous avons parlé,
on lise:" Le conseil général élit chaque année (en plus du conseil): un greffier, 4 estimateurs, 2 auditeurs des comptes, 1 sage-femme, 1 valet de ville, 1 "bannier", 1 chirurgien, 1 maître d'école, etc.. ", les choses, ne se passaient pas ainsi en réalité; car si le greffier, les estimateurs et les auditeurs des comptes étaient élus- en principe- il n'en était pas de même pour les autres qui étaient nommés par le conseil, sinon par le consul, délégué à cet effet par le conseil.
Le nombre de ces fonctionnaires et de ces employés, variait assez souvent sous l'influence de certaines causes: manque de candidat, pénurie d'argent, inopportunité, etc..
Déjà, estimateurs et auditeurs, des comptes n'étaient pas toujours élus: en 1592 ( 1er résultat connu) sont élus 4 estimateurs,, mais pas d'auditeurs des comptes et cela se reproduit assez souvent, tantôt pour les estimateurs, tantôt pour les auditeurs; parfois même ils sont tous désignés et non élus, ex. en 1700. En 1716, un auditeur des comptes gagne
Le greffier lui-même n'est pas toujours; élu; ainsi en 1666, nomination comme greffier de H,Bourges, notaire à Baudinard, avec 7 écus de gages. Les fonctions de greffier sont avant tout celles de secrétaire de la communauté, soit seul, soit accompagnant le ber consul. En 1715, il est appointé à
Parmi les autres fonctionnaires ou employées désignés par le conseil ou le consul-, certains se retrouvent assez régulièrement: valet de ville, trésorier, porcher, garde, chirurgien, accoucheuse, maître d'école, mais d'autres se rencontrent plus rarement, quelques uns même ne figurent qu'une ou deux fois dans les comptes de 1590.à 1790, soit pendant 200 ans.
il y avait aussi les employés occasionnels qui remplissaient une tâche déterminés puis disparaissaient. De ce nombre les arpenteurs et experts chargés de la réfection du cadastre: "nomination d'un arpenteur à 40 sous et d'un expert à 30 sous par jour et d'un indicateur" qui ne soit guère intéressé audit lieu* ,à 6 sous: pour procéder à lé réfection du cadastre"
( 1665) ( en 1726, les prix sont plus élevés;: experts du cadastre,
arpenteurs,
" Mandat à N. Roux, commissaire député à la réduction des comptes, de 29 écu pour 9 jours de vacation (1599) et port d'une lettre à la verdiere , 6 sous (1671 , à Riez, 2 sous (1687);
et les charges de mission: à un porteur qui est allé à Riez " quérir la permission de travailler les festes aux ères", 2 sous; à un muletier conduisant 4 mulets de N. de Vendome, commandeur, allant de Cannes à Riez,
Le trésorier est chargé d’un emploi délicat: il doit faire rentrer les tailles, lourde charge. Aussi sa nomination est parfois laborieuse: en 1610 le conseil délibère de mettre le "tresorage a l’ancan". En 1606, on lui donne 22 écus de gages; en 1608, 25 écus; en 1611, 22 écus. en 1690
est parfois obligée de passer par des fourches caudines: en 1670,
le conseil délibère de trouver "d'argent à credy" ou de chercher un trésorier qui fasse les avances nécessaires, et, à la délibération suivante A Capel est nommé trésorier, aux gages de 4 écus, moyennant l'avance de 200
écus.
Le garde n'est pas permanent: on en loue un ou deux quand les circonstances le demandent:
-Louage d'un garde pour la vendange, à 7 florins, par mois, plus sa part des amendes ( 1594).
- Vote au garde du territoire de 22 florins et demi, pour 3 mois de gages (1600).
-Nomination de 2 gardes pour surveiller tes troupeaux atteints de la "carraque" et surveiller les fruits pendant 6 mois, aux gages de
-Le "pourquier" est chargé de garder tous les cochons du village et à cet effet, les intéresses lui donnent:
- en 1610: pour une bête, une panel (16L. 85) de blé;
les, "tétareaux", pour 3,2.panals;
les pourceaux, pour 3,1 panals.
- en 1686: 2 sous par cochon et par mois, les cochons de lait (tetareaux) comptant 3 pour 2; etc..
Voici un contrat passé en 1610, par le conseil avec un maréchal-ferrant. Tarif des salaires:
- par paire de boeufs, un setier (33L.70) de blé (3 bœufs payerons pour 2");
-par paire de vaches, 3 "quartieres" (25L.26) de blé;
- une "'lentilhe" ( soc d'araire) out un "'dérbous" ( pioche), 3 liards
- une destral ( hache), 3 sous, avec let "brassiers", 6 sous;
- un "eyssadou" ( pic), 3 sous, avec tes "brassiers", 6'sous
- une "eyssado" (houe) 10 sous, pour la "cousar" (chausser), 5 sous.
On rencontre parfois le gabelier du pain et du vin: en 1608, le conseil passe obligation à F. Simon, comme gabelier, à raison de 2 florins par charge de blé 168L,5) et 6 sous par coupe de vin (31L.265).
En 1609, le conseil donne mission aux consuls de passer le bail de boucherie à Icard, aux prix suivants:
- la livre de bête à saine (Okg.403) 2 sous;
- la livre de gros bétail, 5 liards (et 6 le premier et le dernier du mois)
- les " courradous" (fressure), 1 sou;
- les tètes, tripes et pieds, 1 sou;
- la graisse, 3 sous.
Voici, en 1690, les gages annuels de quelques employés:
- Valets des consuls (valet de ville),
- "Précepteur" (maître d*école),
- chirurgien,
- Garde des vignes( un mois 8 jours),
- Sage-femme,
- Fossoyeur,
Une des préoccupations du conseil est la fabrication des tuiles pour l'usage des habitants :
- Délibéré "de mander au teoulier de Quinson por venir fere de tuyles". ( 1612);
- Marché avec un tuilier pour 5 ans, lequel s'engage à vendre les tuiles au maximum à 25 sous le_100 et à faire un four à la tuilière, à Blanquet, moyennant 6 écus,(1668);
- Convention avec un tuilier de Riez, pour venir fabriquer des tuiles à la tuilerie de Baudinard 1713),etc..
Bien que Baudinard soit un village essentiellement agricole, nous n'avons trouvé dans les archives aucun renseignement concernant les prix et la durée des journées de travail des ouvriers agricoles. Une seule délibération concerne "la location de 2 hommes pour aller à St Maximin munit d'eyssade ou banastoun afin de travailler à combler lezs fossé ";
il leur est alloué une allocation de 48 sous mais en ne connait pas la durée du déplacement et de plus il faut tenir compte de la nourriture.
Sur les salaires ouvriers nous n'avons des donnes que pour les maçons et encore très, peu, presque toutes les constructions et réparation se faisant à forfait:
- Louage d'un maçon à 18 sous par jour pour réparer lai fontaine
- Vote d'un écu 6 sous à Terrasson, maçon, pour construire un mur autour du puits de Crémont ( 1609);
Salaire des ma Sons qui ont réparé la nouvelle porte du lieu vert, Riez., 30 tous par jour l 1757).
A titre de renseignement, il a été alloué,
Ce qui ressort nettement des rapports entre le conseil et ses salariés c'est que la communauté paye, mais en échange, elle entend être bien servie Elle sait reconnaître les bons serviteurs, les registres de délibération les signalent, mais elle ne tolère pas les négligences et nous en sommes également informée; et nous verrons les conseils de la communauté être aussi intransigeants avec les seigneurs et le clergé, dans toutes les circonstances ou ils auront à faire valoir les droits de la communauté.
- 6. Police.
Les habitants étaient tenus de se conformer:
- a) aux arrêtés pris par les comtes et applicables à l'ensemble de
- b) aux arrêtés pris par le conseil de la communauté dans ses délibérations et communiqués aux habitants par voie de criée publique. Nous ne ferons état que des règlements de police concernant Baudinard et relevés dans ses archives.
A priori, on Peut faire 2 grandes divisions:
a) Baudinard bâti à cheval sur un éperon a toujours manqué d'eau.
Dans le village même, il n'a existé jusqu'au XX• siècle que des puits, dont quelques un communaux et des citernes. L'unique fontaine et l'unique lavoir situés au bas du vallon de "Viero" étaient en très mauvais états il est donc normal qu'une grande partie des arrêtés de police concernent les eaux:
- Défense de prendre de l'eau au puits dessous ville et à la fontaine pour laver lessives, bugades et autres draps ( 1599)
- Défense de laver du linge, tripes, etc.. dans le puits( sic) et à la fontaine sous peine de 12 sous d' amende ( 1611)
- Défense de puiser de l'eau du puits pour arroser les jardins et laver le linge ( 1614)
- Défense de laver des draps ou des lessives "à aucun fonts ni puit sauf à
- Défense sous peine d'une bête par troupeau d'abreuver les troupeaux "advérages aux puits du terroir afin que les gros bétail n'en souffrent (1668)
- Défense d'abreuver les troupeau ailleurs qu'a la fontaine de la source St Michel et aux puits de Fontanouille et des vignes sous peine de 30 sous d'amende pat troupeau ( 1674)
- Défense d'abreuver les troupeaux aux puits sous peine de 30 sou d'amende (1687), (1691), etc.., etc..
- b) La 2 ème grande catégorie concerne le bétail et plus particulièrement les troupeaux:
- Défense de tenir les pourceaux "séparément et à part"; ils iront avec la " pouqueyrade commune" (1599)
- Défense d'introduire le bétail dans les vignes non vendangées, sous peine d'une amende de 12 sous par boeuf, 10 sous par brebis, 6 sous par pourceau, 12 sous par chèvre ( 1609)
- Défense d'introduire le menu bétail dans les restoubles pendant le mois de Juillet sous peine de 3 sous d'amende par bête, de même dans les prés ( 1612)
-Défense de faire dépaitre les troupeaux dans les "reteniens" sous peine d'un écu ( 1696)
-Défense sous peine de 12 livras de gauler des glands ou d'introduire des pourceaux dans l'Auzière, avant
- Obligation imposée à tout propriétaire de menu bétail, à peine de 2 écus par trentenier d'envoyer son troupeau à la montagne l'été prochain, puisque" véritablement s'ept le profit de tous et chacun" (1661) _ `
- Défense de tenir aucun bétail menu dans le territoire depuis
- Maintien du porcher moyennant 2 sous par cochon et à charge par les habitants de lui en confier la garde sous peine d'1 sou par cochon(1720)
- etc.,etc.
On voit dans ces divers arrêtés sur le bétail qu'il n'est presque pas fait mention de chèvres en effet les habitants de Baudinard n'étaient pas autorisés à en élever malgré les nombreuses démarches faites par les conseils de la, communauté.
En 1730, des rapports d'experts désignent les terroirs où l'on peut entretenir des chèvres: Bauduen, Moissac, Aups, Régusse, Montmeyan sont autorisés, Baudinard ne l'est pas. En 1751, le conseil adresse une nouvelle requête au parlement en autorisation de tenir des chèvres dans le bois de l'Auzière et endroits de la forêt ou il n'y a pas de chênes blancs et délibère de faire consulter à cet effet "afin d'arrêter l' émigration des habitants et diminuer la misère". Cette requête fut encore repoussée.
En dehors de ces 2 catégories figurent des arrêtés divers:
- Défense de vendanger avant le jeudi suivant le 4/10 sou, peine de 12 sous d'amende ( 1609)
- Injonction aux, riverains des chemins royaux de réparer lesdits "chacun devant ses frontières" (1611)
- Nomination de 2 ,gardes aux gages de
- Fixation de la date de commencement de la vendange avec amende 20 sous et confiscation des raisins contre ceux qui la devanceront (1657)
- Défense aux habitants, sous peine de 30 sous d'amende, d'aller faire moudre leurs grains à Sorps parce qu "il s'y passe d'abus" et que les meuniers de Quinson ont offert de faire 'la mouture au 1/50 (1678)
- Frais de garde du chemin de Riez, à l'occasions de la foire de Digne" pour assurer le passage de ceux qui estoient de retour... attendu les vols:.. faits depuis peu dans ce quartier",
Remarque. - Nous sommes ici en présence d'un dilemme: ou bien les habitants étaient d'une sagesse exemplaire respectant scrupuleusement les arrêtés pris par le conseil (ou ne se laissant pas prendre), ou bien ces arrêtés restaient lettre morte, car nous n'avons pas rencontré dans les recettes des comptes trésoraires un seul écu provenant d'amendes infligée aux délinquants.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les gardes n'étaient pas permanents: ils étaient désignés pour une durée souvent assez courtes et dans un but nettement déterminé dont le principal était la protection des récoltes sur pied.
- 7. Etat-Civil.
On sait que l'obligation de tenir des registres que nous appelons d'Etat-civil, mais qui, jusqu'à
Un certain nombre de communes du Var possèdent des registres remontant à une date antérieure à 1539: Signes (1501), Toulon (1515), Salernes: (1517), Mons( 1520), Cotignac( 1527), Entrecastaux( 1537), mais Baudinard est beaucoup moins favorisé à ce sujet, le registre CG1 in-4° de 461 feuillets papier débute en 1662; les documents antérieurs ont disparu .
Ce 1er registre s'arrête à l'année 1774; le 2ème (CG2, in-4° de 172 feuillets papier) va de 1754 à 1788. Ce registre est un double du 1er pour la partie correspondante: 1754-1774. De plus, il existe aux archives départementale du Var un autre registre qui commence en 1739. Il serait intérêt saut de le confronter avec la partie correspondante du GG1.
Un 3° registre ou 4° si l'on tient compte de celui de Draguignan) GG3, in-4° de 138 feuillets papier, ne comporte que les...'-années, de 1788 à 17xx.
Remarque importante. La dépopulation des campagnes due à l'abandon de ses habitants remonte très loin et se constatait déjà bien avant la
Révolution. Un dénombrement de Baudinard en 1785 indique comme chiffres:
Maisons 71;
population 336.
De 1662 à 1774, soit pendant 112 ans, les registres de catholicité de Baudinard accusent 1397 baptêmes, 298 mariages, et 661 décès, soit une plus value de 736 naissances. (or on peut affirmer que le chiffre de la population était au moins aussi élevé en 1662 qu'en 1774; que sont devenus les 736 excédentaires? Ils ont abandonné la campagne pour aller chercher fortune ailleurs, tout comme de nos jours.
Une autre remarque s'impose qui ne va pas sans contredire certains préjugés: dans de nombreuses déclarations de baptêmes et pour certains actes de mariage, on voit les seigneurs de Baudinard, ou un membre de leur famille, servir de parrain, de marraine ou de témoin à des roturiers,
et inversement. ( Revoir le mariage de Marguerite de Sabran avec François d'Antoine ( 1765).
Enfin les actes de décès des soldats de passage dans la localité ne
mentionnent jamais le nom de l'intéressé et sont rédigés sous cette unique forme anonyme: "Enterré ce jour un soldat du régiment de Flandre".
- 8. Enseignement
La ère délibération communale où il est question d'enseignement est de 1610; location de Bourges, de Baudinard, pour "endostriner et enseyner les enfant" (lisez les garçons) au traitement de 9 écus par an et "sera nory par ceux qui ont d'enfans".
Des locations de ce genre se répètent souvent; les maîtres d'école sont recrutés:
- parmi le clergé, prêtres ou ermites:
- Vote de 10 écus au vicaire pour ses gages de maître d'école ainsi
"que la cour a réglé pour ce sujet" ( 1676)
- Nomination du vicaire comme "préceteur" des enfants, moyennant
- Vote d'une panal de blé "anoune" par mois à l'ermite, à condition qu'il fera son "pousible pour enseigner les enfant" ( 1670), etc..
- Parmi les. Laïcs:
- Maintien de Fouque, d'Esparon comme chirurgien et maître d'école ( 1713)
- Nomination de Patac, de Boduen, comme chirurgien et maître d'école aux gages de
- Nomination de Allègre comme barbier à
On peut se rendre compte que les gages payés par la comrnunauté étaient,
peu élevés, mais souvent il s'y ajoutait une rétribution imposée aux pères de famille: ( parfois nourriture)
Capel reçoit une rétribution scolaire par élève et par mois de
8 sous pour ceux qui, écrivent et 5 sous pour ceux qui lisent (1697)
- N. Secondaire de la paroisse reçoit une rétribution mensuelle de 5 sous et 4 sous pas enfant suivant qu'ils écrivent ou non ( 1702)
- Nomination de Sage, comme maître d'école à
- Vote d'une rétribution scolaire mensuelle de 4 sous par enfant qui écrit, 3 sous et 2 sous pour ceux qui n'écrivent pas au profit de N. Allemand, maître d'école, comme supplément aux
tout le monde se trouve contant de son service"
Mais il n'en était pas toujours ainsi: en 1715, retenue de la 1/2 des gages du maitre d'école parce qu'à cause de ses fréquentes absences" les
enfant ne profitent de rien, suivant les plaintes des familles".
En principe le maitre d'école n'est pas logé, on ne rencontre que quelques très rares exceptions à cette règle, location d'une maison pour le maître d'école,
L'année 1682 est témoin d'un fait singulier:
- 1ère délibération: mission aux consuls de donner congé " au précepteur des enfans" à
- 2e délibération: maintien de Moutet, maître d'école, dans ses fonctions moyennant 10 écus de gages "à la demande du seigneur".
- 3e délibération (1683: augmentation de 2 écus et concession du logement en faveur de Moutet , maître d'école.
Pendant cette période de 200 ans, une seule année les fillettes seront admises à profiter des bienfaits de l'instruction: nomination de Canteaume chirurgien, pour maître d'école lequel "recevra même les filles soubs la conduite et soins" de sa femme, moyennant 12 écus par an (1724).
- 9. Hygiène. Santé.
L'hygiène au village est une chose parfaitement inconnue: des tas de fumiers s'entassent dans les rues, contre les maisons, et les soins corporels de propreté sont plus que négligés: à la fin du XIX Siècle, il existait encore des jeunes gens qui lavaient entièrement leur corps pour la 1ère foie, savoir: les garçons, à l'occasion du conseil de révisions, les jeunes filles la veille de leur mariage, le reste à l'avenant.
Malgré cet manque d'hygiène, grâce à l'air très pur et à la vie régulièrement paisible et saine des habitants, aucune épidémie n'a été signalée à Baudinard. M. Honoré a publié la liste complète des lieux pestiférés de Provence de 1413 à_1722:_Baudinard n'est pas cité et pas davantage lors des deux graves épidémies de choléra' en 1835 qui causèrent 25 décès à Aups.
Toutefois, certaines mesures préventives furent prises par le conseil:
- En 1672, les comptes trésoraires indiquent une dépense de
frais occasionnées par le voyage da N. Roubaud, médecin d'Aups, "venu à Baudinard pour voir les grandes maladies".
- Lors de la grande peste de 1720 ( mesures prises par ordre du Roi) - Mission aux consuls de .dresser l'état des "vacations, fournitures et gardes pour raison de ce garder du mal contagieux".
- Nettoyage des puits et fontaines.
- Quarantaine imposée à Terrasson, absent depuis un mois non muni d'un billet de santé.
- Nomination d'un bureau de santé.
- Contingent de la communauté dans la dépense du "beureau de santé établi au Pont de Quinson",
Toutes les dépenses occasionnées par ces mesures furent remboursée*
beaucoup plus tard, et non sans de nombreuses réclamations.
Mais si les habitants ne furent jamais contaminés il n'en a pas été de même avec les troupeaux, mais chaque fois des mesures sévères étaient prise afin que la contagion épargne les troupeaux encore indemne.
- le conseil décide de faire visiter le troupeau que Icard a pris en "megerie" pour s'assurer qu'il n'est pas atteint de la maladie (1609).
- cantonnement des troupeaux atteint de la cas (clavelée).(1715)
- ordre de cantonnement du troupeu de Terrasson atteint de la cas (1712).
- Cantonnement des troupeaux atteints de la "piquote" (autre nom de la clavelée) (1742).etc.……
Pour assurer le service de santé dans le village, il y avait à demeure 1 chirurgien et 1 accoucheuse. Parfois le chirurgien assurait son service d'un village voisin, mais chaque fois qu'il le pouvait, le conseil nommait un chirurgien qui résidait. Nous avons vu qu'il cumulait souvent ses
fonctions avec celles de maître d'école.
Voici quelques délibérations concernant les chirurgiens:
- Vote de 2 charges de blé pour les honoraires d'un chirurgien qui viendrait une fois par semaine soigner les malades( 1614)
- Délibéré de donner congé au chirurgien du lieu" vu la grande pauvreté" (1657)
- Invitation au chirurgien du lieu, s'il n'est pas "juri"de subir l'examen ordonné par l'Arrêt du Parlement (1685)
- Acceptation de N. et N. de Bauduen, pour servir alternativement un mois chacun de chirurgien, moyennant 12 écus, à la condition de venir régulièrement le samedi faire la 1ère saignée et appliquer les ventouses gratis, et, en outre, à toute réquisition moyennant 12 sous ( 1702)
- Pouvoir aux consuls d'offrir jusqu'à
Bertrand, de Varages, dont l'habilité est connue corme chirurgien, à condition qu'il vienne résider (1711)
- Nomination de Ganteaume, chirurgien, à
- Nomination de 2 chirurgiens de Bauduen,
Quant aux sages-femmes, les délibérations n'indiquent que cette Mention rituelle: nomination d'une accoucheuse aux conditions habituelles; nous savons que c'était
- 10. Assistance.
Baudinard était commune très pauvre et le conseil devait souvent se démener et utiliser tous les moyens en son pouvoir pour que les paysans puissent ensemencer les terres afin d'empêcher le famine de sévir.
De cette pauvreté, les archives nous fournissent de nombreuses preuves; en voici quelques unes:
- Exposé du trésorier contenant qu'à grand peine, il a pu rassembler de la taille de 32 sous destinée à payez M. de Clémensane, 10 ou 12 écus
" à cause de l pauvreté" ( 1608)
- Délibéré: attendu les charges écrasantes de la communauté qui ne peut payer ni principal, ni intérêts, les mauvaises récoltes et l'extrémité où l'on sera réduit de "déshabiter", d'adresser requête au conseil privé afin de contraindre à se rembourser sur les biens de la communauté (1610).
- Délibéré de ne faire aucune demande de blé à
- Le conseil "ayant examiné avec atansion que les forces de la communauté ne luy permete pas dans faire une plus grande soit par raport à la pauvreté des habitants, la dépance excessives qu'il à fallu faire à l'occasion de la contagion, la mauvaise récolte de l'année dernière et la pressante et l'impossibilité de vandre les denrées mesure à vil pris", délibère d'imposer 1 sou 6 deniers par livre cadastrale (1722), etc.., etc..
Il n'y a jamais eu dans le village ni hôpital, ni Maison du St Esprit, ni Pénitents ou autres associations destinées à venir en aide aux nécessiteux. L'unique société qui a existé est
Ce rôle était assuré directement par le conseil communal. Certains malades indigents étaient soignés gratuitement; s'il y avait lieu à hospitalisation le malade était conduit à l'hôpital St Jacques, à Aix.
Les autres manifestations d'assistance se présentaient sous diverses formes:
a ) aide aux indigents de passage:
- aumône à des passants, 15 sous (1645);
- à des bohémiens 48 sous (1655);
- 14 sous (1676);
- à un carme de Coréens, 10 sous (1676;
- à un pauvre estropié " racheté des esclaves",
- à Richard, marchand de Tarascon et se famille, venant des bains de Digne et recommandé par l'Évêque de Riez, " à cause de la disgrâces qu'il avait été volé"
b ) aide individuelle aux indigents de la commune:
- Aumône à un habitant dont on avait incendié la maison et la grange,
- Payé aux moissonneurs qui ont coupé le blé de Terrassons, malade, et à ce dernier, 9L.16s.4d. ( 1673)
- Aumône de
- Aumône d'une panel de blé à une veuve indigente (1710)
- Secours à Agnès, mâcon, "dans son extrême besoin", 10L. (1756)
- Très fréquentes aumônes à l'ermite de N-D., etc.., etc..
c ) aide collective aux nécessiteux de la commune:
- Prêt par un particulier de Bauduen de 75 charges de blé de semence pour être distribué aux habitants, moyennant obligation garantie sur les semis de rembourser à la récolte (1614)
- Délibéré d'emprunter du blé pour l'avancer aux pauvres (1658)
- Vote d'un emprunt de 6 charges de méteil pour être avancées "aux plus nécessiteux" (1670)
- Délibéré d'avancer du blé aux indigents de 1678, 1684, 1685, 1700, 1713, etc.., etc..
Les répartitions étaient faites avec la plus grande équité en 1717 le conseil charge les consuls de remplir
les fonctions de "repaisateurs" du pain remis aux pauvres, pour éviter tous abus.
d ) intervention en faveur des indigents de Baudinard, résidant hors de la commune:
- députation de Capel d'Aix, pour retirer de
- Délibéré de faire consulter sur les demande de la communauté d'Artignosc, de mettre à la charge de celle de Baudinard les frais de couche et d'entretien de l'enfant que N. Constant d'Artignosc a déclaré avoir du fermier du Paronnier à Baudinard (1752)
- Frais de consultation au sujet de la contrainte donnée par l'hôpital St Jacques d'Aix, contre Féraud et subsidiairement contre la communauté de Baudinard pour "raison de l'exposition" (de grossesse) de Madeleine Constant, 40L.16 sous ( 1753)
- Délibéré suivant l'avis des Procureurs du pays et l'ordonnance de l'intendant, de payer une certaine somme à l'hôpital St Jacques d'Aix, pour se charger de l'enfant de Madeleine constant, sauf recours contre le père et la mère de l'enfant ( 1754), etc.
Avec quelles ressources la communauté parvenait elle à assurer tant bien que mal son rôle d'assistance ? Elles étaient précaires:
- Une infime partie des recettes normales;
- Des dons assez rares: les legs de 60L. de Bourges, procureur au Parlement, 1/2 pour les pauvres (1708)
- Des quêtes: nomination d'un quêteur à l'église, pour les pauvres,(1669)
- Des secours de l'Évêque: députation à l'Évêque, afin d'en obtenir une aumône pour les pauvres" qui meurent de faim" (1692)
- députation à l'Évêque afin de solliciter un secours pour les pauvres attendu
que la communauté" ne pus tavoir prest" ni aucun moyen pour faire la charité (1712).
( La communauté devait avoir certains droits sur l'Évêque à ce sujet, si l'on en juge par cette délibération du conseil: mission aux consuls de se pourvoir devant qui de droit pour obtenir que l'Évêque de Riez remplisse ses obligations envers les pauvres de le communauté,1748)
- des procureurs du pays ( plusieurs demandes de secours sont conservées dans les archives dépt des Bouches du Rhône.)
- Du manque de service cultuel soit à la paroisse, soit à St Michel transformé en rétribution pour être distribuée aux pauvres: 1723,1726, 1738, 1741 , etc..,
Avec si peu de ressources, on ne sera pas étonné de voir le conseil refuser de payer certains frais pour des indigents qui n'étaient de Baudinard:
- Délibéré de faire tenir un comparant aux recteurs de l'hôpital d'Aix, en décharge des frais de l'exposition de grossesse d'Isabeau Fabre, attendu qu'elle est de Bauduen, qu'elle n'est pas née à Baudinard non plus que Charles Daumas, des oeuvres de qui elle se dit enceinte,(1690)
- Frais du procès avec l'hôpital St Jacques d'Air, au sujet des frais d'accouchement d'Isabeau Abert, se disant originaire de Baudinard.
- Pouvoir aux consuls de faire consulter deux avocats sur les obligations de la communauté d'Aups ou de celle de Baudinard, au point de vue
de la maternité de Madeleine Sautel, demoiselle, qui a déclaré être enceinte des oeuvres de 2 inconnus qui la "violantèrent dans le terroir d'Aups" (1757).
-11. Fêtes. Deuils.
Pour les fêtes il faut distinguer:
1° Les fêtes periodiques, religieuses, familiales;
2° les fêtes par ordre,à l'occasion de réjouissances nationales ou de visites de hauts personnages.
La seule indication ;que nous possedions au sujet des grandes fêtes religieuses est une distribution d'aumône aux pauvres et nous ne sommes guère mieux renseignés pour les fêtes locales
La 1ère indication que nous possédions au sujet des fêtes date de 1599
vote de 6 florins pour les "joyes" du romèrage de N-D. Comme dans beaucoup de localités, il était désigné un Capitaine de ville et un Abbé je la jeunesse, mais nous ne savons pas comment se faisait cette désignation.
- à l'abbé de la jeunesse,
- poudré pour le Capitaine du Guet, pour la fête,
- guet pour la fête de N-D,
- poudre pour la bravade du 15 août,
- vote de
- au tambour et au fifre qui ont servi pour le 15 Août, 5L.(1790) etc..
A l'article Baudinard, de sa "statistique du Var", Noyons indique une foire le 27-9. Il n'y ai est pas fait la moindre allusion dans les archives.
Les fêtes par ordre étaient rares; elles consistaient en "Te Deum" et en feux de joie ordonnés à l'occasion: de la naissance d'un fils de
De nombreux "Te Deum" furent aussi prescrits pour fêter certaines victoires ou faits de guerre: prise de Fribourg, bataille de Fontenoy, prise d'Oudenarde, de Nieuport, de Charleroi, de Namur, etc.., etc..
Ajoutons y allocation à 2 gardes du maréchal de Villas, porteurs dé l'ordre de faire un feu de joie pour la prise de Milan, 18L. 10s. (1733-34) et pour la prise de Philisbourg,
Peu de princes ont traversé Baudinard; pourtant nous avons par 2 lettres originales du Roi René, datées du 1° août 1453, de Fréjus, trouvées aux archives d'Aups, que ledit Roi venant de Gap et se rendant a St Raphaël pour s'y embarquer a suivi l'itinéraire suivant: Sisteron, Riez, Baudinard, Aups, Draguignan et Fréjus.
........................................................................
Les archives sont à peu près muettes sur les deuils nationaux: elles renferment seulement 2 lettres, prescrivant l'une, la suppression des fêtée Pendant 6 semaines à l'occasion de la mort du Dauphin, et l'autre, la même interdiction, avec prières publiques, lors de la mort du Duc de Villars.
-12 Chasse.
Les habitants de Baudinard avaient-ils un droit quelconque de chasse ? on ne le sait pas ; il n'en est pas question dans les archives, il est donc probable qu'il faut répondre négativement a cette question.
Bien entendu, le seigneur pouvait chasser sur tout le territoire la commune: en 1780, un extrait de sentence, à la requête du seigneur, contre N. travailleur de Baudinard, ordonne l'ouverture d'une palissade (dans sa propriété riveraine de celle du seigneur) "assez large pour que le seigneur puisse y entrer pour y chasser".
Mais si les Baudinardais n'avaient pas la permission d'aller la chasse pour leur plaisir, ils avaient toutefois l'occasion de dérouille leur fusil de temps en temps pour faire des battues aux loups et, plus tard, aux loups et aux sangliers:
- Nourriture de 10 hommes qui firent la "queste" aux loups,30s. (1648)
- Poudre pour la destruction des loups, 1L 5 s. ( 1660)
- "Rebilhage du tambour pour les peaux d'icellui c'estre crevées en faisant la queste des loups 3L 10s (1700)`
- Achat (en 2 fois) de
- Poudre pour les battues aux loups et aux sangliers,
Rien ne nous indique si les tableaux de chasse étaient satisfaisants. En. 1663, la communauté a payé 36 sous pour son contingent, à la prise de 7 loups, mais on ne sait pas où ils ont été tués et en 1795, il a été tué des loups à Bauduen, Artignosc, Montmeyan, Régusse, etc... et aucun à Baudinard.
- 13. Les Limites
Avant d'être fixées définitivement, les limites séparant Baudinard des localités voisines donnèrent lieu à quelques contestations:
- en 1614, mission aux consuls et aux anciens connaissant les "termynes" et limites du territoire avec celui de Bauduen, d'aller les reconnaître et de faire produire par le seigneur de Bauduen un extrait authentique de la transaction.
- en 1733, vérification et rétablissement des limites avec Montpezat et nomination d'experts.
- en 1739, députation du greffier à Aix, pour consulter sur le procès intenté par le seigneur et la communauté d'Artignosc, au sujet des limites du territoire.
- enfin en 1742, transaction avec la communauté d'Artignosc et celle de Montpezat: les limites furent fixées au "'trifinium". Ce "trifinium" existe encore, il porte sur chacune des 3 faces les armoiries respectives des 3 seigneurs de Baudinard, Artignosc et Montpezat.
14. Bâtiments communaux. Puits. Chemins.
Nous avons parlé dans un chapitre précédent de tous les bâtiments servant à l'usage du culte y compris le presbytère et le cimetière, nous n'y reviendrons pas.
C'est en 1688 (le conseil délibère de faire construire un
"hôtel de ville" et ce projet est mis en exécution dés l'année suivante: le conseil donne pouvoir aux consuls de faire construire la maison commune et d'achever l'étable située au-dessous de la maison acquise à cet
effet.
Nous n'avons pas trouve, le prix d'achat de la maison ni celui de l'étable, mais voici les fraie occasionnés par la mise en état des locaux: maçon,
A part quelques légères réparations, rien à signaler jusqu'à la construction du presbytère avec déplacement de la mairie à cette occasion, comme nous l'avons indiqué; puis de nouveau le silence jusqu'au grave incident qui mit aux prises le curé et le conseil municipal, à la fin
du XIX• Siècle et qu'on trouvera plus loin dans le chapitre sur les rapports entre la communauté et le clergé.
L'horloge a été donnée à la commune, on ignore par qui; le droit d'insinuation du don de l'horloge a coudé
Toutefois, elle n'occupait pas l'emplacement actuel; elle était placée à l'autre extrémité du presbytère mairie. Le cadran était visible de la place et l'entrée pour aller remontre les 2 poids en pierre se trouvait sur la placette. Le changement date du début XX° Siècle.
Le 15-2-1644, un tremblement de terre assez violent fût ressenti à AUPS.: l'église se lézarda et aussi la chapelle Ste Catherine. Les délibérations communales marquant à cette date, nous ignorons si cette secousse sismique fût ressentie à Baudinard et si elle occasionna des dégâts.
Le manque d'eau, nous 1'avons vu, fût toujours une grave préoccupation du conseil, et, à plusieurs reprises des recherches furent effectuées pour y remédier: en 1724,
L'adduction qui conduit actuellement un filet d'eau à la fontaine lavoir, à coté de la place, a été effectué au XX• Siècle.
Les puits -et quelques citernes- furent donc pendant longtemps l'unique ressource en eau, dans le village. Il y en avait un certain nombre dans les caves ou au rez-de-chaussée des maisons particulières, et quelques uns, communaux, dont le conseil avait souvent à s'occuper. Nous avons déjà indiqué quelques règlements de police les concernant, voici d'autres délibérations à leur sujet:
- Vote de la construction d'une"crotte" ( réservoir) à la fontaine ( du vallon de Viéro) pour recueillir les eaux pendant la nuit (1612)
- Mission aux consuls de "faire accommoder les poux ( puits.) et surtout celui de Peiron et capage d'un homme par maison pour creuser un puits à Mabiely "atendu la grand sécheresse et mesme qu'on Dict il lia de l'eau" ( 1655)
- A la demande du seigneur, vote d'un capage pour creuser un puits au dessus de l'église ( 1678)
- Réparation et curage des puits: gd. puits, Font de Peiron, Font-
Rubis, des Vignes, des Bohèmes ( 1749), etc., etc..
Ce qui pourrait paraître ironique avec cette pénurie d'eau, ce sont les dégâts causes par les inondations, particulièrement en 1702,1729 (il est accordé à le commune un secours de
Le four et les moulins furent seigneuriaux jusqu'à la révolution, pourtant en 1656, le conseil ordonne un capage d'une journée d'homme par maison pour réparer le four et les mouline s'il y a excédant.
Le commune payait une pension féodale de 14 sous pour l'usage d'une forge; en 1687, le conseil ordonne un capage d'une journée d'homme par maison et par forain et d'une journée ce femme par veuve, pour réparer forge.
Mais où le nombre des capages devenaient particulièrement important, c'était pour l'entretien des chemins vicinaux, sans compter la contribution à la réparation des chemins incombant à le Viguerie:
- Capage pour réparer les chemins ( 1675)
- capage d'une journée d'homme par maison pour réparer le chemin de Sorps (1684)
- Capage pour réparer les chemins dévastés par des inondations (1702)
- Vote d'un capage pour réparer les chemins et contraindre ceux
qui refuseraient à 7 sous d'amende même s'ils ne possèdent aucun bien(1704)
- Mission aux consuls de faire réparer les chemins "Monsieur ayant
fait l'honneur d'ordonner de les réparer" (1713), etc.…..
Pour les chemins de
- Part de la communauté pour la réparation du Pont sur
- Contingent pour la réparation des chemins de
- Contingent de la communauté pour la dépense du Pont d'Entrecastaux,
- Contingent de la communauté dans les frais de réparations du Pont de Sillans,
Ces contributions n'étaient pas toujours payées sans observations:
- Députation de Sage à l'assemblée de
- Dans une lettre aux procureurs du pays, la communauté se plaint
Du mauvais état des chemins, surtout celui qui conduit "du lieu de Moumejan jusque icy que
D'une façon générale les chemins étaient très mal entretenus. Il est vrai que les déplacement étaient rares. On trouvait dans le village à peu près tout ce qui était nécessaire à la vie courante et certaines facilités qu'on n'y rencontre plus: avec les prêtres et le maître d'école y étaient domiciliés: lieutenant de juge, notaire, accoucheuse et le plus souvent chirurgien.
aussi chaque fois que le voyage d'un personnage important devait s'effectuer, les chemins étaient rapidement mis en état afin que les
Carrosses puissent passer sans encombre.
D'après le plan cadastral , 2 chemins traversent le territoire de Baudinard:
- le chemin vicinal ordinaire n° 11 de Montmeyan a Aiguines (chemin venant de Fontayne et allant vers fontaine l'évêque)
- - le chemin de grande communication n0 109 de Draguignan a riez (venant d'Aups et allant au pont sylvestre.
- La partie entre le poteau sur la route d'Aups et celui situé sur la route de riez ,soit un peu plus de
- 15. FINANCES
Baudinard n 'avait
pas d'autres ressources que le rendement des impôts. Voici ce
que les consuls du lieu de "Beaudisnar" déclarent à l'assemblée
des communautés, sur les usages dont jouit le communaute (1691):
- "La communauté à
un droit d'usage dans la terre gaste de ce lieu, Pour depaitre les troupeaux des particuliers et prendra
du bois pour le
chauffage et autres nécessités; duquel usage la
communauté
jouit depuis un temps immémorial.
- "Cette terre gaste a un defends de
chênes blancs, pas beaucoup gros de 1000 cannes de long et presque
autant de large auquel le seigneur dudit lieu à la même
faculté suivant la transaction de 1467; ledit deffends (n'est)
d'aucun rapport, ladite terre gaste n'est que du buis et autres broussailles
et quelques chênes verts, le tout sur des collines parmi
les rochers qui composent icelles, n'y ayant aucun endroit qui puisse
être mis en culture; se trouve presque au flanc du Verdun et mesure
au levant 500 cannes de long et autant de large et au couchant 700 cannes
de long et 400 de large.
- "Aucun rapport à tirer de ces
terres gastes sauf quelque peu d'aglan quand il est de saison qui est
consumé par le bétail des particuliers".
- "Valant lesdites terres gastes, en
considération aux évaluations faites pat le seigneur dudit
lieu lors de la grande transaction citée ci-dessus,
- "Et finalement la maison commune peut valoir
On ne s'étonnera pas si, en 1674, une déclaration du Procureur général chargé du recouvrement du droit de francs-fiefs contient que d'après la déclaration de la communauté de Beaudinard, celle-ci n'a rien aliéné à ses créanciers, n'ayant rien, elle ne pouvait pas vendre grand chose.
Aussi les conseils de la communauté eurent-ils un souci constant: l'équilibre du budget. Dans les années de disette provoquées par les mauvaises récoltes et pour couvrir certaines grandes dépenses, les recours l'emprunt se succédaient, n'arrangeant la situation que momentanément
car il fallait payer les intérêts des sommes dues et les rembourser ensuite.
Les délibérations gardent peu de traces des projets de budget
en réalité, il y est surtout question d'estimer les dépenses prévues afin de fixer le montant de la taille destinée à les couvrir). En voici .
- En 1726:
-Deniers (du Roi et du Pays 980 livres
-arrérages à
-don d'Henri Dupuis 750 d°
-Réfection du cadastre 500 d°
-Chirurgien et maître d'école 96 d°
-Trésorier 100 d°
-Autres employés 36 d°
-Au vicaire, pour fondations 15 d°
-Droit d'alberge 55 d°
-Cas inopinés 150 d°
-Imposition d'une taille da 3 sous par écu
- En 1757
-Acompte réparation au presbytère 285 livres
-Deniers du Roi et du Pays 760 d°
-Taillons et fouage 41 d°
-Arrérages au receveur de
-Ampositions de
-Denier par livre à la cour des comptes 15 d°
-Taille du bétail : 100 livres,vote d'une taille de un sous par livre.
Comment estimait on le bétail pour la taille? Voici la "cotte" de 1610.
- la paire de bœufs 3 ans et au dessus 15 florins
- la paire de vache 12 florins
- âne ou ânesse de trois ans 3 florins
- "trentenier d'average" 15 florins
- "rassatin ou mulert " de 3 ans 10 florins
- Pourceaux d'un an 6 sous
Pendant les années de pénurie, la taille sur les bestiaux était parfois supprimée ou son taux diminué.
Certaines tailles étaient votées par le conseil pour un emploi nettement déterminé:
- Paiement d'une dette ( 1600), (1607), etc.
- Frais d'un procès ( 1596), etc.
- Faits de guerre: vote d'une taille d'un setier de blé pour fournir du pain aux gens de guerre par ordre du Gouverneur, le Duc de Guise
- Dépenses imprévues: vote d'une taille de 5 liard par écu pour payes les frais de réfection du cadastre, etc., etc..
contrairement à se que l'on pourrait croire, les tailles normales variaient passablement dune année à l'autre: en 1594, un écu par livre;
en 1597, 6 écus et 2 coupes de vin par livre; en 1607, 4 écus et 3 setiers par livre; en 1656, 4 écus 3o sous pas livre; en 1662,
Las tailles étaient presque toujours payées "par livre cadastrale". quelle était donc l'estimation des biens du terroir en livres cadastrales ?
en 1718, le cadastre est composé de
Command procédait-on pour établis cet allivremenr ?
-Les propriétés étaient estimées à une valeur qui était lors de la réfection du cadastre,
en 1665:
- terres, 20, 15, 10, 5 et 3 écus le journal (33 ares 33)
- prés, 25, 20, 15 écus le "souitoirade" ( 24 ares 74)
- vignes, 6, 4 et 2 écus la "foussouirade" ( 3 ares 96)
Et en 1700:
terres, 25, 20, 15, 8, 4, 1 1/2, 1/2, écus le journal avec "esgard"à la proximité et à l'éloignement.
- prés, 50, 40, 30 et écus ls fauchée;
- vignes, 8, 6, 5 et 4 écus la "foussoirée";
- jardins,
- les terres "vingtenières", 2 écus, 1 écu, 40 sous et 20 sous.
Pour fixer les tailles, les consuls éclairaient parfois parfaitement le conseil sur les charges de la communauté, témoin cet extrait de délibération du conseil, conservé aux arch. dép. des B. du Rhone:
- " En exécution des ordres des procureurs du Pays, les consuls ont fait réunir le présent conseil pour procéder aux impositions de cette année et affin que celà se fasse avec connaissance de cause, ils ont fait dresser un état des charges se montant à scavoir:
- " Pour l'imposition courante du Roi et du Pays
à raison de
- " Pour le contingent de 2/20 et 4 sols par livre
du 1er, suivant répartition faite par les procureurs au Pays,
- " Pour le taillon, fouage et subside à
raison de
- " Pour le contingent et l'entretien des bâtards,
- " Pour l'entretien des chemins de Province de
2ème classe qui passent dans votre terroir,
- " Arrérages dus au bureau de
- " Pour l'imposition particulière de
- " Pour les charges ordinaires et extra-ordinaires
réglées par l'arrét de vérification des
députés de la communauté,
- " Pour la pension féodale due par la
communauté à M; le Comte de Sabran, seigneur de ce lieu,
une de
- " soit au total: 2.172 1. 9 s. 2 d.
Revenus:
- " une taille du bétail, environ
- " ferme du douzain sur les fruits et grains,
- " reliquat du dernier fermage,
- " soit au total, 1.871 1. 4 S. 4 d.
" Excédent des dépenses:
" Le conseil décide d'imposer une taille
de 12 deniers par livre sur les maisons, jardins et bestiaux, laquelle
imposition tombera à un seul quartier le 8/9 prochain, le produit
de cette imposition doit rendre environ
" A Beaudinar, le 20 Juillet 1776.
" Collationné sur l'original, Martin, greffier."
Un extrait de délibération identique, avec chiffres sensiblement égaux, datée de 1777, est en notre possession: elle comporte 2 f° et le v° du 2° a été annoté ainsi par la viguerie: "Extrait de la délibération du 20 Juillet 1777, communauté de Baudinard. Viguerie de Barjols. Impositions de l'année 1777. Suffisante.
La perception de certaines tailles était
mise aux enchères:
- de l'année 1753, il existe les
procès-verbaux d'enchères de la perception du 1/12°
des blés, "mescle", seigle, méteil, orge, avoine, épeautre,
légumes, raisins, foins, herbes d'hiver, noix, amandes, olives,
figues sébes, glands, haricots verts, haricots secs, fèves,
pois, oignons, aulx, poireaux.
à l'exception ce ceux récoltés dans
les jardins communaux et dans les jardins potagers et ceux appartenant
au seigneur de ce lieu.
Mais en 1775, un arrêt de la cour
des comptes interdit d'imposer les fruits et légumes sans autorisation
préalable.
Les emprunts variaient aussi d'importance
suivant les besoins de la cause:
emprunt de 170 écus ( 1591); de 4.000 écus (1609);
100 écus pour payer les deniers du Roi (1657);
Certaines années, les emprunts
étaient difficiles à obtenir, la communauté députait
dans diverses localités et ne réunissait pas toujours:
- Députation à Aups, Bauduen
et Riez, Pour essayer d'emprunter blé ou argent, (1608)
.
- La communauté n'a sas pu avoir
crédit ( 1665).
L'intérêt des dettes retient
aussi l'attention du conseil:
- Mission aux consuls de consulter pour
savoir si l'on doit payer les intérêts au 6 1/4 ou au 5%,
conformément à l'édit du Roi ( 1655}
- Prière au seigneur du lieu de
demander d l'intendant de réduire à 5% le taux des intérêts
"conformément aux autres communautés".
Nous allons faire à présent
une petite incursion dans les comptes trésoraires.
Dans ceux des archives départementale des bouches du rhône, nous trouvons
2 indications:
- en 1436, les ramages des troupeaux
sur le territoire de Beaudinard ont produit
- en 1474, perception du don gratuit
de 18 florins par feu, voté par les communautés de Provence:
Baudinard, 31 florins 6 gros.
Arrivons aux archives communales:
Le 1 er compte est celui de l'exercice
1639-1640:
chargement
150 L 10 s.
déchargement
146
L 15 s
mais dès 1641-1642,les chiffres sont autrement importants:
chargement
2.257 L
5 s." comprenant le peu de blé".
déchargement
2.040
L 5 s.
ces chiffres se maintiennent approximativement pendant
longtemps: 1663-1664:
chargement
2.009 L
9 s. et 8 panaux de blé.
Déchargement
1.707
L 7 s. et 2 panaux
de blé.
puis ils augmenteront au cours des années à
cause de la dévaluation de l'argent et de l'augmentation des
charges: 1780-1781
chargement
déchargement
et c'est l'année 1747-1748 qui connaît les
chiffres maxima, à cause de la
guerre:
chargement
déchargement
Mais ces chiffres ne représentent
pas exactement les charges supportées par
les habitants, les sommes dépensées pour
la guerre étant remboursées en grande partie sinon en
totalité par le Province.
Dans les recettes on ne rencontre pas
souvent des rentres autres que les impositions et les emprunts, en voici
tout de même quelques unes:
- Fondation de messes
- Concession de 5 "journaux"
de terres incultes à Rouvier, moyennant 20 sous le "journeau"(33
ares 33)en 1718.
- Pour le service qui n'a pas été
fait a la chapelle de St Michel
- indemnité accordée pour
"le ravage des eaux" en 1729, 198 L 15s.
- Remboursement des frais occasionnés
par les troupes, etc.., etc..
Nous ne pouvons pas citer toutes les
dépenses , certaines ont déjà été
mentionnées au cours des chapitres précédents,
celles qui découlent
des événements militaires le serons plus
loin; d'autre part celles affectés aux employés et fonctionnaires
reviennent régulièrement toutes les années,
nous nous contentons donc de signaler ici quelques dépenses
parmi les plus caractéristiques:
- Perte pour la réduction des
double tournois, 1 écu 23 s.(1664)
- Achat dé blé, à
32 s. la panal,
- Dépense a l'Oste Srt-Jean par
messire Capel, J. Bourges, bailli et
N.. Jouvenel, consul,
- Droit de cavalcade, 4b L 11 s, (1679)
- Deux journées d'âne,
- au porteur de l'ordre de "désarmer
les huganaux convertis" , 5 s. (1689)
- Frais de conduite à Bauduen
d'une " fille insensée", 5 s.(1689))
- Deniers du Roi et du Pays y compris
la contribution des armes et de l'habillement dés miliciens;
quartiers: août,
- Achat de 2 charges de bois
bruler, 4 s. ( 1692)
- Visite du viguier de Barjols au sujet
des "poix et mesures",
- A un militaire allant rejoindre son
régiment à Aix, pour " le secourir
le long de sa route",
- Fournitures de draps de lit, de paillasses,
de rideaux, de nappe: et de serviettes pour les ingénieurs géographes
qui sont venus "lever la carte de Provence",
- Prix du foin consommé pendant
4 jours par les chevaux de 2 notaires de Riez, venus pour rechercher
l'emplacement d'un terme au vallon de
- Transport d'Aix à Barjols de
3 sacs de petite monnaie de cuivre contenant
- Frais de la visite pastorale, payés
au cuisinier de l'Évêque de Riez,
- etc.., etc..
En conclusion, malgré les difficultés
toujours renouvelées, le conseil se montra à la hauteur
de sa tâche et réussit à surmonter toutes les situations
délicates. Le conseil de 1716 se donne une espèce de satisfecit
qui semble se rapprocher assez nettement de la vérité:
un mémoire de vérification des biens abandonnés
porte que la communauté de Baudinard quoique " accablée
en arrérage considérables par impuissance, il luy a été
fait aucune exécution vaillante ...ny emprisonnement pour le
payement des deniers... parce qu'elle fait toujours ce qu'elle peut
et au della".
Un mot pour terminer sur la capitation.
Elle apparaît pour 1 ° fois en
La capitation, invite à en faire
la répartition "avec esprit de justice" et donne les instructions
voulues sur la matière.
Voici quelques extraits du rôle
des habitants (de 1738 ,à 1746):
- Jean Francois de Sabran, seigneur du
lieu, ayant 3 fils et 3 filles: cuisinier, muletier, secrétaire,
servante, valet et palefrenier, revenu des terres
- Claude Martin, lieutenant de juge
- Pierre Sage, 1er consul,
- Jean Bagarry, 2em consul,
- Jean François Martin, greffier,
- Louis Terrassons, cabaretier,
- Madeleine Pons,
5 s
- Antoine Rouvier, tisseurs à
toile,
- Jacques Bec, maréchal à
forge,
- Elzéar Bourges, laboureur,
- Elzéard Roux, cardeur à
laine,
- Joseph Bourges, bourgeois,
- Julien Mégi, curé,
- Jacques Amielh, menuisier,
- Louis Terrasson, tailleur d'habit,
15 s.
- Jean Dauphin, rentier de Pont-Rubis,
- son petit porcher,
10 s,
- Pierre Ganteaume, charbonnier,
15 s.
- etc.., etc..
16.
Affouagements,
L'affouagement
ou division de
Mais la valeur réelle des communautés
ne restait pas fixe: les unes s'enrichissaient par des transformations
de culture, des défrichements les autres s'appauvrissaient: terres
abandonnées, ravages de guerre, etc., de là des demandes
motivées de réaffouagement et par suite grand nombre d'affouageants
successifs ( plus les réaffouagements
partiels entre 2 affouragements généraux). Bien entendu,
les demandes de réaffouagement étaient toujours présentées
par les communes pauvres qui s'estimaient trop affouagées. Ainsi
en 1663, de nombreuses communautés se plaignent d'être
trop affouagées et l'assemblée générale
des États ordonna une requête pour examiner le bien fondé
de ces réclamations; le Baron de Baudinard était au nombre
des enquêteurs.
En 1665, le conseil de Baudinard donne
pouvoir au seigneur du lieu de députer une personne de son choix
à Manosque, pour représenter aux experts qui procèdent
au réaffougement que la communauté de Baudinard est trop
surchargée.
On admet que le plus ancien affouagement
date de 1.200, il ne nous est pas parvenu, pas plus que ceux de 1390, 1400, 1418,
1442, 1458. Le plus ancien affouagement conservé dans les archives
est celui de 1471 cet exemplaire ( en réalité le seul
que possède la commune) a été, plus ou moins mis
à jour lors des affouagements de 1540, 1665, 1698, 1730,1747,
et des reaffouagements partiels de 1728, 1731, 1732, et 1733.
En 1471 Baudinard est affouagé
1 feu ¾ et en 1660, aussi,.
De l'année 1663, il existe aux
archives dep. des BdR, la réponse
de Baudinard au questionnaire de la viguerie.
Voici cet intressant document:
" ledict
lieu est affouagé 1 feu ¾ et ne doit pas l'estre davantage
d'un feu pour le plus.
- "lieu
tout petit, rien que 50 maisons habittantes et fort peu dabittants".
- "le
terroir est fort pauvre vu sa mauvaise situation.
- "la
plupart etant de rochers et buis qui ne portent aucun fruicts
- ""Pas
d'herbage ny ayant point de source dedans pas même de fontaine
pour suffire au boire de ce petit nombre habitants ny du bestial
- Ny
en ayant mesme point dans le lieu ny en aulcun autre endroit quy soit
proche et commode estant aux moindres sécheresses obligez d'en
aller puiser fort loin.
- "Ils
s'ont aussi poinct de domaines ny aulcune sorte de revenus, estant obligez
d'aller faire leur farine hors du lieu et aux mollins du seigneur jusque
dans Riez.
- "
Ny ayant q'un seul four audit lieu qui appartient au seigneur il sont
obligez pour le cuire de payer 15 pains un et fornir tout le bois nécessaire.
- "Ils
sont encore obligez de paver un droit de tasque audict seigneur à
reson du douzain et un droit de disme à la mesme reson.
- "Ils
sont encore obligez de payer une pension féodales et foncière
de
- "Chasque
particullier est encore obligé obligé de paver audist
seigneur un droict de fouage et subside de panaux d'advoine et 20 sous
argent pour ceux qui ont des boeufs et les autres le 1/2 moins.
- "Ce
qui est la cause que ledict lieu n'a jamais été habittet
de beaucoup dabittans et qu'il se le sera pas a l'advenir.
- "Quoique
le terroir soit tort petit (
- "Il
ni a point de bastiment au champ qui ne soit ruinés et par la
mesme reson et considération les maisons du lieu le sont presque
toutes aussi et il est bien véritable lesdit lieu est des plus
pouvres cette province.
- "Ny
ayant aussiy de vignes pour leur boire.
- "Ny
de forrage pour leurs bestiaux à cause de la sécheresse
dudit terroir.
- "
et tout ce que dessus joinct à ce que le seigneur dudit
lieu possède le meilleur du terroir en domaine noble il s'en
suit que ledist lieu doibt estre affouagé à ung feu pour
le plus."
En 1665, le conseil récidive:
( formule rituelle de réunion du conseil, puis:)
- "Les consuls ont représenté
que bien qu'il aient deja distribué les blés et mescles
qu'ils ont emprunté pour secourir les pauvres, il se
se rencontre que presque tous les habitants
n'ont rien pour subsister et sont a la derniere extremité et
decidés a partir y ayant ete deja 7 ou 8 familles qui ont été
contraintes de deshabiter cette année.
" le conseil tout d'un commun accord
a délibère de donner charge aux consuls de faire tout
leur possible pour emprunter et faire quelque chose pour empêcher
le monde de partir et ce pendant député à Manosque
et la représenter à messieurs les députés
du reaffouagement les charges payées par les habitants afin qu'ils
veuillent donner quelques soulagement, emporter toutes les pièces
qui sont nécessaires et prier très humblement au nom de
ladite communauté Monsieur De Bausdinard, demander sa protection
et lui representer la misére de ce lieu tellement surchagé
de plus de ½ a proportion de tous le reste de la province."
"Les pièces qui sont nécessaires"consistent
en un playdoyer qui reprend les arguments fournis dans le document de
1663, mais apporte quelques aperçus nouveaux:
"Les habitants de Baudinard payent:
- "un droict de tasque au dizain de tous
grains et légumes;
- "un droict de follage (foulage) au
vintain;
- "de plus chaque particulier ayant charrud
payent chasque année
au seigneur dudict lieu 4 panaux avoine à la mesure
grande de Barjols
et 20 sous argent et les brassiccos (bourriquot) la moitié
moins;
- "de plus une pension féodales
de
- "et une de
- "le droit de los au dizain;
- "le fornage au quinzain et encore fornir
le bois;
- "n'ont aucune promission de vendre
aucun vin dans le mois doust ny dan aler quérir hors tu lieu;
- "ny de porter du bois pour vendre dehors
mesme de celluy à son propre;
- "sont tenus de fornir d'oumes pour
la garde du château au tans de guerre;
- "et en se quy est de l'affranchissement
qu'on a faict audist seigneur de
- "et finalement ledict seigneur poussede
en domaine noble la 1/2 du terroir et le meilleur."
Nous verrons plus loin que ces indications
ce concordent pas exactement avec celles accusées par le seigneur.
En tous cas cet appel fut entendu:
à l'affouageament de 1665, Baudinard n'est plus affouagé
qu'a 1 feu et 1/4 de feu;
et à l'affouagement de 1698, ce chiffre est encore
diminué à 1 feu et 1/2 feu,ce qui ce changera plus jusqu'à
Ici, il faut distinguer:
a ) Les prêtres desservant, vicaires et secondaires.
b ) Les prébendés: Prieurs de Baudinard (Evêque
de Riez) et Prieur de St Michel ( Chanoine D'Aups).
D'une façon générale,
la communauté n'eut que des rapports amicaux avec les premiers
et particulièrement avec les vicaires, car l'emploi de
secondaire fût souvent vacant.
Ces prêtres étaient réduits à la portion
congrue et nous avons vu dans un chapitre précèdent par
le dénombrement de la vicairie de Baudinard fait par le vicaire
de Peynier en 1674 que c'était loin d'être reluisant.
Nous avons vu souvent que l'un d'eux
était chargé de l'instruction des enfants moyennant une
petite rétribution supplémentaire.
Voici quelques autres faits puisés
dans les archives:
- "députation pour louer un prêtre
comme secondaire à la malheure condition et mission aux
consuls le tirer en cause A Bourges jadis secondayre por avoir raison
de ce que la communauté lui a balhé (1598)"
L'année suivante A. Bourges est
condamné à rembourser 14 écus.
- Députation pour "accommoder"
Guigues Reynaud, prêtre, "des gages
s'il demande à la malheure condiction". L'accord
se fait. Un peu plus tard la communauté lui donne une coupe (31l.265)de
vin à 25 sous en 1600
mais en 1607 plainte contre Guignes Reynaud, secondaire,
qui "soubz presteste que quelques hommes de ce lieu entoit à
la procession générales
de la croix ou assistaient presque toutes les gens" aurait
quitté celle-ci ;de telle sorte que P. Porcely, prêtre
et vicaire, aurait du chanter seul la messe " ayant ainsi
mis un grand escandalle au public"; de plus dimanche dernier ledit
secondaire "auroyt battu et frapé d'un bâton
ung homme de ce lieu en lui disant pleusors parolles injurieuses et le menassant
de le fere aller en gallere et que luy volait roumpre les bras".
- délibéré de prendre
fait et cause pour les habitants qui seraient poursuivis par le vicaire
en paiement de la dîme des légumes (1699)
- A N, prêtre de Baudinard, "pour
le bien dire de feu Élzéar Bourges",
- Délibéré de se
pourvoir devant l'évêque ou autres pour obliger le vicaire
du lieu à dire " l'aube" les dimanches et fêtes et faire
l'absoute le lundi (1701)
- Mission au lieutenant de juge, aux
consuls et a N.Bagarry, maçon, de dresser mémoire des
réparations au presbytère demandées par N. boeuf,
nommé vicaire, en remplacement de feu N. Gastin "qui estait homme
de mérite duquel la mémoire doit être chaire dans
cette paroisse" (1719) ...................................................................................................................
A vrai dire, il n'y eut jamais de grands
points de friction entre la communauté et l'évêque
de Riez, Prieur de Baudinard. Ce qui ressort des délibérations
du conseil, c'est, en 1er lieu des réclamations nombreuses pour
le manque de service du secondaire: 1598, 1693, 1738, 1739, 1741, 1755,
1778, etc., etc.. et,
en outre des réclamations pour demander les sommes dues pour
le manque de ce service et les aumônes que l'évêque
donnait pour les pauvres de la paroisse: 1692, 1712, 1716, 1748, etc..
A cela nous pouvons ajouter;
- Pendant les guerres de religion, paiement
suivant les articles de la trêve des 25 charges de blé
de pension à l'évêque ( 1593).
- Députation de J. Bourges à
l'intendant pour déclarer que la communauté se soumet
à payer la dîme au "catruple" et en retirer ensuite la
décharge de l'acte d'alination desdits droits moyennant 25 charges
d'avoine, consenti en 1591, qui n'a été en vigueur que
8 ou 10 ans et pour l'exécution duquel l'évêque
a fait sommation ( 1681)
Députation à Riez afin
de prier l'évêque qui n'a pas approuvé la convention
passée avec N.Gassier "de vouloir lui faire part de ses lumieres
pour en dresser une autre" ( 1709)
- Demande à l'évêque
d'un prédicateur pour le carême ( 1716)
(En 1663, le transport à dos de mulet du prédicateur pour
le carême avait coûté
- Demande à l'évêque
de la permission des oeufs et du laitage
pendant le carême vu qu'il n'y a dans le lieu ni herbe,
ni poisson salé (1710)
-
Consultation pour le procès
contre l'évêque de Riez,
-
............... ........................................................
Mais c'est avec le prieur de saint Michel , le chanoine d'Aups, (nous avons dit que ce fût
toujours un membre de la famille Thadey) que l'entente
fût la moins bonne. Le désaccord avait presque toujours
pour origine le manque
de service à la chapelle Saint Michel:
- Charge aux consuls de "parler au sieur
Thadey, d'Aups, voar cy vut fer fere le service à la chapelle
St Michel" et retenue sur la dîme de 4 écus auxquels Thadey
a déjà été condamné ( 1656)
- Le conseil députe à Fréjus
le notaire Hourges pour rechercher dans les archives de l'évêché,
les biens "vintiniers" attachés à la chapelle de de St
Michel ( 1672)
- Adhésion au projet d'arbitrage
du procès contre Thadey, Prieur de la chapelle St Michel, en
indemnité pour le manque de service pendant 6 ou 7 ans (1699)
- Ordonné que les consuls, ou
l'un d'eux, ferait compliment à N. Thadey, prieur de la chapelle
St Michel, pour l'inviter à continuer le service de la messe
et de remplir les autres charges de la convention
(1722) ( Exception
qui confirme la règle, mais sera de courte durée.)
- Mission aux consuls de pourvoir par
devant l'évêque, contre le prieur de la chapelle St Michel
pour l'obliger à mettre celle-ci en état et de reprendre
le service interrompu depuis plusieurs années ce "qui est cause
que plusieurs personnes persent la messe" (1725)
- Délégation de Bourges,
à Aups, pour retirer de N. Thadey, prieur de St Michel, "les
arrérages de servisses" (1726)
- Pour le service qui n'a pas été
fais à la chapelle St Michel, reçu du prieur Thadey, chanoine
à Aups,
- Rôle des sommes retenues pour
manque de service à la chapelle St Michel (
le chiffre manque) ( 1734)
- quittance à N. Thadey, chanoine
d'Aups, de 8 charges de blé froment, en compensation du service
de messe qu'il est tenu de faire à
la chapelle St Michel, les dimanches et jours de fêtes
de
- Rédaction d'un mémoire
pour le procès Thadey,
(1778); frais du procès Thadey,
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous avions l'intention de parler ici
du grave conflit qui mit aux prises la communauté eu le
curé en 1895 ( pendant notre séjour
à Baudinard) au sujet de l'ancienne mairie devenue salon du presbytère
en 1868, et aussi de l'incident de 1904 qui feu la cause de la suppression
de la procession à N-D, mais comme certaines personnes qu'il
faudrait mettra en cause- en toute objectivité- sont encore vivantes,
nous renonçons à notre projet.
- 18 .
Rapports avec les Seigneurs de Baudinard.
Dans ce chapitre, nous allons détruire
un autre préjugé tenace: les seigneurs ne vivaient pas
à couteau tiré avec la communauté et ses habitants.
Certes, il y eût des procès
intentés de part et d'autre, les parties étaient aussi
chatouilleuse l'une que l'autre, aussi intransigeante pour la défense
de ce qu'elles estimaient être leurs droits et d'une opiniâtreté
farouche. Mais, alors même que les procès étaient
pendants, des relations amicale de bon voisinage
restaient la règle et des services réels étaient
rendus réciproquement
Pour bien situer le débat, i1
nous faut d'abord essayer de définir exactement quels étaient les droite du seigneur:
a ) on sait rien de positif sur les droits seigneuriaux
possédés par les Blacas-Baudinard. Ils devaient être
grands, car les comtes de Provence- d'après les plus anciens
documents qui nous sont parvenue n'avaient
à Baudinard ni droits, ni biens:
- 1246. -État des droits et biens
domaniaux de Charles I d'Anjou, dressé peu après son entrée en possession du
comté de Provence: évêché de Frejus, Baudinard
, néant.
- 1346. -État des revêtus
de la cour à Barjols et dans son baillage Beaudinard, néant.
Donc, par déduction, les Blacas
avaient tous les droits de justice et de suzeraineté.
b ) bous sommes mieux renseignés sur les droits
des Sabran:
- Nous avons vu qu'es 1393 ( donc au début de la seigneurie des Sabran à
Baudinard)
- Le 9/5 1439, les Maîtres rationaux
vendent à Jean de Sabran, le droit de dépaissance au terroir
de Baudisard moyennant la somme de 100 florins, use fois payée.
- Le 28/10 1441, lettre des Maîtres
rationaux portant que les habitants de Baudisnard payeront au seigneur
dudit lieu 100 sous " pour l'albergue".
- Le 17/2 1443, le Roi René confirme
à Jean de Sabras, les revenue de l'albergue de Baudinard valant
5 sous coronats.
- Le 26/7 1463, lettres accordées
par le sénéchal de Provence à Jean de Sabran, seigneur
de Baudinard, qui lui permettent de faire exercer la justice audit Baudinard,
en raison des crimes qui seront commis dans les autres biens inhabités
qu'il possède.
- En Septembre 1495, le Roi Charles VIII
confirme à Pierre de Sabran tous les droits qu'il a sur Baudinard.
- De plus, en cas de danger, la communauté
devait fournir des hommes pour la garde du château. Dans la 1ère
délibération communale qui nous est parvenue (1591), le
conseil décide de louer des hommes pour la garde du château
aux gages mensuels de 20 florins par homme. La même année,
renouvellement des "escouades" pour la garde du château, lesquelles
seront de 8 hommes payes 6 sous le jour et 2 sous la nuit. Cette garde
est souvent renouvelée pendant les périodes de troubles.
Pourtant, en 1595, le conseil ayant délibéré de
garder le château, 3 conseillers protestèrent " à
cause qu'ils n'ont auculne chose dans ledit château" disant "
que aura ces biens dedans que le garde". ( Ce
qui démontre que les habitants devaient mettre à l'abri
ce qu'ils avaient de précieux).
Es 1683, le conseil de la communauté
députe à Barjols pour déclarer que la commune ne possède aucuns biens
relevant de la directe du Roi
que la directe du lieu appartient au seigneur; que lés
consuls n'ont aucune juridiction, que les habitants ont seulement le
droit de pâturage
Les bois et qu'ils payent une tasque
sur les grains du 1/14.
En 1730, dans un extrait de déclaration
pour la confection du nouveau papier terrier, on lit:
-
Baudinard, baronnie, Jean Francois
de Sabran seul seigneur direct, justicier et foncier.
-
droit des habitants de faire depaitre
dans les terres gastes et de ceuillir des glands.
-
Pension féodale annuelle
de 14 sous, pour l'usage d'une forge.
-
Pour banal dont le fermier reçoit
un pain sur trente ce qui rapporte environ
Dans un procès avec le domaine,
en 1743, cette phrase " le droit d'albergue ainsi que celui de ramage
pesquinage à été donné
au seigneur du lieu par les comtes de Provence".
Voilà les documents officiels.
Nous avons vu dans le Chapitre sur les affouagements, les charges de
1a commune envers le seigneur
Voici maintenant un dénombrement
de la terre et seigneurie de Baudinard dressé
en 1684, par Elzéard de Sabran, seigneur
de Baudinard:
- C'est "l' adveu" et dénombrement,
des fiefs, domaines, "droicts"
Et devoirs seigneuriaux de Messire
Elzéard de Sabrant seigneur de "Beaudisnard"
- Dit qu'il possède pur la succession
de père à fils toute ladite terre et seigneurie de "Beaudisnar",
située dans ce pays de "Prouvence", viguerie de "Barjoulx", confrontant
Régusse, Artignosc, Montpezat et Beauduen
- Et a toute juridiction haute, moyenne
mère, mixte et impère avec pouvoir d'instituer et destituer
tous les officiers.
- Il lui appartient audit lieu les droits
de régale, leyde, passage, pulvérage, albergue, droit
de "lodz" au douzain des "allivrations" échanges, confiscation,
etc.., droit de fourrage au trentain et "'bannalités" droit de
tasque au douzain, sur tout le terroir, grains sur toutes sortes et
légumes.
- Ledit seigneur a le droit de faire
moudre au moulin de Fontaine-l'évêque.
- Plus il possède un château
dans le lieu de "Beaudisnar", un four
ville, un jardin et.40 charges environ de biens nobles, 25
"soutoirées de
pré noble dans lesquels contenant il y a une bastide pour
la "ménégerie" et un pigeonnier.
- Il possède dans ledit lieu un
logis noble et 3 bastides dans le terroir dudit lieu, nobles:
1 de 50 charges de semence, noble;
1 de 100 charges de semence, 1/2 noble, 1/2 roturier.
1 de 20 charges de semence, 1/2 noble, 1/2 roturier.
- Le seigneur dit que toute la terre
gaste lui appartient en toute propriété et qu'il
a le droit de la bailler à nouveau bail. .
- Il possède et lui appartient
un droit de "subside"(?) sur tous les habitants et forains dudit lieu,
ceux qui ont une paire de boeufs 3 setiers d'avoine et 8 sols et les
autres le 1/2, le jour de la fête de Noël.
- Et finalement le seigneur a et lui
appartient une pension féodale et
seigneuriale de
- tous ces droits sont saufs de
soute espèce de charges, déclarant qu'il les possède
depuis plus de 3 Siècles, ne relevant et dépendant immédiatement
que de da Majesté, lui ayant ledit seigneur fait "foy et hommage."
Ce dénombrement ne concorde pas
exactement avec les charges accusés
Par la communauté, sans marquer
toutefois une grande différence.
Bien entendu le seigneur recevait l'hommage
et la reconnaissance de ses vassaux
- députation au seigneur des consuls,
du lieutenant de juge, du greffier, de Bourges notaire et de 35 autres
habitants du lieu, pour lui prêter hommage. (1719)
- nomination de député
pour passer de "nouvelles reconnoissance" à jean-francois de Sabràn, seigneur et marquis
du lieu et lui "prêter hommage de fidélité". (1739) ( d'après un mémoire cette même année
, la reconnaissance est due de 20 ans en 20 ans et l'hommage, une seule
fois dans la vie du seigneur.)
Voilà tous les renseignements
que nous possédons sur la question et ils sont largement suffisants
pour marquer approximativement les droits et devoirs de chacun.
Voyons à présent, et en
premier, les points de friction mis en évidence par les procès.
Le plus ancien dont nous ayons connaissance-
relatif aux droits seigneuriaux se termine par une transaction entre
Elzéar de Sabran, Jean de Sabran, son fils, d'une part et la
communauté de Baudinard, d'autre part (1426) .
Nous trouvons ensuite:
- Sentence rendue dans la cause entre
Louis de Sabran et la communauté de Baudinard (1548)
- Le conseil délibère de
consulter sur les inhibitions signifiées par
-
- Le conseil intervient en faveur de
divers habitants ajournés, à la requête de
- Emprunt pour les frais du procès
contre Marguerite de
et envoi d'un homme à Aix pour consulter à
ce sujet (1599)
- Exécution contre divers particuliers,
à la requête de
- Députation à Aix:
pour sommer
- Saisie de "grand quantité" de
bestial bouvin" per Claude Roux; députation des consuls à
Artignosc où le bétail a été conduit, pour
tacher d'en obtenir le relax et mission aux mêmes de mander à
Aix, poux poursuivre les procès contre
- Jugement d'un procès "entre
les consuls et la communauté du lieu de Beaudisnar, demandeurs en appellations de liquidation
de tailles de l'an 1556 du sieur Antoine de Sabran, d'une part, et demoiselle
Marguerite de la Garde, veuve d'Antoine
de Sabran, mère et tutrice des hoirs, deffanderesse d'autre part".
La cour décide (de distraire les biens acquis par la demoiselLe
de
Procès avec Marguerite de
-
en defense de créer de
nouvelles aires
-
en injonction de transporter
les gerbes sur les aires d'usage (1609), puis nomination de 4
arbitres pour arbitrer le procés.
-
Intervention en faveur de divers
habitants ajournés à sa requête
"ayant charge de ladite Dame" (1612)
- Délibéré de terminer à l'amiable tous
les différents avec la dame de ce lieu et de passer compromis
( 1613)
- Proposition de sa Dame du lieu de "fere paver les prés afin
que chacung jouisse de son bien, ce qui seroit ung grand proffit du
public"; le conseil décide de d'en tenir aux transactions sans
y déroger .(1614).
- Arrêt d'expédient rendu
entre les consuls et Jean de Sabran 1624.
- Procès à Aix contre le
seigneur, au sujet du ramage et acompte N Hubaut, qui a vaqué 28 jours, 2 écus
30 sous (1645)
- Députation à Aix, pour
défendre au procès concernant le taillon; frais,
- Mission à Bourges, bourgeois
de Baudinard, de procéder à la vérification des
différences que le seigneur du lieu prétend exister entre
la sentence arbitrale de 1735 avec la sentence arbitrale
de 1618, le règlement "pro modo jugérum" de 1642 et de
1647, le sentence arbitrale de 1662 et la transaction de 1664
( Nous n'avons trouvé aucune trace de toutes ces sentences).
Et mission aux consuls de la communauté" et au greffier de passer
tous actes à ce sujet et touchant la revendication par le seigneur,
des "routes" du Défends de
- Délibéré, à
la demande de l'intendant, de joindre au papier terrier les droits d'albergue
et de cavalcade, de ramage et parquerage, de payer les lods et demi
lods du transport du droit de jambon que le séigneur pouvait
exiger de tous cochons tués dans ce lieu (
1742).
- Extrait de contrainte pour amortissement
du droit de jambon bonne moyennant
- Lettre autographe du seigneur :"voullant
traiter humainement tous les particuliers habitains le lieu de Beaudinar
qui ont fait des dégradations dans les bois dudit lieu,
je me dépars de leur faire de la procédure" sous la promesse
qui m'a été faite de leur part de ne plus récidiver
"leur quittant tout dépens, amendes et dommages intérêts
qui m'auraient pu m'être adjugés" Signé: Sabran-Beaudinar
(1745).
- Délibéré de faire
consulter si le seigneur du lieu a le droit de faire
régler "pro modo jugerum" la quantité de cochons que le
territoire peut nourrir et payement de
- Droit de lods pour "l'acquisition ou
extinction" que la commnauté a fait au seigneur de la redevance
d'une épaule de cochon due pour chacune de ces
bêtes tuée par les habitants,
- Procès intenté par le
seigneur pour faire fixer la quantité de "couchons" qui pourraient
être nourris sur la territoire; arrêt de la chambre des
Eaux et Forêts, portant que la quantité de glands récoltés
année courante détermine la quantité de cochons
qui peuvent être nourris et le nombre en sera déterminé
par expert ( 1748-1749) ( On voit par ce
procès que le seigneur cherche à limiter le nombre de
cochons engraissés dans la commune, dès que la communauté
eut racheté le droit de jambon; il faut croire aussi que ce rachat
avait du augmenter sérieusement le nombre bêtes engraissés).
- Délibéré de prier
le seigneur du lieu de "donner un mémoire séparé
de ses droits et prétentions", sur les biens abandonnés
par divers, d'y joindre les "raisoun" de la communauté et de
faire consulter; députation de Bourges pour consulter , voté
à la majorité après la "purge"du conseil et "par
option ecrite" (1752).
- Proposition au seigneur Joseph Jules
de Sabran de faire arbitrer tous leurs différents et de lui accorder
les demi lods; acceptation dudit seigneur ( 1754).
- Honoraire à 2 avocats pour vacation
dans-le procès contre le seigneur,
- Frais de la transaction passée
avec le seigneur,
- Minute de transaction avec le seigneur,
contenant abonnement du four banal moyennant une pension féodale
de 16 charges de blé froment (XVIII Siècle).
On peut formuler 2 observations après
cette énumération:
a ) si l'on excepte Marguerite de
b ) de tous ces procès et de toutes ces transactions,
on ne connaît presque jamais le résultat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abordons les complaisances et services
rendus:
- Nous avons déjà relaté
que les seigneurs étaient parfois les parrains ou marraine des
roturiers et qu'ils acceptaient la réciprocité pour leurs
enfants. Il y a mieux.
On a vu quelle grande et opiniâtre
plaideuse fut Marguerite de
Et nous trouvons ensuite:
- Délibéré de prier
le Baron, seigneur du lieu, d'aller à Aix mander la conservation
des droits de la communauté de Baudinard sur ses vieux domaines
(1671).
- Le seigneur autorise la communauté
à défricher le Devens moyennant 400 écus (1672)
(1692) etc..
- Délibéré de prier
le seigneur du lieu, en se rendant à Aix, de réclamer
la part revenant à la communauté sur les
- Pouvoir aux consuls de dresser l'état
du blé nécessaire aux habitants, lesquels seront tenus
de le rembourser à
Notons aussi ce détail : à
la ferme du Jas, dépendance du château tout près
de Baudinard, se trouvait un cabanon distant de quelques mètres
la bâtisse principale. Une clause du testament d'un Sabran avait
réservé ce cabanon à tous les errants de passage.
En 1900, pendant. notre séjour Baudinard
cette clause était encore respectée et les usagers le
savaient bien qui se trouvaient là un abri et une bonne litière.
Et voici la contre partie:
- Mission aux consuls de passer l'acte
de liquidation des tailles 1682 à 1694 du seigneur du lieu et
de lui accorder tout délai pour le paiement, moyennant intérêts
(1695).
Mais c'est surtout dans la décharge
des tailles dues par le seigneur pour ses biens roturiers que le conseil
montre ses bonnes dispositions envers le seigneur; cette décharge
qui se renouvelle presque tous les ans est parfois accompagnée
d'une remarque "côte irrécouvrable", "cote morte ", "pour certaines considérations", défalqué
suivant la coutume"
Enfin lors de certaine événements
heureux, le conseil de la communauté faisait un présent
au seigneur du lieu ou le complimentait:
- Aux consuls,"pour aller donner le présent"
à M. le Baron,seigneur du lieu, à
Aix,
- Prix d'un mouton donné en présent
à Madame
- Achat d'un pourceau pour faire présent
au seigneur en "considération de ce que a fait obtenir son bestail
de n'aller aux cartiers que l'i avait de glan",
- Vote d'un emprunt de 20 pistoles, porté
ensuite à
- Transport d'un veau offert en présent
au seigneur à l'occasion du mariage de sa fille, 12 s. (1687).
- Présent au Baron à l'occasion
du mariage de sa fille (Madeleine fille d'Elzéard et d'Isabelle
de Cabannes avec Jean-François de Berthet, seigneur de le clue):
1 quintal (
- Députation du lieutenant de
juge, des consuls, etc. a Aix, pour féliciter le Marquis, seigneur
du lieu, son épouse et sa famille, de leur retour en bonne santé
de Paris où le Marquis avait demeuré plus d'un an comme
député de
- Présent d'un veau au seigneur
du lieu (1718).
- Présent au seigneur Jules Comte
de Sabran, suivant son contrat de mariage avec Thérèse
d'Arlatan, Dame de ce lieu,
- Présent au Marquis de Sabran
à l'occasion de son mariage (avec Anne Gabrielle de Brémond)
Nous verrons plus loin comment ces bonnes
relations changèrent brusquement à
- 19. Procès de la communauté.
En. dehors des procès que nous
avons relatés, la communauté a vécu très
paisiblement; c'est à peine si quelques actions en justice ont
été intentée au cours
de plusieurs siècles;
- Le conseil délibère de
faire informer contre André Bourges, fils de Claude, pour avoir
injurié le 1er consul et l'avoir gratifié de larron ( 1614)
- Délibéré d'avertir
la commune d'Artignosc de se joindre à celle de Baudinard dans
le procès de N. de Montpezat qui refuse de se soumettre aux lettres
du lieutenant de Digne(1655) et en 1659,
procuration à N. Bourges, procureur de la communauté,
de présenter requête d'opposition au Parlement contre N.
de Montpezat ou son fermier qui "a saisi par force et violence" des
truies et des pourceau des particuliers de Baudinard refusant d'acquitter
les droits de péage (1659)
- Procès contre un ancien trésorier
(3 fois )
- Délibéré de prendre
fait et cause pour les habitants du lieu contre le seigneur de Montpezat
qui réclame un droit de leyde pour les pourceaux conduits à
la foire de Riez (b678)
- Procès intentés à
des anciens fermiers de l'imposition des fruits (
1762 et 1765)
Enfin, en 1754, querelle, insultes et
troubles dans une réunion du conseil général de
la communauté "certains étant d'une opinion contraire
la proposition du conseil".
Et c'est tout. Pour ces quelques procès
dont on ignore l'issue, la communauté dût avoir gain de
cause car on ne trouve dans les comptes tresoraire que des dépenses
occasionnées par ces consultations et des déplacements
pour poursuivre les procès.
20. MILICE
Nous avons vu que le château était
gardé pendant les périodes de troubles et que la communauté
devait fournir les hommes nécessaires pour assurer cette garde.
Mais nous voulons parler dans ce chapitre des miliciens. qui
devaient partir pour l'armée et les archives nous fournissent
quelques renseignements précieux à ce sujet:
- achat de fusils et épées
pour les miliciens (1690).
- Désignation de 2 miliciens qui
seront armés par les consuls(1692).
- Accord avec E. Delphin, de Baudinard,
qui s'engage à servir comme soldat de milice, moyennant
- Mission aux consuls de faire "diligence"
pour arrêter les miliciens déserteurs et députation
de J.Bpte. Bourges à Aix, pour demander :
a )au marquis de Brancas, un passeport pour faire suivre
les fugitifs et les jeunes gens du lieu en age d'être miliciens
qui, à la nouvelle de la livrée d'un soldat de milice
se sont enfuis au-delà du Verdon et même de
b ) la dispense pour la communauté de fournir le
soldat de milice demandé "atandu qu'ils ont déjà
fait 3 hommes quy est 6 fois plus qu'il ne monterait son contingent"
(1722)
- Le conseil désigne une
commission "chargée de créer un soldat de milice" (1740)
- Habillement d'un milicien,
- Le conseil désigne une commission
chargée de dresser l'état des garçons et hommes
mariés sujets à la milice (1743)
- Députation de Simon, consul,
pour conduire les miliciens à Aix (1756)
- Désignation d'une commission
chargée de dresser l'état des garçons de 16 à
40 ans et des hommes mariées ayant moins de 20 ans (1757)
- De nombreuses lettres du subdélégué
et des ordonnances et instructions concernant la milice et surtout les
miliciens déserteurs, ce qui laisse supposer que ces derniers,
éteint nombreux.
-
21. Faits de guerre.
Le "castrum"- lieu fortifié- de
"Beldisnard" était assez petit,il
comprenait les maisons qui entourent la placette- avec l'église-,
les maisons autour de la place et les maisons qui bordaient d'un côté,
la rampe raide qui réunit les 2 places.
La place était fermée aux
deux extrémités par un portail, à deux arcs sur
la route de Riez, et à 3 arcs sur celle d'Aups. Un petit redan
faisait hernie au S-0; il était réuni à la place
par 2 passages voûtés traversant les maisons, mais particularité
curieuse l'un de ces passages se situait entre la place et le
portail d'Aups (en partie bouché, il subsiste encore de lui "le
passé") tandis
que "l'autre (complètement bouché aujourd'hui,
l'arc de la voûte est visible aboutissait en dehors de la place,
sur la route de Riez, juste après le portail.
(1756)
Les 2 arcs du portail de la route de
Riez et les 2 passages voutés du redan étaient romans,
les 3 arcs, de la route d'Aups étaient
ogivaux, ce qui fixe la construction de la fortification
à la fin du X° siècle ou au commencements du
XI°.
Si le castrum Baudinard a été
assiégé, ce qui est fort possible soit pendant
les guerres féodales soit a toutes autres occasions aucun souvenir n'en est parvenu
jusqu'à nous.
Le 1er épisode de guerre certain
est l'attaque de Moustier successivement par les partisans de
Charles de Duras , commandé par Albert
de Blacaset par ceux de Louis II d'Anjou, dont nous avons parlé.
A partir de 1384, c'est Raymond de Turenne
qui terrorise
La paix est signée en 1391 , mais elle est de peu de durée, si bien qu'en
1393, "les chaleurs avaient déja tiré leurs plus grands
coups, car
les jours du Chien et du Lion estaient finis, quant au
dernier du mois le Prince
( Charles de Tarente, frère du Roi Louis II) partit de St Martin
(de
Guerres de religion.
C'est une question qu'il faudrait
reconsidérer tout au moins pour
Le 5-7-1574, les huguenots s'emparent
de Riez, et le 6 de Bauduen, dont l'église est détruite.
Au mois d'octobre de cette même année, Aups ayant refusé
de payer une contribution de guerre aux protestants fut attaqué
et pillé; il y eut 120 victimes comme nous l'avons, raconté
dans un chapitre précédent. Les troupes huguenotes venant
de Riez, ont traversé Baudinard 2 fois; au retour elles arrivèrent
assez tard dans le bois de Baudinard, profitant de l'obscurité
quelques prisonniers se sauvèrent. Honoré Thadey, chanoine
de l'église d'Aups ( et prieur de
St-Michel) âgé de 70 ans fut frappé de 2 coups d'estoc
à la cuisse et laissé mort à 1/4 de lieue de Baudinard.
Il ne mourut pas, ramassé le lendemain, il fut porté au
village, soigné et guéri.
En 1586, de Vins se trouvait à
AUPS (les consuls de Barjols lui écrivent en ce lieu au mois
de Juin 1586); il le quitta pour aller assiéger Allemagne où
son armée fut défaite, mais où le Baron d'Allemagne
trouva la mort. Ses troupes ont traversé Baudinard.
En 1591,
A partir de cette date, nous allons puiser
nos renseignements dans les archives, en fait pas grand-chose des réquisitions de
boeufs _pour des transports divers , des contributions au frais de subsistance
des troupes. des emprunts
pour payer les frais occasionnés par le logement des troupes
des rétribution de
quelle fut l' attitude des Baudinardais pendant toute cette
période de guerres civiles ? La soumission
. Les troupes des _deux partis ont traversé Baudinard
et y ont séjourné. Le village fournissait les subsistances
pour les hommes et les animaux, en se faisant aider par les villages
voisins, quitte à leur rendre le meme service lorsque l'occasion
se présentait et en essayant de se faire rembourser ensuite.
Les habitants avaient transporté ce qu' ils avaient de précieux
dans le château féodal et les seigneurs devaient âtre
assez pacifiques, car leur nom ne figure dans aucun écrit des
historiens, ni dans les mémoires des contemporains alors qu'on
rencontre les Sabran d'Ansouis et les Blacas d'Aups. aussi
le château ne fut pas assiégé et Baudinard n'eut
pas à souffrir particulièrement. Une seule réclamation
figure dans les délibérations de l'année 1600,
contre les Cies de Lesdiguieres, mais si l'on en juge par l'indemnité
qui fut accordée à cette occasion, les dégâts
n'avaient pas été très importants et consistaient
en "prime de bestail".
Invasion
du Duc de Savoie. ( 1707 )
Pour défendre notre grand port
maritime, le Maréchal de Tessé fit venir ses troupes en marche forcée des Alpes à Toulon
par Riez, Quinson et Tavernes. Quelques éléments ont pris
l'itinéraire Riez, Baudinard, Montmeyan. En 1708, le conseil
vote le remboursement aux habitants des fournitures de guerre faites
l'année précédente et députe à Aix
pour réclamer le remboursement de ces dépenses.
Les troupes repassent en 1709 et 1710,
et en particulier les régiments de Grigny et de Virac.
Invasion austro sarde ( 1746-1747
).
L'armée austro sarde, sous les
ordres du général autrichien Braün envahis la' Provence
par 3 colonnes marchant de front. Celle du nord suivît l'itinéraire:
Grasse, Castellane, Moustiers; elle atteignît la ligne: Moustiers,
Aups, Salernes, Entrecastaux, Cotignac ( Décembre
1746).
C'est au cours de cette invasion que
Baudinard connut le seul fait d'armes parvenu à notre connaissance:
au mois' de Décembre, un détachement ennemi, dont on ne
connaît pas l'importance se présenta devant Baudinard et
fut repoussé Il existe aux archives la copie du brevet adressé
par le Duc de Belle-Isle au seigneur de Baudînard (alors Joseph
Jules de Sabran) l'investissant du commandement des habitants autorisés
à prendre les armes
" Pour la defense du château, du
territoire et la conservation de la patrie"
Probablement sous l'impulsion du seigneur,
le conseil vote:
- de "ce laisser plustot brusler que
de payer aucune contribution aux ennemis"
- de' fortifier le château et le
village;
- de demander la permission d'armer les
habitants et d'acheter des munitions;
- emprunter
Les portes furent remplacées (acompte
du prix des portes qui ferment le village 10L 12s.) et certains
travaux de défenses effectués.
l'Ennemi se présenta et fut repoussé; des milices
des environs "marchant a l'aventure" arrivèrent au secours de
Baudinard et les aidèrent ainsi qu'il ressort de ce compte tresoraire:
fourniture de vin, pain, et foin à un détachement d'environ
80 paysans armés venant de fontaine l'évêque " à
la découverte…..les ennemis ayant donné lieu à
une alerte….sa présence ayant beaucoup contribuer a les
éloigner" 46L 4s.
Le Duc de Belle-Isle marqua deux fois
sa satisfaction au seigneur;
- félicitant les habitants de
leur zèle;
- félicitant les habitants de
leur prise d'armes: "vos voisins eussent pris le même party, il
n'auraient point essuye tous les damages qu'ils souffrent".
dans sa dernière séance
de 1746, le conseil décide de demander l'autorisation d'emprunter
afin de payer le travail et les fournitures faites l' occasion ce la
guerre, ainsi que pour remplacer les mulets et chevaux "perdus ou ruinés"
pour le transport des denrées, foin et paille aux magasins de
Draguignan, Aups, Salernes et Baudinard, aux habitants qui "en prenant
les armes et faisant par ordre des manoures de guerre, ont baucoup contribué
à éloigner (les ennemis) du voisinage du lieu et demander
si l'on doit continuer à monter la garde".
<>En 1748, à la suite de
nouvelles craintes, le conseil donne mission aux
consuls: de pourvoir à la réparation des portes du village
et des "pavés", à l'achat de grains et de munitions de
guerre; aux fortifications; le conseil ayant délibéré
sur l'avis du seigneur de "se défendre au cas que le lieu vint
à estre attaqué et de lesser plutot brusler que de fournir
un sol aux ennemis".
Les dépenses occasionnés
par la guerre s'élevèrent à
Parmi es dépenses, notons:
- Fournitures de foin à des troupes
qui ont séjourné 15 jours à Baudinard, 25 1. 15
s.
- Remboursement au chirurgien "d'une
chaise qui servait à raser les habitans (sic) et que rompirent
et bruslèrent les troupes françaises", 1L 16 s.
- Transport de soldats malades,
- Transport à Montpezat et Moissac
de 485 paquets adressés aux commandants et généraux
dés troupes",
- Rafraichissenlents offerts aux miliciens
qui vinrent aider à répousser les ennemis,
- Réparation aux murailles,
- Prix de location d'une maison servant
de corps de garde en 1746 1747,
Relatons encore quelques' incidents:
- La découverte par le garde magasin
de 2 pierres d'un poids au dessus de
- une lettre demandant l'état
des boeufs, chevaux, mulets et bourriques" du lieu, avant le landemain
10 heures, sous peine de garnison 2 grenadiers chez les
consul . ( voici
ce rôle: 12 mulets, 16 boeufs, vaches, 12 bourriques, 27 béliers,
146 agneaux;
- un certificat attestant la mort d'une
vache marquée d'une fleur de lys sur la fesse gauche- etc..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En 1851 ,
à la suite du coup d'état de Bonaparte , les républicains
var se soulevèrent et se dirigèrent sur Aups, désigné
comme point de rassemblement. Dès le 6 Décembre , ceux
de la région affluèrent au chef-lieu canton venant
de Baudinard,Bauduen Artignosc, Moissac, Les Salles, -Dusse, montmeyan,
etc.... en tout environ 400 hommes.
Ceux de Baudinard étaient les
plus nombreux; on leur avait persuadé que le sort d'un
procès pendant la commune et un grand propriétaire forestier,
au sujet des droits d'usage communaux, dépendait du coup d'état
du 2 Décembre. On connait le résultat de la bataille d'Aups;
après le combat, un Certain nombre de fuyards traversèrent
Baudinard avant de gagner leurs foyers.
........................................................................
Terminons ce chapitre en mentionnant
qu'au cours de la guerre 14-18 Baudinard a perdu onze de ses enfants
et un au cours de la guerre 1939-1944 .
22.
Les registres de délibération
manquant de 1760 à 1789 inclus et les comptes trésoraires,
quoique complets, sont très laconiques, aussi avons nous très
peu de renseignements sur la période prérévolutionnaire.
les cahiers de doléances n'existent
plus; ils ne devaient pas varier beaucoup avec ceux des autres communes
varoises dont il existe de nombreux exemplaires.
Extraits les plus caractéristiques
du compte trésoraire 1789-1790
Chargement
Déchargement
Dépenses:
- au tambour et au fifre "qui ont servy"
pendant 4 jours pour la milice ou troupe nationale,
- Frais de création de la milice
bourgeoise,
- Achat de drapeaux, de poudre et de
cocardes,
- Frais du rapport d'encadastrement et
alivrement des bien privilégiés
- Frais de descente d'A. de Ballon, commissaire du Parlement; collation donnée
aux dragons de sa suite "pour les faire réfléchir",
Ceci demande une explication. La communauté
d'Aups, ayant préparé ses cahiers de doléances aux Etats Généraux,
Broulhony de Montferrat, trésorier de France, refusa. de
les signer, ce qui mit la localité en effervescence. Deux jours
plus tard, le 25 Mars, date d'une des plus grandes foire
de l'année, de nombreux habitants des environs vinrent à
Aups. Dans le courant de l'après-midi, une multitude de gens
aupsois et régionaux entourent la maison de Broulhony, criant,
l'injuriant, puis jetant des pierres contre les portes et les croisées.
De Broulhony, caché dernière une fenêtre
2ème étage, armé
de son fusil, fit feu par 2 fois sur la foule tuant une personne et
en blessant mortellement une 2ème. Les assaillants se ruèrent
sur la porte, la forcèrent, rattrapèrent de Broulhony
qui s'était refugié sur le toit, l'amenèrent à l'endroit
ensanglanté par les 2 victimes et, là, l'assommèrent.
Son corps fut ensuite trainé dans les rues et jeté dans
une fosse à fumier. Les femmes se montrérent les plus
féroces.
Les sinistres événements
de cette journée eurent un grand retentissement en Provence
et produisirent une vive impression.
Le Parlement ordonne une enquête
et la commission: envoyée à AUPS procéda à
de nombreuses arrestations, Or le rapport des commissaires enquêteurs
se termine ainsi: "les enquêteurs s'en iront demain à Baudinard
où des troubles gravés se sont produits".
nous ne savons si les enquêteurs ont fait un rapport
sur "les troubles graves de Baudinard", nous n'avons rien trouvé;
mais il est hors de doute que la dernière dépense dont
nous avons fait mention se rapporte à cette enquête. Quel
sens faut-il donner à ce bout de phrase " pour les faire réfléchir
?" Est-ce une menace ? on le dirait.
Quel dommage que le registre des délibérations
ait, disparu....
Il faut se reporter, un peu, par la pensée,
à cette date de 1789, pour juger de l'état d'esprit
des populations. L'hiver 1788-1789 avait été très
tres froid et très dur et la misère était atroce.
Du 23 au 29 Mars on constate de nombreuses
révoltes de paysans et d'ouvriers provoqués par la famine,
non seulement dans les grandes villes, mais à Barjols,
Aups, Salernes, etc.. greniers pillés, boutiques forcées, mairies envahies,
etc..
A cela s'ajoute l'insécurité.
On lit dans les cahiers de doléances d'Aups: "il est déplorable
presque toutes les semaines d'entendre parler des vols faits sur les
grands chemins qui aboutissent à Aups et même de ceux qui
se comettent dans les campagnes et dans la ville même par effraction
de portes et de boutiques". Et les Cahiers indiquent comme cause 1ère
de cette fréquence: "les bois qui couvrent les chemins passant
par les fiefs de Moissac, de Fabregues, de Baudinard, dont les seigneurs
puissants se sont mis au-dessus des Arrêts des Cours qui ordonnent
de couper et détruite lesdits bois à la distance desdits
chemins de 40 toises environ".
A la fin de Juillet, la surexcitation
est telle que les citoyens sont prêts à accepter les nouvelles
les plus invraisemblables. C'est alors que de produisit
Des bandits ( de
600 à plusieurs milliers- on a dit 30.000 dans certaines communes)
saccageaient tout au delà de
:chaque commune ou presque a sa version. Partout pour résister
aux brigands, on crée des milices et on prévient
les voisins. Bauduen, alerté par Riez envoie des émissaires à Baudinard et Aups, (qui
transmet à Tourtour et successivement, Flayosc, Draguignan, Callas,
Seillans, Fayence, etc.., sont informés. La panique est à
son comble jusqu'au jour où les communes reçoivent
une circulaire rassurante d'Aix:
- il n'y a pas ce
bandits
- ne demandez pas des soldats qu' on ne peut pas vous accorder,
- Les précautions sont superflues,
- n'employez pas à des patrouilles
inutiles des journées précieuses. le calme revient rapidement et ... les milices étaient
créées.
Au début d'Avril 1789, les Électeurs
du Tiers-état étaient convoqués pour désigner
les 54 délégués qui le 7 Avril 1789, devaient élire
les 4 députés du Tiers-état: Baudinard, Bauduen,
Artignosc, Les Salles et Aiguines ne déléguèrent
personne à Draguignan, alors que Vérignon (
1), Tourtour (3), Villecroze (3), Moissac( 2 ), Régusse
(2), Salernes (4), et Aups (4) étaient représentés.
Ce qui ressort nettement des délibérations
du conseil, en 1790, c'est la différence d'attitude envers le
seigneur:
- Délibéré de procéder
au rapport d'encastrement et alivrement des biens, droits et facultés de N. de Sabran, entre
autres des bois de chênes
verts de l'Auzière revendiqués par ledit de "Sabran" contre
le teneur des titres les plus anciens des différentes transactions"
et pour que cet encadastrement ne porte aucune atteinte aux droits
de la communauté charge le maire et les officiers municipaux
de comparaître devant Mm les experts pour protester contre la
prétention que M de Sabran a manifesté d'être
propriétaire des biens du terroir et notamment de celui appelé
le Défends de Vaumogne.
- Lecture est donnée de la sentence
arbitrale passée entre les habitants et le seigneur du lieu le
10 Mars 1426 (quel dommage qu'elle ne soit pas reproduite). "Le 1er
mouvement des représentants de
- Délibéré de faire
signifier un acte extrajudiciaire au ci devant seigneur pour qu'il ait
à justifier de l'achat de la banalité du four à
pain.
- Construction du four à cuire
le pain, par un maçon de Régusse, moyennant
- Suspension du payement de la tasque
et de la pension seigneuriale de 8 charges de blé au fermier
général du ci-devant seigneur N. de Sabran
- Protestation du Maire et officiers
municipaux, en vertu de la sentence arbitrale du 14/3/1426, contre la
perception du droit du 1/14 "sur les grapiers et les moulons au sol",
etc..
Il existe aussi aux archives départementales
des B.du R., une lettre des consuls
de Baudinard aux états de Provence, au sujet de la vente faite
par le marquis de Sabran d'un grand bois de chênes, sur lequel
la communauté avait des droits de glandage, ramage, etc..
Le produit de la taille des biens privilégiés
du seigneur se monte à
Les élections de 1790 sa firent
dans l'église sous la présidence du curé Mégy;
elles furent suivies de la prestation du serment par les élus.
Le conseil :
-
- procéda à l'élection
de 3 habitants députés à Barjols, à la réunion
de la garde nationale du district chargea d'élire les délégués
à
- demanda le maintien du district de
Barjols.
- Vota l'achat de 4 "chirpes" pour marque
de "distinction à la place des chaperons".
- décréta la mise aux enchères
devant le Cabaret "où pend pour enseigne la pucelle d'Orléans"
de la trésorerie à charge de percevoir une taille d'un
sou par livre cadastrale et une taille de bétail de 12 d. également
par livre cadastrale; de payer les deniers du Roi et du Pays les pensions
et tous autres mandats, à condition de ne pouvoir prélever
que 7 deniers par commandement et 24 sous par saisie dans les poursuites
pour payement d'arrérages,
- demanda l'incorporation de Baudinard
au canton de Régusse à moins qu'il "ne soit placé
quelques autres communautés au canton de Bauduen".
Le Var avait été divisé
en 9 districts par lettres patentes du 4-3-1790:
Toulon, Grasse, Hyères, Draguignan,
St-Maximin, Brignoles, Fréjus, St Paul, Barjols, 81 cantons et
228 communes.
Le district de Barjols comptait 13 cantons;
Barjols, Tavernes, Entrecasteaux, Fox-amphoux, Cotignac, Aups, Bauduen,
Aiguines, Régusse, Ginasservis, St Julien,
Le canton de Bauduen ne comprenait que
2 communes: Bauduen, 1 feu et Baudinard, 1 feu et 1/22.
Dans la nouvelle organisation du 30 Vendémiaire
an IV (12-10-1796?.) le Var est divisé
en 73 cantons groupant 206 communes. Le district de Barjols n'a plus
que 12 cantons et 27 communes. Le canton de Bauden n'a pas été
modifié.
Enfin le 28 Pluviose an VIII (17-2-1800),
le Var est divisé en 4 arrondissements et 73 cantons comptant
209 communes. L'arrondissement de Draguignan est composé de 19
cantons dont Bauduen avec toujours Baudinard comme seule commune.
Il existe aux archives départ.
des B.du R. une lettre des consuls de Baudinard aux Etats
qui démontre bien que
L'année 1792 vit la grande offensive contre les seigneurs
et leurs châteaux.
C'est Flayosc qui donna le signal: les 3 et 4 Mai, les habitants attaquent
le château, le Prennent et le démolissent en partie.
Cet acte fût blâmé par le district et
par le département, mais il fut approuvé Par l'assemblée
législative qui rendit un public hommage au patriotisme des délinquant
et décidé que ce qui restait debout du château serai
rasé.
Les Salernois, brûlèrent
le leur le 6 mai, puis Trans, Régusse, Moissac suivirent, en
octobre ceux d'Artignosc et de Baudinard furent menacés du même
sort. Celui de Baudinard fut démoli,
en 1793, on ignore la date exacte.
Au mois d'Août 1792 eût lieu
une levée de volontaires pour renforcer l'armée d'Anselme,
Elle ne se fit pas sans difficultés: en fin de compte il fallut
presque partout tirer au sort parmi les miliciens et les gardes nationaux.
A Baudinard quelques citoyens estimèrent
que les notables devaient s'enrôler comme les autres: le Département
écrivit au District de faire observer à ces citoyens que
le conseil géneral de la commune etait en surveillance permanente
et qu'ils ne pouvaient pas quitter leur poste sans être
déclarés traîtres et infâmes et il ajoutait
:" nous ne doutons pas qu'ils se désistent leur opinion".
Baudinard founit 4 volontaires. De
plus le Directoire du Département ayant rappelé à
ses administrés que les citoyens qui ne "volaient pas aux frontières
devaient livrer leurs armes", Baudinard versa 4 fusils.
Au début de 1793 fût levé
le Bataillon de Février pour la défense je
Les sections fédéraliste
furent nombreuses dans le Var; elles prirent naissance à Draguignan
en Juillet et se propagèrent rapidement; Aups et Bauduen en eurent
une, Baudinard, non.
Le 26 Août 1793, Pierrugues, qui
venait d'être élu Procureur Général syndic
du' Var, adressa aux 206 communes de son ressort une circulaire demandant
de nombreux renseignements sur la situation agricole et industrielle
dans le Var. Les réponses des communes du District de Barjols
existent encore; voici le résumé de celle de Baudinard:
- 326 habitants;
- Agriculture: on récolte des
céréales, des raisins, des olives, des amandes, des noix.
Le tout, non excédentaire est consommé dans le pays; il
ne manque aucune denrée de 1ère nécessité
et la commune se suffit elle-même;
- Industrie: Baudinard produit chaque
année 2.000 quintaux de tan de chêne vert qui sont dirigés
sur les tanneries d'Aups et de Cotignac;
- Certaines terres pourraient être
plantées en vignes ou oliviers mais à cause du froid,
elles ne sont guère propices à ces cultures;
- Les chemins sont en très mauvais
état, ce qui fait que toutes les denrées sont transportées
à dos de mulet ou autres bêtes de somme.
Pour l'acceptation de
Le 1er Bataillon révolutionnaire
de Barjols, levé en exécution de
Pendant tout le siège de Toulon le bataillon resta à la division du général Lapoye.
Après la prise de Toulon, il fut
dirigé sur l'armée d'Italie, mais presque tous les volontaires
avaient désertés se croyant délivrés de
service puisque Toulon" a été enlevé aux traîtres".
Les maires avaient trois jours pour les faire rejoindre et ils réussirent,.le
bataillon fut dissous entre le 3 et le 20 juin 1794.
Le 6 brumaire an 2 (6 novembre 1793)
Barras en mission dans le var apprend à Barjols ,que des "aristocrates"
s'étaient réfugiés dans les bois de Baudinard,
Bauduen, Les Salles, Aiguines, Il ordonne aux municipalités voisines
de barrer les routes qui y conduisaient avec le concours
de citoyens réquisitionnés.
Il se mit lui-même à la
tête d'un détachement de dragons pour fouiller les
bois. En vain: les contre-révolutionnaires avaient pris le fuite.
On n'arrêta que quelques conspirateurs que Barras fît
traduire à Grasse après les avoir fouillis et interrogés
à Aiguines et Moissac ou il était le 18 Brun aire
( 8 Novembre). Mais cette "chasse patriotique
" permit à Barras de "découvrir des blés"
enfermés dans les campagnes visité et procureur plus de
deux millions à la république en biens des ci-devant absents
.
Le tribunal révolutionnaire
siégea à grasse de décembre 1793 à avril
1794
Il eût à juger beaucoup
de varois. Il n'y eut pas un seul de accusé de Baudinard, ni
des communes voisines.
A ce sujet, indiquons que la Cour prévôtale du
Var qui siégea de 1816 à 1818, ne connut pas davantage
d'inculpé de Baudinard.
Lors de
- Bauduen: 192 pour; 0 contre.
- Baudinard: 30 pour; 0 contre.
En application de
- Bois de Baudinard, 2 égorgeurs;
- Aups, 6 déserteurs.
On ne sait pas si ces délinquants
étaient en liaison avec les (ou faisaient partie des ) brigands qui infestèrent la contrée
à cette époque. D'abord soldats réfractaires, puis
brigands, ce fût bientôt une troupe puissante commandée
par Cassagne ( ou Gazagne), percepteur de
Ginasservis et Daurel ( ou Doré") de Salon. Ces réfractaires
furent renforcés sérieusement par des émigrés
rentrés en France, mais frappés à nouveau par
Ils séjournaient dans les bois,
dévastaient les campagnes, rançonnaient les voyageurs,
assassinaient les patriotes et arrêtaient les courriers pour brûler
les dépêches,. Leur quartier
général, en vendémiaire an VI ( Septembre-Octobre 1797) était la ferme de
Au cours de la nuit du 7 au 8 Novembre
1800, tous les chefs de la bande au nombre de 15, s'étaient réunis
dans une bastide déserte située au quartier de Valmoissine,
entre Aups et Moissac, pour se concerter.
Ils étaient armés de carabines,
de poignards et portaient chacun une ceinture contenant 40 cartouches.
Certains avaient un crucifix pendu cou; Daurel avait dans son
portefeuille des prières manuscrites destinées ` le préserver
d'une mort violente. La discussion terminée, ils s'endormirent.
Au milieu de la nuit, une mine qui avait été placée
dans la cave fit explosion: 12 brigands furent tués, 3 autres
blessés purent s'enfuir, mais 2 d'entre eux furent arrêtés
quelques jours plus tard et fusillés.
Le calme revint rapidement et le bruit
a couru que c'était le Préfet Fauchet 1er préfet
du Var) qui avait soudoyé l'un des bandits, pour attirer tous
les chefs dans ce guet-apens et débarrasser ainsi la région
de ces indésirables.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Et comme un long recul
est indispensable pour écrire l'Histoire avec sérénité
nous nous arrêterons là.
Avant-propos
FREDO MATHERON Lou Felibre dei péd-terrous
NOTE de l'auteur
Baudinard devant l'histoire comprenant
XI + 222 feuillets dactylographiés nous croyons utile d'indiquer
sommairement les principaux passage qui ont été supprimé
complètement ou réduits considérablement pour ne
laisser subsister (juste les 99 feuillets de cette petite histoire
de Baudinard:
-La formation du monde et
-
-La conquête de
-Les Sarrasins en Provence;
-L'implantation du Christianisme en Provence;
-Les multiples projets d'utilisation
de la source de Fontaine l'évêque;
-Une étude poussée sur
les premiers Blacas;
-La création du Couvent de Valmoissine;
-Artigas- contrairement aux écrits
dés auteurs- n'a rien à voir avec "l'ahrchinosc" des Chartes
du XI Siècle;
-Les Blacas, troubadours et les troubadours
varois;
-Les guerres de religion;
-La critique des textes cités;
-Les sources;
-etc., etc.
La 4ième partie - La communauté-
puisée presque totalement dans les archives, est presque identique
dans les 2 ouvrages et cela se conçoit aisément.
Enfin, cette Petite Histoire de Baudinard
ayant été écrite sans brouillon préalable,
certains raccords auront besoin de toute l'indulgence du lecteur.
.jpg)